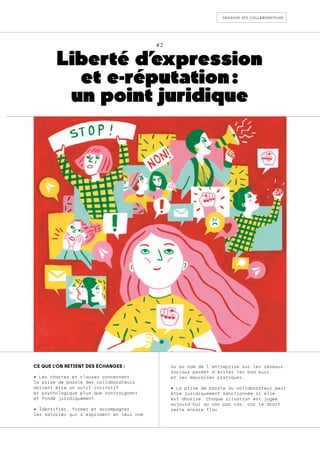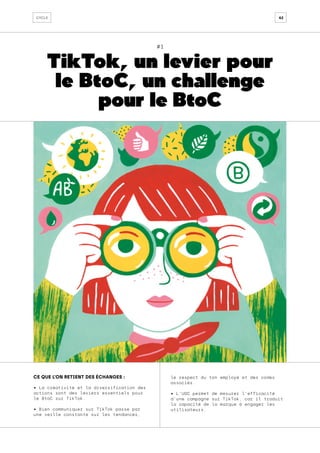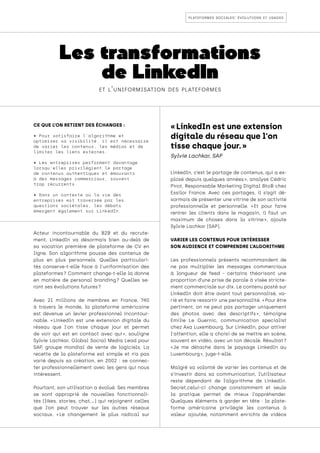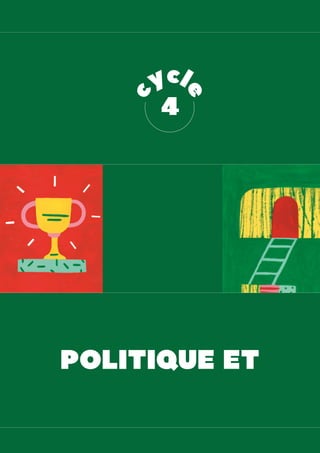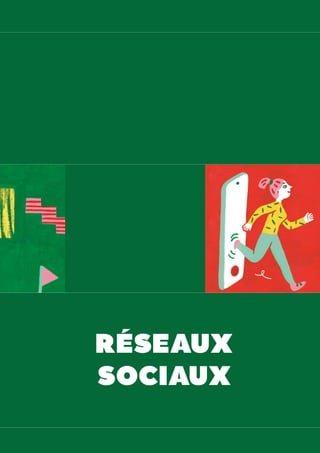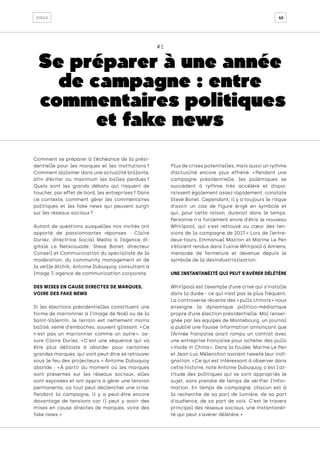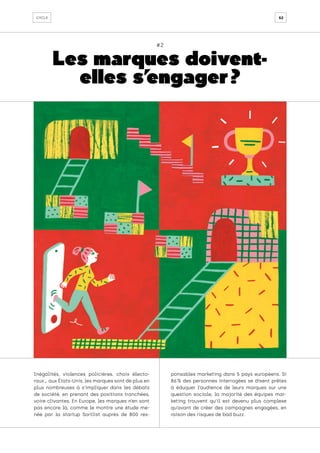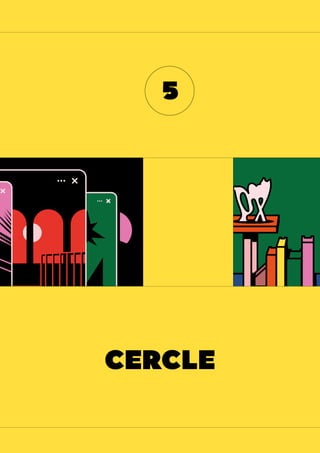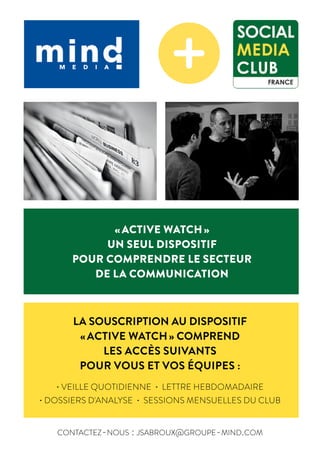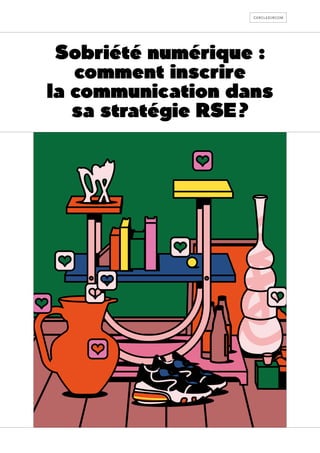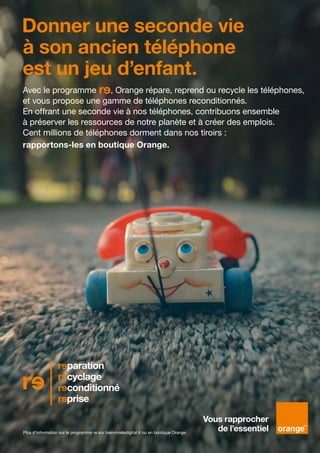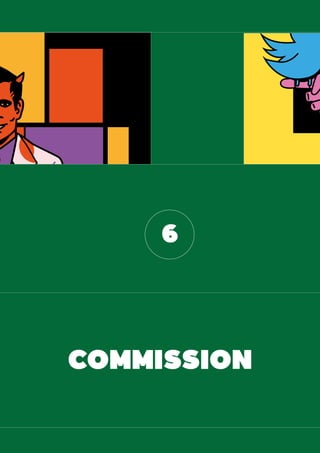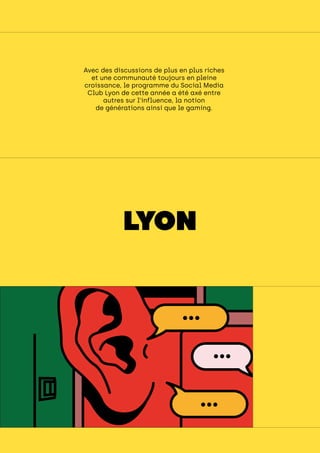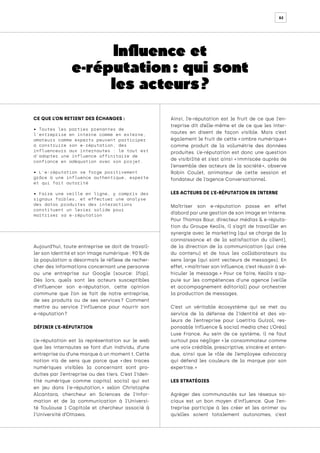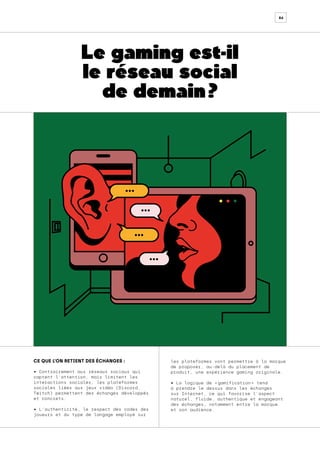Cahiers Social Media Club 2021.pdf
- 3. les cahiers du smc
- 4. 2 sommaire 2 - cycle : engager ses collaborateurs 3 - cycle : plate- formes sociales: évolutions et usages 34 #1 -Quand la comm’ interne devient un levier stratégique 37 #2 - Liberté d’expression et e-réputation : un point juridique 42 #1 - TikTok, un levier pour le BtoC, un challenge pour le BtoC 45 #2 - Les transformations de LinkedIn et l’uniformisation des plateformes 1 - focus 8 Qu’est ce qu’une « content factory » ? 10 Clubhouse: où en est-on ? 12 Un podcast et après ? Quelle stratégie de communication et d’engagement ? 15 Comment donner rendez-vous à sa communauté ? 4 Édito 17 Quel cadre pour l’influence en 2022 ? 20 L’année du live shopping ? 24 Les réseaux sociaux dans le parcours client 28 L’audio s’invite sur les plateformes sociales
- 5. les cahiers du smc 5 - cercledircom 4 - cycle : politique et réseaux sociaux 6 - commission social data 7 - smclyon 72 Du contenu marketing pour les humains ou pour les algorithmes ? 75 Social ads : quelles sont les données disponibles et comment les exploiter ? 78 Social data : quelle organisation des équipes ? 90 Nos intervenants 92 Nos membres 58 Comment se faire aimer quand on est pas une love brand ? 61 La marque doit-elle devenir un média ? 65 Sobriété numérique : comment inscrire la communication dans sa stratégie RSE ? 50 #1 - Se préparer à une année de campagne : entre commentaires politiques et fake news 52 #2 - Les marques doivent-elles s’engager ? 82 Influence et e-réputation: qui sont les acteurs ? 84 Générations X, Y, Z, babyboomers et xenials… quel rapport aux réseaux sociaux ? 86 Le gaming est-il le réseau social de demain ?
- 6. • Pierre-Yves Platini, co-fondateur du Social Media Club France, CEO de mind • Johana Sabroux, directrice opérationnelle du Social Media Club France, directrice associée de mind 0 é dit o
- 7. UNE COURSE DE FOND Les Cahiers du SMC, ce sont un peu nos voeux à nous, l’occasion de nous pencher sur l’année écoulée, d’en tirer de précieux enseignements et de nous projeter vers l’avenir, la nouvelle année et les bonnes pratiques à partager dans la course de fond que nous pratiquons toutes et tous : l’usage professionnel des réseaux sociaux. Cette deuxième année marquée par la pandémie de covid-19 a vu nos sessions se poursuivre en visioconférence. La pratique est désormais complètement intégrée et la centaine d’intervenant.e.s invité.e.s a pu constater qu’elle n’empêche pas la franchise des échanges. Nos experts se sont donc penchés sur les métamorphoses permanentes de l’influence, les évolutions des différentes plateformes, TikTok et LinkedIn en tête, mais aussi les problématiques liées au live shopping. Ces cahiers reprennent ainsi le contenu des sessions du SMC de janvier à décembre 2021 - focus, cycles, #CommissionSociaData, #CercleDircom, #SMCLyon, hormis nos « learning expeditions », comme les visites du HuffPost et du Monde, en octobre 2021, qui ne donnent pas lieu à compte-rendu. Vous les avez, cette année encore, sous les yeux sous forme numérique. Que cela ne les empêche pas d’être un nouveau vecteur du lien qui nous unit au sein de la communauté du Social Media Club France. Bonne lecture... et à très bientôt !
- 8. 6 1 f ocu s
- 9. focus Les sessions « Focus » sont des débats ciblés autour de thématiques clés qui préoccupent les membres du Social Media Club. En 2021, nous nous sommes donc penchés sur la content factory, à travers une étude de cas présentée par notre membre YouLoveWords, le phénomène Clubhouse, les finalités des podcasts mais aussi les dessous de la gestion d’une communauté en ligne.
- 10. 8 Qu’ est ce qu’une « content factory » ? Face aux médias sociaux régis par une tempo- ralité rapide, voire immédiate, les marques ont besoin de mettre en place une organisation et une stratégie digitale de contenu spécifique. C’est le défi auquel s’est prêté YouLoveWords pour Orange France à travers la création d’une « content factory » dédiée à l’animation des réseaux sociaux. Mais comment fonctionne-t- elle ? Comment produire des contenus percu- tants au service du business de la marque selon une exigence de réactivité toujours plus élevée? QUELQUES TENDANCES EN CHIFFRES La « content factory » est une « entité » de pro- duction - sous toutes ses formes - pour les ré- seaux sociaux, avec une exigence de qualité élevée. Un véritable défi face à l’augmentation du nombre de messages, corrélée à la baisse du temps d’attention des utilisateurs: • 8 secondes : notre temps d’attention moyen. Quelle stratégie mettre en place pour capitali- ser ce temps et capter l’attention des clients le plus rapidement possible ? • 13 millisecondes : temps moyen pour analyser une image. Comment produire un contenu per- cutant et séduisant ? • 2 : nouveaux membres sur LinkedIn chaque seconde • 325 % de temps passé en plus sur la plate- forme TikTok entre 2019 et 2020 • 100 millions d’épisodes de podcasts sont écoutés chaque mois en France : l’audio est un véritable levier de sa « content factory » social media OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA CONTENT FACTORY Pourétablirune« contentfactory »,YouLoveWords applique la stratégie des « 3P » : pitch (impac- ter le client dès les premières secondes sur les réseaux sociaux), play (créer de l’interactivité), plunge (produire un contenu plus éditorial). Cela permet de travailler à la fois la notorié- té de la marque, l’engagement de sa commu- nauté grâce aux contenus créatifs ainsi que la conversion. La Content Factory d’Orange France est une or- ganisation performante dédiée à la production volumique de contenus de qualité, dans le but d’augmenter son e-réputation. Il s’agit de faire preuve de créativité dans des délais courts tout en respectant les tendances de chaque réseau social. D’une part, chaque plateforme a ses co- des et ses formats qu’il faut connaître et res- pecter. D’autre part, l’analyse des différents KPIs permet d’augmenter cette e-réputation. QUEL ACCOMPAGNEMENT ? Pour mettre en place une « content factory », il est nécessaire en amont de connaître l’au- dience visée. Pour cela, YouLoveWords s’est ap- puyée sur le « Life Proof Lab », une étude globale qui décrypte à travers l’analyse de données les évolutions du marché. Il est également utile de récupérer la data document de référence et les contenus existants pour analyser les bonnes ou les mauvaises pratiques, ce qui a fonctionné ou non. Corréler à cette démarche une observation des contenus produits par les concurrents est également très pertinent. L’accompagnement se poursuit ensuite dans l’identification d’un écosystème de diffusion CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • Opter pour un marketing conversationnel, interactif et de proximité avec un contenu organique performant. • Travailler sur sa notoriété et sur l’engagement de la communauté à travers la stratégie du « pitch, play et plunge ». • S’entourer d’équipes expertes, créatives et à l’écoute des tendances et des codes de chaque plateforme.
- 11. focus cohérent avec la ligne éditoriale de l’entreprise. À cette étape, il s’agit d’identifier et de se fami- liariser avec les différents canaux (Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, etc.) et de sélection- ner les formats adaptés à chaque canal. Après avoir établi ces bases, le temps de la création est venu. YouLoveWords s’appuie sur une équipe experte et créative composée d’un content strategist, de talents créatifs et de spécialistes social media. Elle se dote d’outils (comités édi- toriaux, création de templates et de decks avec des propositions de formats) permettant d'aug- menter ses performances. Un planning édito est également construit par temps forts. Un fois la diffusion des contenus lancée, l’objec- tif est d’optimiser leur visibilité en s’appuyant sur le triptyque « owned » (contenus engageants organiques), « shared » (influenceurs pour valo- riser les temps forts), « paid » (posts sponsorisés sur les temps forts business). « Notre philoso- phie d’une “content factory” est de capitaliser sur notre reach naturel via nos “owned media”. Couplés à du “shared” et du “paid”, cela nous permet d’optimiser nos coûts, d’être plus agiles dans la gouvernance et la réactivité et donc de gagner en productivité. L’organique reste essentiel et est un révélateur », analyse Sophie Clauzure, responsable communication digi- tale & data chez Orange. Concernant les KPIs utilisés, «nous raisonnons en termes de vues générées et de points de contact par euro investi. Grâce à l’approche “owned, shared et paid”, cet euro et le ROI sont optimisés pour pouvoir être plus efficaces et rendre notre “content factory” plus agile », té- moigne Bruce Hoang, director digital commu- nication channels & data chez Orange France. BILAN DE LA COLLABORATION ET RECOMMANDATIONS Une Content Factory reste évolutive : après avoir mis en place une stratégie de content marke- ting performante et lancé les premiers conte- nus, il est essentiel de consolider la production et les formats pour ensuite accélérer le tout. Pour YouLoveWords, une bonne stratégie de « content factory » repose sur la réactivité et le respect des deadlines, une équipe experte et créative, et des outils de mesure de perfor- mance efficaces. Pour Orange France, les défis à venir concernent le renforcement du conversationnel, de l’aug- mentation du reach organique et la mise en place d’un feed encore plus engageant. Du côté de YouLoveWords, le challenge sera de détec- ter les tendances créatives en amont, de ga- gner davantage en expertise et de fluidifier les échanges via leur plateforme. Enfin, la prochaine étape et qui peut concer- ner toutes les entreprises sera de travailler sur le conversationnel via le community manage- ment. « On s’aperçoit que plus le contenu et les interactions sont personnalisés, plus cela va constituer des signaux positifs pour l’algo- rithme et augmenter la visibilité de nos conte- nus », analyse Bruce Hoang (Orange France). Avec la crise sanitaire et la fermeture des bou- tiques, il est important de rétablir la proximité par le contenu en faisant en sorte que ce der- nier soit à la fois « chaud » et interactif. Cette session s’est tenue le 18 mars en collabo- ration avec notre membre YouloveWords. • Cette session animée par Grégory Nicolaidis, Fondateur de YouLoveWords et Simon Opferman, Content Strategist chez YouLoveWords a eu lieu le 18 mars 2021 en visioconférence. • Avec Bruce Hoang, director digital communication channels & data chez Orange France et Sophie Clauzure, responsable communication chez Orange. • Compte-rendu rédigé par Maëva Dussault. « Il s’agit de faire preuve de créativité dans des délais courts tout en respectant les tendances de chaque réseau social. » Sophie Clauzure, Orange France
- 12. 10 Clubhouse : où en est-on ? Fort de 13 millions de téléchargements et 50 000 utilisateurs en France en mars 2021, Clubhouse place l’audio au cœur de la pratique du social media et devient la nouvelle alterna- tive aux plateformes sociales traditionnelles. Comment expliquer le succès fulgurant de ce réseau social qui s’organise sous la forme de salons de discussions où l’on communique par la voix, en direct ? Comment les marques s’em- parent-elles de la plateforme ? LE FONCTIONNEMENT DE CLUBHOUSE L’application Clubhouse est une plateforme 100 % audio : Floréal Hernandez, rédacteur en chef adjoint chez 20 minutes, la compare à une « radio interactive ». Différents types de « salles » virtuelles existent : la « social room », la « closed room » et l’« open room ». Au sein de cette der- nière, une thématique est définie en amont, autour de laquelle des intervenants discutent. « Un modérateur permet d’ajouter ou de retirer certains speakers, de couper le micro ou de donner la parole aux auditeurs s’ils souhaitent intervenir », explique Clémence Boxberger, Senior Marketing Acceleration Specialist chez Fabernovel. Selon elle, la plateforme permet « de partager un savoir, d’échanger sur de nou- veaux usages, de trouver des solutions sur des problématiques concrètes, mais également peut-être un bon levier pour fidéliser une clien- tèle du côté des entreprises. » Camille Lambert, consultante en gestion de projet chez SCIAM, définit trois types d’audi- teurs : les auditeurs libres, passionnés par un sujet spécifique, les individuels dont le but est de développer leur stratégie business, et les entreprises. Elle déconseille d’ailleurs de s’ex- primer en tant qu’entreprise : « je recommande de ne pas se présenter comme une marque, mais comme quelqu’un qui travaille pour cette marque et ainsi développer le personal branding. » Quelles stratégies pour être visible sur l’ap- plication ? Pour Fabien Ferreira, modérateur et speaker Growth & Sales sur Clubhouse, il s’agit de se constituer un réseau ciblé et de travailler sa biographie. Selon lui, l’onboarding est très important. Les mots-clés utilisés dans la bio- graphie, notamment les premiers, ont un impact SEO à ne pas négliger. Il conseille également de modifier l’username : « nous avons tendance à le personnaliser avec son nom et son prénom, sauf que l’username a une très grande portée, il est donc astucieux de l’utiliser en insérant un ou deux mots-clés. » Concernant le réseau, Clémence Boxberger (Fabernovel) conseille de suivre la commu- nauté de créateurs de la plateforme (comme Secret CH) : « ce sont les premiers créateurs qui connaissent le mieux les codes de la plate- forme, qui y ont investi le plus de temps et qui vont donc pouvoir parler de votre marque plus facilement tout en trouvant des systèmes pour la mettre en valeur, que ce soit par du sponso- ring ou des concours par exemple. » QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LA MARQUE ? Le succès de Clubhouse s’inscrit dans cet in- térêt croissant pour l’audio, accentué par les différents confinements. Clubhouse est une nouvelle manière de communiquer et d’échan- CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • L’audio, l’interactivité et la récurrence des rendez-vous créent une relation authentique et privilégiée entre les interlocuteurs et favorisent la rétention de son audience. • Clubhouse est un bon levier de networking, à intégrer dans le cadre d’une stratégie multicanale. • Former ses collaborateurs et développer leur personal branding favorisent la visibilité et la légitimité de sa marque sur la plateforme.
- 13. focus ger, en se concentrant sur la voix de ses inter- locuteurs uniquement. « C’est le réseau le plus social que je connaisse. La relation authentique et le lien créé avec l’audience va lui donner en- vie de venir vous écouter à nouveau », témoigne Clémence Boxberger (Fabernovel). Pour Camille Lambert (SCIAM), « l’authenticité est beaucoup plus grande grâce à la voix ce qui permet de remarquer immédiatement si une marque est là pour vendre, pour échanger sur sa passion ou échanger avec les clients. » C’est pour cela qu’il peut être pertinent pour la marque de faire de l’employee advocacy et de former ses collaborateurs, ce que conseille Clémence Boxberger (Fabernovel). Elle a d’ail- leuri a organisé une session sur l’application afin de faire comprendre aux employés son fonctionnement : « vos talents et vos meilleurs ambassadeurs peuvent être formés pour parler de votre marque. » QUEL ROI ? La récurrence des événements est essentielle pour fidéliser son audience. Fabien Ferreira s’appuie sur le fait que ce n’est pas le nombre d’auditeurs dans les rooms qui comptent, mais « la rétention, qui se construit en créant des ren- dez-vous réguliers ». L’avantage de l’application est que l’on peut mesurer cette audience, bien « qu’il n’y ait pas de ROI direct » d’un point de vue financier. Pour Camille Lambert (SCIAM), le ROI se mesure sur le long terme. Elle pré- cise : « pour moi, Clubhouse est davantage un moyen de faire du networking, qu’il faut perce- voir comme un complément, mais pas comme un canal unique. » L’AVENIR DE LA PLATEFORME Nous pouvons observer depuis quelque temps un ralentissement du nombre de télécharge- ments, de rétention et d’acquisition. « Facebook et Twitter sont en train de développer des fonc- tionnalités similaires. Est-ce une offensive à la- quelle l’application peut résister ? », s’interroge Josselin Moreau, co-animateur de cette ses- sion et head of strategy chez TSC. Pour Fabien Ferreira, se faire copier est au contraire un bon signe: TikTok s’est également fait copier sur son format, mais existe toujours. En revanche, sa grande difficulté à proposer une application sur Android est pour Fabien Ferreira le signe que Clubhouse ne suivra peut-être pas face au poids et aux moyens de ses concurrents. Certaines marques n’y ont cependant pas trou- vé d’intérêt. Se positionner sur la plateforme nécessite des moyens humains importants. L’exercice de la prise de parole en live requiert des compétences spécifiques. Néanmoins, « il est possible de rencontrer sur Clubhouse des personnes que nous n’aurions jamais pu rencon- trer en vrai. Faire une veille technologique et notamment dans les autres pays sur vos concur- rents devient très accessible. » En définitive, que Clubhouse perdure ou non, « il y a un enjeu à travailler sur le concept de l’audio et à comprendre les codes des plateformes dé- diées », pour Clémence Boxberger (Fabernovel). En tant que marque, des opportunités sont à saisir si les codes d’utilisation sont respectés. Il faut néanmoins rester vigilant, sa faillibilité technique pouvant conduire à ce que d’autres plateformes sociales s’emparent du format. « Ne pas se présenter comme une marque, mais comme quelqu’un qui travaille pour cette marque et ainsi développer son personal branding. » Camille Lambert, SCIAM • Cette session, animée par Josselin Moreau, head of strategy & experience et Jean-Baptiste Ong, head of social media, chez TSC a eu lieu le vendredi 21 mai 2021 en visioconférence. • Avec Clémence BoxBerger, Senior Marketing Acceleration Specialist chez Fabernovel, Floréal Hernandez, Rédacteur en chef adjoint de 20 minutes, Fabien Ferreira, Growth & sales hacker à station F et Camille Lambert, directrice de projet stratégique en finance de marché de SCIAM. • Compte-rendu rédigé par Maëva Dussault.
- 14. 12 Un podcast et après ? Quelle stratégie de communication et d’engagement ? CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • Une communauté se forme principalement autour de la marque et non pas du format. Le contenu doit donc être vecteur de l’identité et des valeurs de la marque. • Publier sur Youtube son podcast converti en vidéo est un excellent levier de découvrabilité. • Définir un « parcours auditeur » précis à travers l’identification, la promotion, l’activation et la rétention autour du podcast est une méthodologie d’engagement très efficace.
- 15. focus Le confinement a été un accélérateur dans la consommation du podcast, qui connaît depuis quelques années une hause de sa popularité : en février 2021, 93,6 millions de podcasts ont été écoutés en streaming ou téléchargés par les Français (Médiamétrie). 82 % des auditeurs de podcasts natifs estiment que les entre- prises devraient les utiliser pour communiquer différemment, sachant que 14 % des Français écoutent des podcasts natifs de manière heb- domadaire (CSA-Havas). Mais quelle straté- gie de communication adopter une fois que le podcast est lancé ? Comment faire connaître son podcast de marque et le faire vivre sur le long terme ? TROUVER SON AUDIENCE La première étape consiste à cibler ses audi- teurs. Les podcasts natifs, dont ¼ des auditeurs ont moins de 25 ans, permettent, entre autres, de « toucher une cible que d’autres médias ont davantage de mal à convoiter d’un point de vue marketing : la cible urbaine CSP+ de 34-45 ans », explique Virgile Brodziak, directeur Général chez Wunderman Thompson Paris. Pour aller toucher sa cible spécifique, « c’est la qualité du contenu qui importe », ajoute-t-il. En effet, pour Jennifer Han, directrice marketing chez Ausha Podcast, tout est dans la qualité et la pertinence du contenu. « Il faut attirer en pro- duisant un contenu intéressant pour l’audience que l’on veut toucher, qui incarne la marque et ses valeurs. » Puis vient l’étape de la « découvrabilité, qui reste un problème encore bien présent pour ce média », témoigne Alexandre Zermati, créateur du podcast AZZZAP. YouTube reste pour le mo- ment un bon moyen de relever ce challenge, en convertissant ses podcasts en vidéo (une audio wave animée suffit). Selon David Eichholtzer, animateur de cette session et dirigeant de WAM référencement : « le poids des plateformes de streaming, amenant 55 % des auditeurs (Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc.) en 2019, est impor- tant pour la découvrabilité. » Le référencement naturel (SEO) via le choix du titre, de la descrip- tion et des tags de ses épisodes, est également un levier intéressant, Google ayant même mis en place récemment un carrousel podcast. Pour Virgile Brodziak (Wunderman Thompson), la communauté se forme autour de la marque et non pas du format : « investir dans la produc- tion sonore ne peut pas se faire sans sa média- tisation. Il faut savoir se démarquer et utiliser ce qui est déjà à disposition de la marque pour ramener les clients vers le podcast. » Pour cela, Jennifer Han (Ausha) conseille d’utiliser les bons outils selon la bonne méthodologie, ce qu’elle nomme le « parcours auditeur. » Parvenir à construire un plan pour faire revenir l’audi- teur passe par : une bonne identification de la cible (qui est le persona auditeur ?), une pro- motion du podcast auprès d’elle (RP influence, médias spécialisés), une activation (production de métadonnées autour du podcast comme une bande-annonce) et enfin une rétention des au- diteurs par une communication organique (ré- seaux sociaux, site Internet, newsletter, bouche- à-oreille, etc.) ENGAGER SA COMMUNAUTÉ Comment fédérer et engager autour de ce contenu sur le long terme ? Selon l’étude récente du CSA et d’Havas, 44 % des auditeurs attendent d’un podcast natif qu’il soit authentique, qu’il propose des contenus vrais. David Eichholtzer (WAM référencement) le voit comme «une op- portunité pour l’entreprise d’être dans le partage d’expertise et d’être plus proche de ses clients.» Virgile Brodziak (Wunderman Thompson) estime que les marques doivent assumer un « contenu de qualité, intéressant, doté d’un certain niveau de design et de production », ce qui sous-entend souvent de produire un contenu plus court que des podcasteurs indépendants. Néanmoins, se- lon lui, la question de l’authenticité dépend de l’angle éditorial. Faire en sorte que le buzz ne retombe pas est un «travail de longue haleine, corrélé à la per- sonne qui anime le podcast, qui doit à la fois surmonter la frustration si l’audience n’est pas aussi importante que prévue, tout en s’appuyant sur la communauté et ses encouragements pour persévérer», analyse Jennifer Han (Ausha). QUELS KPIS POUR QUEL ROI ? Pour mesurer le ROI, « techniquement, nous es- sayons de prendre tout ce que les plateformes d’écoute acceptent de nous donner pour en- suite travailler des intégrations spécifiques. Néanmoins, les géants des plateformes d’écoute ont tendance à protéger fermement leurs don- nées. Nous essayons alors de travailler sur des données en propre que l’on pourrait exploiter », abonde Jennifer Han (Ausha).
- 16. 14 Concernant le vecteur d’écoute, le confine- ment a transformé les usages : l’étude du CSA d’octobre 2020 montre qu’il y a eu un transfert partiel du smartphone vers l’ordinateur, et de l’écoute dans les transports à l’écoute dans toutes les situations du quotidien : les habitu- des de consommation se sont diversifiées, en phase avec l’évolution de nos modes de vie, es- time David Eichholtzer (WAM référencement). Alexandre Zermati (AZZZAP) observe que « contrairement aux médias vidéo, les temps d’écoute sont beaucoup plus longs. Nous sommes finalement plus captifs sur le podcast que sur d’autres supports vidéo. » Pour Virgile Brodziak (Wunderman Thompson), « c’est l’angle éditorial qui guide le choix de la durée. Les don- nées disponibles sur la durée d’écoute des au- diteurs peuvent permettre d’ajuster la durée du podcast au fil du temps. » Jennifer Han (Ausha) a observé ce phénomène : « plus le podcast se démocratise, plus les po- dcasts ont tendance à raccourcir, passant d’une moyenne d’1h15 fin 2018 à 30 minutes au- jourd’hui. Le lancement des podcasts de marque a privilégié les formats plus courts, les marques étant habituées aux médias traditionnels. Mais il ne faut pas choisir sa durée par rapport à des moyennes ou formes d’efficacité. La magie de ce format est de pouvoir avoir des contenus beaucoup plus longs, avec d’excellents taux de complétion : il faut privilégier l’angle éditorial. » LE PODCAST DU FUTUR En tant que contenu audio live, l’appli Clubhouse est-elle un concurrent du podcast ? Alexandre Zermati (AZZZAP) la voit plutôt comme un com- plément. Alors que ses salons de conversation s’appuient sur le live et le collaboratif, « le po- dcast s’apparente à l’émission et se distingue par sa régularité », estime Jennifer Han (Aushan), rappelant que « l’usage de l’audio avec le digital se développe de manière générale (utilisation des commandes vocales, mémos vocaux, Siri). » Concernant le podcast du futur, David Eichholtzer (WAM référencement) l’imagine ani- mé par des personnalités influentes qui décli- neraient leurs contenus écrits vers l’audio. «Le prochain grand défi sur le marché français est de faire un vrai blockbuster du podcast, avec de vrais moyens d’écriture, d’enregistrement et d’acteurs très solides. Certaines marques comme Chanel en ont déjà fait le pari.» Jennifer Han (Ausha) approuve. Pour elle, le po- dcast du futur passe par la qualité sonore, de l’enregistrement comme de la voix. Par-dessus tout, «l’axe authentique va rester une condition sine qua non du média. Être qualitatif n’est pas contradictoire avec l’authenticité, l’intimité. Le podcast est un peu le nouveau format de la ra- dio pirate version digitale.» Alexandre Zermati (AZZZAP), croit davantage au pouvoir de l’auto-formation qu’offre le podcast natif. Il espère qu’’une plateforme aussi perfor- mante que YouTube verra le jour, afin de décou- vrir, regrouper et analyser plus efficacement, via la data, tous ces contenus audios. • Cette session animée par David Eichholtzer (WAM référencement) a eu lieu le mardi 11 mai 2021 en visioconférence. • Avec Virgile Brodziak, directeur Général chez Wunderman Thompson Paris, Jennifer Han, directrice marketing chez Ausha Podcast et Alexandre Zermati, créateur du podcast AZZZAP. •Compte-rendu rédigé par Maëva Dussault. Il faut attirer en produisant un contenu intéressant pour l’audience que l’on veut toucher, qui incarne la marque et ses valeurs.
- 17. focus Comment donner rendez-vous à sa communauté ? Au sein d’un environnement médiatique très concurrentiel, développer sa communauté et la fidéliser sur les réseaux sociaux demande un effort permanent et sur le long terme. Alors une fois son audience constituée, comment la transformer en communauté engagée ? Quels sont les leviers disponibles pour proposer un contenu qui l’intéresse et qui lui permette de rester fidèle ? COMMENT IDENTIFIER LES BESOINS DE SA COMMUNAUTÉ ? Comme le souligne Nolwenn Roux, social me- dia & influence director chez Monet + Associés et animatrice de cette session, « identifier les besoins de sa communauté est une étape es- sentielle pour pouvoir l’activer ensuite. » Mettre en place une veille efficace est le pre- mier levier à activer pour créer un lien avec les abonnés, par l’écoute de ce qu’il se dit. Pour cela, des outils de mesure d’audience tels que Visibrain ou Talkwalker existent. « Les outils de mesure d’audience constituent une source d’information extrêmement riche, à condition de bien les orienter et les exploiter », conseille Nicolas Salado, direction générale, transfor- mation digitale, media & entertainment chez Doctissimo: « C’est ainsi que l’on a pu com- prendre les besoins et les attentes de notre communauté, tout en essayant d’être réactif pour s’adapter à eux et produire des contenus dans ce sens. » Pour Maxime Taillebois, ex-responsable de la communication numérique au Ministère des Sports, « recourir à ces outils permet d’avoir une recherche à la fois large et à la fois plus resserrée sur certains sujets et donc répondre à des gens qui ne s’attendent pas à ce qu’on leur apporte des réponses. » « Au-delà de fi- déliser les abonnés de nos réseaux sociaux, l’objectif est aussi d’étendre son audience », précise-t-il. COMMENT INTERAGIR AVEC SA COMMUNAUTÉ ? Le choix des plateformes pour interagir avec sa communauté dépend à la fois du nombre d’abonnés et du ton avec lequel les internautes interagissent sur celles-ci. Il est en effet dé- licat de réunir et de fidéliser sa communauté lorsque les échanges sont principalement viru- lents, voire haineux. « On a constaté une vraie disparité d’un réseau social à l’autre en analy- sant notre e-réputation. Le nombre de commen- taires, leur tonalité ne sont pas les seuls indica- teurs à prendre en compte. Il y a aussi les likes et les partages », précise Maxime Taillebois (ex-Ministère des Sports). Certains outils de modération tels qu’Atchik, Netino ou Bodyguard offrent la possibilité d’identifier ces propos haineux. Néanmoins, ils ne permettent pas encore de détecter les fake news. Pour lutter contre la désinformation, les équipes de Doctissimo ont donc mis en place un programme de modération, porté par des ambassadeurs bénévoles issus de leur com- munauté : c’est un cercle vertueux rare qui s’est créé et profite à toute la communauté. CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • Mettre en place une veille efficace est une étape clé pour créer un lien avec les abonnés, et comprendre leurs attentes. • Privilégier une communication conversationnelle et interpersonnelle à une communication institutionnelle et « froide ». • Oser développer de nouveaux formats et questionner sa ligne éditoriale en fonction du contexte pour se réinventer.
- 18. 16 • Cette session animée par Nolwenn Roux (Monet + Associés) a eu lieu le mardi 9 juin 2021 en visioconférence. •Avec Maxime Taillebois, ex-responsable de la communication numérique au Ministère des sports et Nicolas Salado, direction générale, transformation digitale, media & entertainment chez Doctissimo. •Compte-rendu rédigé par Maëva Dussault. Dans ce contexte de crise exceptionnelle, Doctissimo a souhaité se réinventer et s'adap- ter en proposant notamment de nouveaux formats : les équipes ont organisé différents Facebook live avec pour objectif de s’appuyer sur des experts reconnus pour transmettre de l'information. Chaque rendez-vous accueillait toujours plus de participants. Cela leur per- met aujourd’hui de toucher de nouvelles au- diences. Les interactions entre les membres d’une communauté sont, selon Nicolas Salado (Doctissimo), également un levier clé d’enga- gement : « Quand une marque parvient à inte- ragir avec sa communauté, c’est très bien, mais c’est encore mieux quand les membres de cette communauté arrivent à communiquer entre eux, c’est très vertueux. » Au ministère des Sports, en réaction à la crise sanitaire, le ton employé a changé : « Nous avons souhaité converser davantage, proposer une communication plus interpersonnelle et systématique aussi bien sur Twitter, Instagram que Facebook. Notre communication, aupara- vant, était très institutionnelle. Nous avons mo- difié notre ligne éditoriale en liant un ton déca- lé autour de la communication sur les mesures gouvernementales à nos méthodes de rigueur. On observe aujourd’hui un engagement beau- coup plus constant. » COMMENT CRÉER DE L’ENGAGEMENT DANS LA DURÉE ? La personnalisation des messages permet d'installer une relation de confiance avec son audience. « Il faut proposer un service plus indi- viduel. Lorsqu’on analyse le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux et la propor- tion de personnes qui voient les publications par rapport à ceux qui nous suivent, je ne pense pas que l’on puisse compter sur un post géné- ral », précise Maxime Taillebois (ex-Ministère des Sports). Pour engager les communautés plus timides, l’objectif va être « d’inciter et d’encourager les membres de la communauté à dialoguer, à exprimer ce qu’ils vivent, quitte à ce que ce soit en circuit plus fermé via des messages ou des cercles privés », abonde Nicolas Salado (Doctissimo). En définitive, l’engagement d'une communauté est avant tout une question d’écoute, d’adap- tabilité et d’interaction. Il est important de challenger ses pratiques, de se réinventer pour proposer de nouveaux formats ou encore de nouveaux modes d’interaction : « l’important est de toujours garder l’esprit ouvert pour se renou- veler et savoir quand est-ce que les attentes de la communauté vont changer ou d’identi- fier les rendez-vous ou les formats n'étant plus pertinents », conclut Nolwenn Roux (Monet + Associés). « Identifier les besoins de sa communauté est une étape essentielle pour pouvoir l’activer ensuite. » Nolwenn Roux, Monet RP
- 19. focus Quel cadre pour l’influence en 2022 ? Face à un contexte de défiance grandissant à l’égard de la publicité traditionnelle, le mar- keting d’influence est apparu, depuis plusieurs années, comme un levier puissant pour pro- mouvoir ses produits ou services et booster sa e-réputation auprès d’une audience ciblée. Du micro-influenceur aux grandes collaborations, l’influence d’aujourd’hui prend de multiples vi- sages: qu’en attendre? Quelles sont exactement les dérives actuelles et comment s’en prémunir au mieux? Qu’est-ce qui fonctionne aujourd’hui et quelles leçons tirer de récentes expériences ? Enfin, quelles sont les tendances qui annoncent ce que sera l’influence en 2022 ? L’influence est omniprésente dans les stratégies de communication d’aujourd’hui. Chez iGraal, une plateforme de cashback, il s’agit de toucher une base de plusieurs millions d’utilisateurs ac- tifs dans tous les secteurs, du voyage à la beau- té, et donc de collaborer avec des influenceurs traitant d’une très grande variété de sujets. Cette approche remonte à plus d’une décennie, d’abord avec les blogs puis en accompagnant l’émergence et la croissance des différents ré- seaux sociaux. iGraal utilise aujourd’hui en ma- jorité Youtube, Instagram pour sa partie Stories, et TikTok dans une moindre mesure. Chez Bel, les marques ont un capital sympathie très fort, une aura très positive, de la centenaire Vache qui Rit à la toute nouvelle marque végétale Nurishh, ce qui facilite les stratégies d’influence. Pour Allianz, qui aborde beaucoup de questions de RSE et sociétales, et peut par ailleurs avoir une image de marque un peu sérieuse, l’influence est une vraie opportunité d’incarnation et de proxi- mité avec le public. La communication et les conseils financiers sont strictement encadrés, les campagnes d’influence d’Allianz ne parlent donc quasiment jamais de produits mais sont plutôt axées autour de sujets de société. Les profils d’influenceurs sont très variés, les geeks qui sensibilisent sur la cybersécurité et la cyberprotection, les sportifs, et les interve-
- 20. 18 nants sur les sujets de responsabilité sociétale et prévention (sécurité routière, environnement, santé…). Chez iGraal, les profils reflètent la diversité des utilisateurs et des secteurs cou- verts, hommes et femmes, majeurs, en France ou en Belgique, du micro influenceur à la star de Youtube, iGraal travaille toutes les tailles de communautés. Le cœur de cible d’iGraal a entre 25 et 34 ans. Si la marque travaillait essentiel- lement l’influence en direct à son commence- ment, elle en a fait un canal d’acquisition à part entière à mesure qu’elle se développait. Elle passe désormais parfois par des agences, mais encore assez peu par les plateformes d’influenceurs. Chez Bel, Malaïka Coco dit aussi travailler avec tout type de profils d’influenceurs, des parents aux jeunes adultes, avec des stratégies spéci- fiques de création de communauté et d’activa- tion pour chaque sujet. Par exemple, pour son centenaire, La Vache qui Rit a créé un parte- nariat avec Le Rire Médecin, qui partage l’ADN du rire et permet une activation solidaire et in- carnée, permettant de toucher des cibles plus jeunes et plus connectées, avec des contenus sur différents types de plateformes. La cam- pagne a généré plus d’un milliard de vues sur TikTok et collecté une somme importante grâce à un filtre, utilisé sur TikTok et Instagram, dans un bel exemple d’influence utile et solidaire. L’angle de la dernière campagne Boursin était lui beaucoup plus centré sur la créativité, l’ins- piration en cuisine, avec des Chefs comme Pierre Sang Boyer et Amandine Chaignot. RÉASSURANCE L’authenticité semble de plus en plus difficile à atteindre face à la lassitude des consomma- teurs devant des posts trop commerciaux, et ce critère est donc plus essentiel que jamais. Chez Bel, on y prête une attention encore plus forte pour les marques touchant les enfants comme Kiri, qui nécessitent encore plus de réassurance. Malaïka Coco travaille sur le long-terme avec des parents eux-mêmes adeptes du produit, en faisant appel à eux régulièrement, sur plu- sieurs temps forts spécifiques. Pour le choix d’influenceurs, Bel se concentre sur l’engage- ment, l’authenticité et l’adhésion aux valeurs de la marque. La vision stratégique du Groupe est de créer des communautés d’ambassadeurs mobilisables et garantissant un certain niveau d’impact. Lorsque les marques passent par des agences d’influenceurs, les critères de taille de communauté et de thèmes sont très claire- ment précisés, en donnant la priorité absolue au “brand fit”, à l’adéquation entre le thème de la campagne, les valeurs de la marque et le positionnement de l’influenceur. L’équipe de Bel essaie de rester très à l’écoute des consom- mateurs, en évitant les contenus qui donnent l’impression d’être faits « à la chaîne » et qui en- voient une image trop commerciale. La sélec- tion est donc très pointue. Pour iGraal l’authenticité est également clé et les relais des campagnes doivent impérati- vement avoir testé le service en amont. Chez Allianz, les influenceurs ne sont pas directe- ment inspirés des produits, ils portent plutôt des messages RSE, dans une optique de long-terme, avec une approche orientée « intérêt général », prise de conscience sociétale. Lorsqu’un.e in- fluenceur.se lifestyle est choisi.e, le message peut être éloigné de son univers et de celui de sa communauté, mais en laissant une certaine latitude éditoriale, on obtient quelque chose d’à la fois authentique et efficace, comme Natoo sur la cybersécurité, qui sait par sa propre ex- périence ce que cela signifie d’être « trollée ». Une autre campagne de prévention visait à ac- compagner le développement de trottinettes électriques, en proposant de venir retirer des casques en agence ; elle a aussi connu un suc- cès immédiat. Pour Allianz, l’idéal est d’ins- crire les relations avec des influenceurs dans la durée: une opération « one shot » peut aussi être lue comme le signe qu’elle n’a pas si bien fonctionné. Les difficultés rencontrées par Allianz sont peu fréquentes et concernent plutôt le manque de professionnalisation de quelques influenceurs très jeunes et peu habitués aux contraintes qu’impliquent la collaboration avec un grand groupe, du planning à la ligne éditoriale. Chez iGraal, il arrive que les contenus ne soient pas clairs ou même qu’ils créent de la confu- sion, ou que les messages ne respectent pas certaines valeurs essentielles de l’entreprise. L’authenticité semble de plus en plus difficile à atteindre face à la lassitude des consommateurs devant des posts trop commerciaux.
- 21. focus Les « dos & don’ts » ne sont pas forcément suffi- sants. Tous les contenus sont validés avant leur mise en ligne, et il est nécessaire que le contrat établisse clairement que c’est l’annonceur qui fixe les règles de base et le fond du message et se réserve le droit de faire des coupes dans le contenu. C’est la marque qui a le « final cut », ce qui n’empêche pas qu’un label d’influenceur responsable serait le bienvenu. Chez Allianz, pour pouvoir parler abondam- ment des JO 2024 et des jeunes sportifs ac- compagnant l’engagement de la marque dans le domaine du sport sans pour autant inonder les réseaux d’Allianz de contenus sur le thème du sport, des comptes séparés ont été créés, ce qui nécessite une vraie politique d’acquisi- tion, assez longue à opérer, mais finalement satisfaisante. TRANSPARENCE VS AUTHENTICITÉ La transparence est parfois en contradiction avec l’authenticité que réclament les consom- mateurs, mais toutes les intervenantes y prêtent une grande attention. Natalia Roblès de GRDF est intervenue pour partager son expé- rience autour de la campagne sur le gaz vert, un sujet assez technique que les influenceurs ne connaissaient a priori que très peu. Pour cette campagne, GRDF avait utilisé une agence d’in- fluenceurs, et a demandé, alors que le nageur Camille Lacourt avait accepté de remplacer une influenceuse au pied levé, à briefer en di- rect les participants à la campagne lors d’une visio-conférence, pour être certains qu’ils aient bien compris les éléments de langage. Sur les sujets complexes, ce lien direct est vraiment très bénéfique. Chez Bel aussi, on perçoit clairement la valeur de ces liens directs, comme lors de l’opération Babybel / Marvel à Eurodisney, une journée très positive pour tous et qui a généré beaucoup plus de “earned media” qu’initialement prévu. Les tendances pour 2022 continueront à tourner autour de la question de l’authenticité : pour éviter l’écueil de la lassitude face à des conte- nus trop commerciaux, une des voies est de tra- vailler avec des influenceurs aux communautés beaucoup plus petites mais très engagées, avec un fort pouvoir de recommandation et donc des performances plus élevées. Cela nécessite un travail d’orfèvre, et l’outil idéal n’existe pas en- core. Pour Ana Aires-lerin d’iGraal, une autre parade à cette lassitude est de se démarquer encore plus sur la créativité et la qualité des contenus. Il y aura sans doute aussi un mou- vement de standardisation de la mesure, dont le secteur a toujours vraiment besoin, tout comme plus d’encadrement de la responsabili- té, à tous les niveaux de la campagne. Marie- Doha Besancenot (Allianz France) partage cette vision, la responsabilité est un sujet qui reste à traiter, encore davantage dans une an- née d’élection présidentielle, pendant laquelle les sujets militants et les prises de positions tranchées peuvent être délicats à gérer, cela renforce la nécessité de bien cadrer le discours en amont (lire aussi notre Cycle « Politique et réseaux sociaux »). • Cette session animée par Tiphaine Masurel a eu lieu le mercredi 22 septembre 2021 en visioconférence. • Avec Marie-Doha Besancenot, head of communications chez Allianz France, Malaika Coco, head of communication & influencer marketing chez Groupe Bel et Ana Aires-lerin, experte influencer marketing chez iGraal. •Compte-rendu rédigé par Tiphaine Masurel. « La vision stratégique du Groupe Bel est de créer des communautés d’ambassadeurs mobilisables et garantissant un certain niveau d’impact. » Malaika Coco, Groupe Bel
- 23. focus Le live shopping se développe à grande vitesse, porté par des taux de conversions et paniers d’achat démultipliés et des effets d’image et de construction de communauté très positifs. Entre plateformes spécialisées et développements des géants du web, les outils sont nombreux et le live shopping peut aller de la simple publi- cation à de longues sessions vidéo. Pourquoi se mettre au live shopping ? Quels effets peut-on en attendre? Quels moyens mettre en place ? Pour quelles marques est-il indiqué ? Est-ce un effet de mode, ou un élément-clé du futur du retail ? Le Live Shopping est un mélange entre le Live Streaming vidéo et l’e-commerce. Diffusé en ligne, il permet une interactivité instantanée et la collecte de données. Comment une marque désireuse de se lancer doit-elle aborder le sujet ? UNE AUDIENCE À 90 % MOBILE Comment procéder, quelles sont les plate- formes et outils à utiliser ? Chez Monoprix Online, qui regroupe le e-commerce de Monoprix.fr ainsi que de Sarenza et Naturalia, plusieurs outils ont été testés. Pour Sarenza, une marque pour laquelle le côté communau- taire et conversationnel est essentiel, c’est Outrank, comprenant un outil de chat, qui a été choisi. Un 1er live a été organisé avec la marque Aasics pour la rentrée. Pour Monoprix, en juin dernier, l’outil Caast utilisé pour une vente avec la marque beauté Les secrets de Loly ne permettait que de diffuser en paysage, alors que l’audience était à 90 % mobile. Pour les suivantes, la plateforme Spockee a permis d’utiliser un format portrait plus adapté. L’idée est de se stabiliser, et de choisir l’outil le plus adapté à l’événement, par exemple pour le Live Foire aux Vins l’audience était beaucoup plus desktop. Caast permet une modération faci- litée sur desktop, Spockee sur mobile. Quidol, utilisé par Carrefour, a des fonctionnalités de quizz intégrées intéressantes. Le Printemps a commencé par utiliser Bambuser et tient à la possibilité de récupérer le conte- nu et l’intégrer à des fiches produits du site de e-commerce, ce que l’outil Livescale permet. Pour Monnier Frères, implanté en Chine depuis cinq ans, s’investir dans le live shopping était naturel. La marque a lancé sa stratégie li- veshopping en 2021, et réalisé depuis des mil- liers d’heures de lives. « Il est étonnant qu’en Occident on en soit encore à discuter des ou- tils: en Chine les plateformes sont totalement intégrées, il n’y a plus à se poser la question des fonctionnalités », souligne Diaa Elyaacoubi, CEO de Monnier Frères. La clé, selon elle, se trouve plutôt dans les animateurs des lives, appelés masters of ceremony ou MC, qui sont vraiment les nouveaux influenceurs, et dans le story telling. Quand il y a quelques mois, un live avec Lena Situations a généré 5 000 vues en 1h plus de 20 000 réactions, cela paraissait peu en comparaison des performances chinoises, mais c’est un score qui serait similaire à ce- lui de Jennifer Lopez pour Amazon! En Europe, estime Diaa Elyaacoubi, Livescale est l’outil technologique le plus efficace. En Chine, le live shopping représente déjà entre 6 et 10 % du e-commerce réalisant une croissance de 280 % depuis 2017 pour atteindre 423 B$ des ventes en 2022 (Mackinsey july 2021). Selon Alibaba, le liveshopping pourra représenter à terme jusqu’à 80 % du e-commerce. Reworld Media a organisé ou été associé à des dizaines de live shoppings, et les outils varient également en fonction des objectifs. Les constructeurs automobiles vont plutôt se concentrer sur la collecte de leads, tandis que pour les marques plus orientées ROI et perfor- mance, Livescale est effectivement une solution efficace, déjà interfacée avec certains CRM, capable de créer des sites e-commerce tam- pons… Reworld bénéficie d’une licence exclu- sive de Livescale en France dans le secteur des médias, et utilise une solution développée en interne pour les clients qui préfèrent se concen- trer sur la génération de leads. La régie s’appuie parfois sur les outils développés par les plate- formes comme Instagram pour les opérations plutôt orientées branding. Une fois la plateforme choisie, le live shopping nécessite évidemment une production vidéo. L’intégration du flux de contenu dans le live shopping est assez simple, plus que pour une diffusion TV. Il est intéressant de travailler en « vente privée » et de collecter une base de contacts qui peut être sollicitée après le live.
- 24. 22 Monoprix est en train d’intégrer un studio à son organisation, accompagné par Spoky, qui les aide à mettre en place une équipe auto- nome comme ils ont pu le faire avec IKKS ou Décathlon. La qualité de la production est très importante pour deux raisons: d’abord parce que le taux de transformation des replays est également très bon, d’autre part pour pouvoir ré-utiliser les contenus, packshots et packs vi- déos, sur les sites d’e-commerce dans les fiches produits. Le Printemps s’est fait accompagner au début pour la production de vidéos mais est désormais presque autonomes après seulement quatre éditions. Les vidéos de live shopping ne demandent pas forcément de gros moyens, il y a certes une qualité minimum à respecter, mais si l’on veut que cela soit rentable, il faut aussi savoir tirer parti de ces possibilités de pro- duction à moindre coût. Les vidéos à la Tik Tok, tournées avec un smartphone dans une simple chambre, peuvent être celles qui fonc- tionnent le mieux. CANAL DE CONQUÊTE Tous les participants témoignent que la mise en place du live shopping est très chronophage, demande beaucoup d’énergie et mobilise un grand nombre de collaborateurs en mettant en lumière des silos. Pour le dernier live Monoprix, 60 personnes ont été mobilisées. L’arrivée d’un live shopping manager et d’une équipe dédiée devrait faciliter le processus. Quels sont les objectifs de la mise en place du live shopping ? Pour Monoprix c’est un canal de conquête, et même si l’on souhaite générer du communautaire, ce n’est pas encore souvent le cas, à part chez Sarenza. Les influenceurs sont encore un peu trop « télé-achat », ce sont par- fois des chefs de produit chez Monoprix qui pré- sentent. Le profil de ce qu’est un bon « MC » est en train de se construire. Chaque live est dif- férent, Monoprix teste beaucoup de choses, en mettant parfois un budget sur un influenceur, parfois plus en média. Pour Diaa Elyaacoubi (Monnier Frères), la quali- té et l’efficacité sont à mesurer sur une longue période, pas uniquement lors de l’événement. Ce qui fait un bon influenceur, c’est la qualité du contenu d’une part et son adéquation avec la marque d’autre part: les audiences sont très ci- blées et très segmentées, il n’y a pas d’influen- ceur “mass market”. Il y a un vrai séquençage de la communication en amont à mettre en place. Le teasing doit être fait au moins 5 jours avant, puis au plus proche de la date et le jour J, avec les mécanismes de type live des coulisses de la vente et compte à rebours, mais aussi envoi de SMS et travail de reveal autour du contenu. Pour construire l’audience, la clientèle du site est la plus facile à capter, mais il faut bien orienter le client le jour du live. Pour Monnier Frères, le CRM est important mais pas suffisant, et l’acquisition payante n’est pas très promet- teuse, il vaut mieux miser sur la qualité de la communauté de l’influenceur. Pour Reworld, cette construction passe d’abord par une phase de pré-inscription puis l’envoi de push notifica- tion aux contacts obtenus. Il est intéressant de travailler en « vente privée » et de collecter une base de contacts qui peut être sollicitée après le live, en replay et shoppable content mais aussi pour leur proposer des offres complémentaires, pour aller chercher le ROI en parlant à des com- munautés captives, comme cela a été fait ré- cemment sur l’opération Steampod. Au-delà des mécanismes de construction d’audience, c’est l’offre elle-même qui a une influence considé- rable sur le trafic, et en particulier le prix, l’ex- clusivité et l’événementialisation. Il est déjà arrivé que Reworld refuse d’être associé à des opérations dans lesquelles l’offre était stric- tement la même que ce qui est disponible au quotidien sur le site e-commerce de la marque. Pour Diaa Elyaacoubi, CEO de Monnier Frères, il faut prendre garde à ne pas tomber dans le même travers que la Chine, où les réductions de prix ont été un driver excessivement impor- tant, avec des petites marques alimentant une tendance aux promotions massives et flash sales. En Europe, on ne prend apparemment pas cette direction,le liveshoping s’orientant plus vers le lifestyle et l’entertainment, avec une attention à la qualité des contenus. Les « En Chine les plateformes sont totalement intégrées, il n’y a plus à se poser la question des fonctionnalités. » Dia Elyaacoubi, Monnier Frères
- 25. focus • Cette session animée par Tiphaine Masurel a eu lieu le mercredi 6 octobre 2021 en visioconférence. • Avec Diaa Elyaacoubi, CEO de Monnier Frères, Maud Funaro, Directrice de la transformation de Printemps, Jeremy Parola, Directeur des activités numériques de Reworld Media, Hélène Thomas, Directrice de la Transformation et de l'Expérience Client omnicanale de Monoprix. •Compte-rendu rédigé par Tiphaine Masurel. audiences recherchent plus l’exclusivité et l’authenticité. Les plateformes multi-marques, selon Monniers Frères, peuvent être un support formidable pour encourager la richesse et la diversité de ces contenus et augmenter la désirabilité. Il n’y a néanmoins pas de recette miracle pour créer du trafic, l’audience vient pour passer un bon moment, apprendre quelque chose, rencon- trer des gens... le live est un outil de commu- nication. Hélène Thomas (Monoprix) ajoute que son aspect conversationnel est essentiel: chez Sarenza c’est d’abord le chat qui a été utilisé avant de progresser naturellement vers le live. Pour mesurer le succès, le 1er critère est bien sûr souvent le chiffre d’affaires généré mais l’acqui- sition client et la création de comptes est éga- lement importante, car on peut ainsi construire une base de clients fidèles. Les jeux-concours avec opt-in et les pré-inscirptions sont à ce titre des outils intéressants. Pour Maud du Printemps, l’objectif des 1ers lives était plutôt de faire connaître le site, encore assez récent, ainsi que le service de personal shopping qui y est proposé, et de générer du contenu de qualité pour le site. L’idée est d’instaurer un rendez-vous régulier, de créer un vrai contenu. C’est donc une démarche plus centrée sur l’image de marque et la création de contenu que sur le chiffre d’af- faires exclusivement. PENSER L’INTERACTIVITÉ Pour fonctionner, la mise en place de live shop- ping, qui a un impact sur toute l’entreprise, doit être stratégique et portée par la direction. Il faut en permanence tester et analyser. Le live shopping est le fruit d’un véritable changement à la fois technologique et générationnel, à la croisée des mutations du commerce et du di- vertissement. Toutes les marques vont finir par développer leur canal live, que ce soit en propre ou en s’appuyant sur des plateformes. Pour maximiser ses chances de succès, il faut aussi penser le contenu dans son interactivité dès le départ, se souvenir que la participation de l’audience est essentielle et poser tout au long du live des « jalons d’interactivité » avec des quizz, des jeux-concours,… Il est important de donner des rôles, il arrive parfois qu’il y ait 3 ou 4 animateurs avec des rôles différents car il n’est pas possible de tout faire en même temps, et l’audience doit pouvoir identifier clai- rement les messages. C’est ainsi que Monoprix distingue maintenant la présentation de la voix off, qui prend les questions de l’audience. Pour Diaa Elyaacoubi de Monnier Frères, l’avenir du live shopping réside comme pour toute créa- tion de contenu dans la faculté à bien raconter des histoires, c’est un métier de storyteller, avec du suspense, et une relation particulière à l’au- dience puisque interactive. Dans les prochaines années, le live sera proba- blement utilisé pour tous les temps forts du ca- lendrier de la marque, non seulement les ventes et promotions mais aussi les showrooms, la présentation des collections, les communiqués de presse… Une autre tendance à surveiller sera l’utilisation des NFT et la mode et plus gé- néralement la consommation dans les univers virtuels comme Fortnite, qui devrait s’amorcer dès 2022 !
- 26. 24 Les réseaux sociaux dans le parcours client Les réseaux sociaux sont présents à chaque étape du parcours client: de l’acquisition à la fidélisation, en passant par l’e-commerce et le service client. Canal d’acquisition et de construction d’image incontournable, ils sont de plus en plus le lieu de la transaction elle- même ou de l’utilisation du service proposé. La gestion de la relation client à ciel ouvert est certainement l’étape de la relation client où les réseaux sociaux sont le plus délicat à gérer: à l’heure où les volumes de demandes et de commentaires potentiels sont démultipliés, faut-il des comptes dédiés au service client ? Faut-il laisser les community manager modé- rer, ou créer des équipes de modérateurs spéci- fiques ? Comment utiliser les réseaux sociaux pour construire des communautés autour de sa marque, segmenter et fidéliser ses clients ? Quelles sont les tendances remarquées par les participants pour l’année à venir? Aline Geffroy a rejoint Saint-Gobain en 2019 et a commencé par accompagner les différentes équipes et marques dans le développement de leurs contenus digitaux en favorisant l’ali- gnement des messages entre les pays. Saint- Gobain va clairement vers plus de digitalisa- tion, c’est une tendance de fond, qui est vue comme un levier de performance, y compris en point de vente, et les réseaux sociaux sont un outil central de ce processus de digitalisation. Le digital est aussi un outil essentiel pour le recrutement et la marque employeur dans la “guerre des talents” que se livrent les grandes entreprises: la compétition est intense, et les candidats sont eux aussi une forme de client à aller chercher. Pour Olivier Pelvoizin, chez Pôle Emploi, les réseaux sociaux sont avant tout un moyen de faire connaître et reconnaître l’offre proposée, aussi bien auprès des candidats que des élus, journalistes ou influenceurs, en utilisant tous les canaux adaptés. Pôle Emploi a ainsi été le premier service public à s’investir sur TikTok et y a démontré sa capacité à capter l’attention. Un autre exemple récent d’utilisation des ré- seaux sociaux est la campagne #tousmobili- sés, qui cherche à améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi en s’appuyant sur les entreprises. wPour l’acquisition et le recrutement client, Saint-Gobain travaille à la fois sur des problé- matiques BtoC et BtoB. Par exemple en BtoC, la plateforme La Maison Saint-Gobain met en relation des particuliers avec des artisans. Elle a été lancée il y a 2 ans, dans un contexte de concurrence intense avec des services simi- laires développés par EDF ou Leroy Merlin. Il y a donc un gros enjeu d’acquisition, qui s’appuie sur des campagnes réseaux sociaux, en parti- culier Instagram et Facebook, qui ont permis d’attirer du trafic vers le site. En début d’année, la plateforme a attiré plus d’un million de visi- teurs uniques. Les réseaux sociaux permettent de générer des impressions de manière à la fois massive et qualifiée. En Chine, pour Saint- Gobain l’utilisation des réseaux est encore plus poussée : 100 % du business s’y fait via WeChat, tandis que Weibo permet de travailler la notoriété et l’engagement. « Les réseaux sociaux sont avant tout un moyen de faire connaître et reconnaître l’offre proposée, aussi bien auprès des candidats que des élus, journalistes ou influenceurs, en utilisant tous les canaux adaptés. » Olivier Pelvoizin, Pôle emploi
- 27. focus
- 28. 26 Pour Pôle Emploi, il s’agit plutôt d’acquérir de l’attention que des clients. Avec le hashtag #missionemploi sur TikTok réunissant quelques partenaires, les conseillers présentent les ser- vices destinés aux jeunes. Les 34 vidéos dé- diées ont généré plus de 3 millions de vues en six mois et en sont à plus de 48 millions de vues aujourd’hui pour l’ensemble. C’est, en un mois, plus que le trafic annuel de l’Emploi Store, et en termes d’image les retours sont également très positifs. Le contenu doit être adapté à chaque canal. Sur Youtube, Pôle Emploi a créé la chaîne thé- matique « On est là pour vous » avec une ver- sion en créole pour la Guadeloupe. Le tutoriel « comment utiliser les réseaux sociaux pour sa recherche d’emploi » est un de ceux qui ont le plus de succès. AU-DELÀ DE L’ACQUISITION Les conseillers eux-mêmes sont ambassa- deurs de Pôle Emploi sur les réseaux sociaux. Une grande partie des 55 000 conseillers sont sensibilisés aux réseaux sociaux et commu- niquent au quotidien concernant les services de Pôle Emploi. Ils peuvent par exemple com- muniquer autour de l’application « Mes offres » sur le site de Pôle Emploi, le 3e jobboard en France qui restait pourtant moins connu, et gé- nère maintenant 7 à 8 millions de visites par mois. Il y a au total aujourd’hui 32 services en ligne Pôle Emploi. La majorité a été testée, incubée et ajoutée au site une fois leur utili- té démontrée. En ce moment par exemple, le portail « Mobiville » s’adresse à ceux qui sou- haitent changer de région, avec un moteur de projet personnel en fonction des marchés lo- caux de l’emploi et de critères de qualité de vie. C’est un vrai outil de promotion pour les villes moyennes. Au-delà de l’acquisition, les réseaux sociaux sont aussi bien souvent le lieu même de l’achat ou de l’utilisation du service. Pour Pôle Emploi, l’objectif est de promouvoir l’utilisation de ses services sur les plateformes de réseaux sociaux. En tant qu’acteur du secteur public, Pôle Emploi a néanmoins besoin de respecter une certaine transparence, sécurité et équité, en rendant ses services vraiment accessibles à tous. Il y a ainsi des sites sur lesquels les RH peuvent développer des espaces dédiés à leur entreprise, avec des tests en ligne par exemple, qui leur permettent de capter des candidats qu’ils n’auraient pas forcément pu toucher ail- leurs, par exemple des profils atypiques. Il est important que cela se fasse dans un espace accessible à tous. Pour Saint-Gobain, il s’agit plus de génération de leads que de transactions, avec par exemple des contenus de type « How to » sur LinkedIn ou Youtube, des webinars et formulaires à com- pléter. Facebook est un levier incontournable pour le retargeting. TikTok s’est montré per- formant pour une campagne de recrutement d’alternants et de stagiaires, par rapport aux autres canaux elle a généré à la fois plus de trafic et plus d’efficacité, avec un CPC moins élevé. C’est le résultat de l’utilisation du bon réseau pour la bonne cible. Pour Pôle Emploi, le retour d’image de la campagne Tik Tok a aussi été très bon, et a participé à créer un taux de confiance chez les jeunes plus de 4 fois supé- rieur à celui de la tranche d’âge des seniors. L’étape du parcours client la plus délicate sur les réseaux sociaux est sans doute celle du service après-vente. Les clients mécontents peuvent se tourner vers les comptes réseaux sociaux de l’entreprise, les commentaires né- gatifs peuvent être faits par des profils ano- nymes, la modération est un enjeu important et chronophage. Chez Saint-Gobain, on envoie d’abord un mes- sage privé avant de le transférer à l’équipe ou au pays concerné, et les équipes locales ont des services clients en bonne et due forme. Aujourd’hui le volume des flux est encore gé- rable mais a tendance à augmenter à mesure que les artisans se digitalisent. Il n’y a pas d’équipe de modérateurs dédiée, des messages standardisés ont été développés car ce sont souvent les mêmes problématiques qui re- viennent, et l’ensemble reste assez fluide. La prochaine étape sera de suivre les messages reçus et d’utiliser les informations précieuses qu’ils apportent. Pour Pôle Emploi, les cadres s’engagent à « Augmenter la transparence limite les mécontents et donc les risques de commentaires négatifs sur les réseaux. » Olivier Pelvoizin, Pôle emploi
- 29. focus « En Chine, 100% du business de Saint-Gobain se fait via WeChat, tandis que Weibo permet de travailler la notoriété et l’engagement. » Aline Geffroy, Saint Gobain • Cette session animée par Tiphaine Masurel a eu lieu le mercredi 13 octobre 2021 en visioconférence. • Avec Aline Geffroy, global social media director de Saint-Gobain et Olivier Pelvoizin, directeur du digital, de l’expérience utilisateur et de l’open innovation de Pôle emploi. •Compte-rendu rédigé par Tiphaine Masurel. pouvoir tenir la ligne de Pôle Emploi sur leurs propres comptes de réseaux sociaux et à répondre aux questions et commentaires. Augmenter la transparence limite les mécon- tents et donc les risques de commentaires né- gatifs sur les réseaux. Par exemple, auparavant la démarche à suivre pour faire une réclama- tion était difficile à trouver en ligne. Depuis que l’information a été plus mise en avant sur le site, les commentaires négatifs ont été divi- sés par 5 et le besoin de modération est beau- coup plus faible. FIDÉLISATION ET SEGMENTATION Au-delà des insatisfaits, on observe aussi une hausse des commentaires idéologiques, en particulier sur Facebook, ils arrivent à chaque fois qu’une campagne de reach est mise en place. Dans ce cas, Saint-Gobain prend le par- ti de les masquer. Chez Pôle Emploi, une veille et des alertes sont en place, et elles sont utiles lorsque certains sujets peuvent être mal inter- prétés ou déformés, il faut être très réactif. Récemment, un événement sportif a été perçu comme un outil de sélection alors qu’il n’en était pas un, et a conduit Pôle Emploi à pré- senter des excuses, et le renforcement de la sécurité en agence a été lié par les médias à la réforme de l’assurance chômage, alors qu’il n’y avait aucun lien direct. Pôle Emploi a reçu le prix de l’association de la relation client pour les tutoriels sur l’inscription, l’approche utilisateur a été totalement revue. Les com- mentaires sur les réseaux sociaux sont de vrais capteurs de la qualité de service. De l’IA com- mence même à être intégrée à la modération. En matière de fidélisation, les réseaux sociaux permettent une segmentation très fine. Pôle Emploi parle ainsi non seulement aux inscrits, mais aussi à l’ensemble de la population, qui fait face à un défi sociétal considérable : 80 % des métiers dans 10 ans n’existent pas encore aujourd’hui. Un des enjeux est donc d’accompa- gner l’ensemble des citoyens à anticiper. Chez Saint-Gobain, les comptes du groupe sont bi- lingues français / anglais. Mais les audiences internationales ne s’intéressent pas à la même chose. Au sein de chaque réseau social, le positionnement est très précis et spécifique, découlant d’un gros travail de rationalisation et de ciblage. De même, chaque membre du Comex a sa propre plateforme de marque per- sonnelle. Il y a eu un travail très important sur le ciblage et l’engagement, sur le choix de l’ob- jet et de la temporalité. Enfin, dans les tendances à noter, Olivier Pelvoizin relève la réalité virtuelle et les se- rious games, une présence sur des réseaux de gamers, avec des jeux en ligne, démontrant qu’on peut se révéler en tant que candidat à travers le gaming. Saint-Gobain a d’ailleurs utilisé l’an dernier un escape game d’orientation qui arrivait sur une offre d’emploi. Avec la réalité virtuelle et une expérience immersive, Saint-Gobain a aus- si montré comment se déroulait le processus de fabrication, l’immersion permettant de fa- voriser la projection. De même, une applica- tion d’aide pour les artisans intègre la 3D pour l’éco-conception d’habitations. Il n’y a donc pas un parcours client mais de multiples cibles, et les réseaux sociaux per- mettent justement de démultiplier et person- naliser les messages et les approches.
- 30. 28 L’audio s’invite sur les plateformes sociales
- 31. focus L'audio est en plein boom! Les auditeurs plébis- citent la possibilité d'écouter ce qu'ils veulent, où ils veulent et quand ils veulent, et de pou- voir apprendre ou se divertir pendant qu'ils sont en train de faire autre chose, un footing ou la cuisine. Jusqu'à présent, ce développe- ment passait beaucoup par les podcasts, dont la distribution sous forme de flux RSS ne per- met pas vraiment d'intégrer de fonctionnalités sociales. De nouvelles plateformes se créent, telle que Clubhouse qui a connu un moment de gloire pendant les confinements, et tous les ré- seaux sociaux travaillent le sujet, de Facebook à Youtube en passant par Twitter et LinkedIn. Où en est-on de ces développements ? Courts ou longs, user generated ou produits par des médias, live ou délinéarisés, quels sont les for- mats, les usages et les attentes des auditeurs ? Comment s'emparer de ces différents formats, sur quelle plateforme faut-il commencer et quelle place donner à l'audio social dans sa communication de marque ? FONCTIONNALITÉS LIMITÉES Les intervenants de cette session sont tous des passionnés des formats audio et plus particu- lièrement du podcast. Xavier Yvon était jour- naliste à Europe 1, récemment en tant que cor- respondant aux Etats-Unis où il a pu découvrir de nombreux podcasts nord-américains, avant de rejoindre L’Express pour développer un élé- ment-clé de sa nouvelle formule, « La Loupe », un podcast de décryptage de l’actualité repre- nant un sujet par jour, à la manière du Daily du New York Times. Nina Cohen était une grande consommatrice de podcasts, en particulier des formats documentaires, et apprécie le fait qu’ils soient à ce point un nouvel espace de parole, libre et plus représentatif de la socié- té que les médias traditionnels. Elle a rejoint le Paris Podcast Festival dès ses débuts, une association organisant chaque année un grand événement autour du podcast, à la fois pour les professionnels et pour les fans et communau- tés s’intéressant à des podcasts en particulier. Enfin, Thomas Leroy a rejoint Condé Nast France pour développer la vidéo mais a trouvé dans le podcast un média moins coûteux à développer et plus facile à concevoir avec les équipes de journalistes présentes. Le social est d’abord un canal de promotion essentiel de l’audio digital. Les plateformes de podcasts ont des fonctionnalités limitées pour découvrir, partager ou recommander des podcasts. Les réseaux sociaux, parce qu’ils n’in- tègrent pas la lecture de flux RSS, ne sont pas encore des lieux de consommation de podcasts importants, en revanche ils viennent compen- ser partiellement ce manque de fonctionnalités sociales de plateformes de podcasts. Pour les podcasts de Condé Nast France, la politique est à l’hyper-distribution, les formats développés sont présents partout et mis en avant sur les sites du groupe et sur les principaux réseaux, en particulier Twitter et Instagram. Du fait de la force de la chaîne Youtube de GQ, Youtube est de manière assez inhabituelle pour un podcast le canal d’écoute essentiel, capitalisant sur la force de la communauté. Comme formats pour la promotion sur les ré- seaux sociaux, beaucoup utilisent les extraits sous forme de clips fournis automatiquement par les plateformes d’hébergement de pod- casts comme Audiomeans ou Acast. Condé Nast France préfère développer ses propres formats en interne, pour rester en ligne avec sa charte éditoriale. Chaque marque promeut ses pod- casts sur toutes les communautés du groupe, pour ses podcasts éditoriaux mais aussi pour les podcasts faits pour des marques. Pour L’Express, il n’y a pas d’accord de promotion particulier avec telle ou telle plateforme, les podcasts sont également promus partout quand ils sont acces- sibles aux non-abonnés, comme c’est le cas pour « La Loupe ». Apple Podcasts représente une part importante des écoutes, de même que Podcast Addict pour les utilisateurs d’Android. Aucune de ses plateformes n’intègre des outils de promotion très pratiques, ne serait-ce que parce qu’elles ne sont pas utilisables par tous les utilisateurs de smartphones. Il est bien sûr possible d’utiliser un « Linktree » ou arbre à liens, mais cela multi- plie les frictions, avec un clic supplémentaire et des utilisateurs qui ne comprennent pas toujours comment l’utiliser. L’Express teste régulièrement les renvois vers une seule plateforme, mais il manque clairement un vrai outil de promotion sociale. Les réseaux sociaux principaux utilisés par L’Express pour la promotion de ses podcasts « Il est impossible de lancer un podcast sans les réseaux sociaux, car la notion de communauté est fondamentale. » Nina Cohen, Paris podcast Festival
- 32. 30 sont Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn. Le groupe NRJ rencontre les mêmes probléma- tiques, et, comme L’Express, alterne entre un ren- voi unique vers son site et un « Linktree » avec les options d’écoute vers toutes les plateformes. Pour Nina Cohen, il est en effet impossible de lancer un podcast sans les réseaux sociaux, car la notion de communauté est fondamentale. Il faut créer un univers autour du podcast et géné- rer des recommandations. Pour certains acteurs du podcast comme Arte Radio, Youtube repré- sente une part importante des écoutes, mais les écoutes de Youtube, qui n'intègrent pas les flux RSS, ne peuvent pas à ce jour être comptabili- sées comme des audiences de podcasts moné- tisables. Le Paris Podcast Festival a d’ailleurs lancé un podcast avec La Gaîté Lyrique, « Il était des voix », et a donc été directement confronté aux problématiques de promotion. Le “cross- post” Instagram permet de cumuler les vues et s’est révélé un outil efficace, mais il reste com- pliqué de garantir l’émergence d’un podcast. PROMOTION ET RECOMMANDATION Ressortir des épisodes et recontextualiser en fonction de l’actualité est une des tech- niques qui peuvent fonctionner. L’Express avait par exemple réalisé un épisode de La Loupe sur le métaverse et l’a ressorti au moment où Facebook a mis le sujet au centre de l’actualité. Youtube a l’avantage de permettre un bon réfé- rencement en remontant très bien sur Google. Faut-il des formats courts pour les réseaux so- ciaux ? Les réseaux sociaux tentent de plus en plus de devenir un lieu de consommation de l’audio et non seulement un outil de promotion et de recommandation, ce qui est peut-être ra- lenti par des questions de format. Les usages sont en effet différents. Les auditeurs de pod- cast recherchent une écoute immersive, sans écran, qui leur permet en général de faire autre chose en même temps, et pousse à privilégier des formats un peu longs pour ne pas avoir à rechercher un nouveau contenu et relancer une écoute trop souvent. À l’inverse, sur les réseaux sociaux, le « scroll » face à son écran favorise les contenus plus courts et « snackables », sou- vent même regardés sans le son, ce qui est un peu paradoxal pour un podcast ! Sur les contenus audio de L’Express, on distingue la version audio du journal, exclusivement ré- servée aux abonnés et écoutable sur l'applica- tion L’Express, à l’exception de 2 ou 3 articles par semaine mis à la disposition des non-abon- nés sur les plateformes de podcasts, et les po- dcasts comme « La Loupe », accessibles à tous. La version audio du journal est lue par des co- médiens et enregistrée juste après le bouclage du journal, très peu de temps avant sa publi- cation. Cette version audio du journal est un nouvel usage, auquel pour le moment seule une petite partie des abonnés s’est convertie, mais ceux qui l’ont fait sont très fidèles et en- gagés. Cet usage est beaucoup plus développé aux Etats-Unis, où toutes les publications sont disponibles en version audio sur Apple News + par exemple. Pour Condé Nast, les formats au- dio courts ne sont pas encore répandus, les épisodes de podcasts ont des durées au moins égales à 10 minutes. L’économie du podcast telle qu’elle existe aujourd’hui, avec des formats pre-roll, n’est pas forcément adaptée à des for- mats très courts, mais des initiatives intéres- santes ont été remarquées par Nina récemment, avec des formats proches de ceux des mémos vocaux. La Radiotélévision Suisse a ainsi lan- cé « Le short », envoyé sur une chaîne Whatsapp. Pour NRJ, les formats courts sont en pleine as- cension, il s’agit effectivement d’une pratique un peu différente, mais ils sont un moyen effi- cace de construire une audience et facile à pro- mouvoir sur les réseaux sociaux. Le format court de « Lalala », le podcast d’NRJ sur l’amour, a très bien fonctionné cet été, et « 3615 Podcast » avec Marine Baousson, un podcast d’humour, était bien adapté à son format entre 3 et 5 minutes. Les réseaux sociaux, lieux du live audio ? L’audio en direct et en ligne a connu un moment fort avec le développement de Clubhouse l’an der- nier, mais la tendance est depuis assez claire- ment retombée. Les intervenants partagent le constat que le live, n’étant pas écrit et monté comme un podcast, avait tendance à délayer beaucoup les contenus, et qu’on ressortait sou- vent d’une room Clubhouse avec l’impression qu’une heure aurait pu être condensée en 10 mi- nutes. Condé Nast a plutôt utilisé des enregis- trements d’événements pour en tirer une adap- tation audio: les conférences du Vogue Festival ont été adaptées en masterclasses sur Majelan. Cela permet de conserver la caractéristique d’un média à la demande, facteur clé du succès des podcasts, qui est que l’on peut écouter ce contenu où et quand on veut. Twitch est le réseau de référence pour le live, le studio de podcasts Binge Audio a par exemple
- 33. focus • Cette session animée par Tiphaine Masurel s’est déroulée mercredi 3 novembre 2021 en visioconférence. • Nina Cohen, directrice adjointe du Paris Podcast Festival, Thomas Leroy, video & podcast development chez Condé Nast France, Tiphaine Masurel, directrice de la stratégie digitale du Groupe NRJ et Xavier Yvon, rédacteur en chef et présentateur de « La Loupe » à L’Express. •Compte-rendu rédigé par Tiphaine Masurel. Il reste encore à généraliser l’écoute du podcast, en particulier auprès de deux groupes, les adolescents et les plus de 50 ans. organisé 24 heures de live pour présenter sa nouvelle saison. Le live est un outil puissant pour événementialiser, créer un rendez-vous, en- gager et faire réagir sa communauté, mais les événements permettent de remplir ces mêmes objectifs, comme l’a fait Binge avec Binge en Scène, une vraie rencontre avec le public de ses podcasts. LE SOCIAL COMME OUTIL D’INTERACTIVITÉ AUDIO Le podcast est généralement un format assez travaillé et produit, il n’est pas si compatible avec le live. Pour interagir avec sa communau- té, des enregistrements événementialisés, en public, peuvent être organisés. Les possibilités de recevoir des commentaires et suggestions via les plateformes de podcasts sont extrême- ment limitées, cette interaction avec l’au- dience est donc un autre point sur lequel les réseaux sociaux ont un rôle important à jouer. Les thématiques autour du développement personnel en particulier pourraient être beau- coup plus interactives car ces podcasts ont un côté très tutoriel. Un podcast comme “Le coeur sur la table” essaie d’intégrer régulière- ment les retours de sa communauté. Pour faire participer l’audience au contenu, NRJ utilisait des courriers de lecteurs dans la saison 1 de « Lalala » et est en train de développer un épisode interactif du podcast pour enfants de Chérie FM « Conte-moi l’aventure ! » dans lequel l’interactivité passe directement par la voix et l’audio, permettant à l’enfant de choisir l’évolu- tion de l’histoire. Nina Cohen cite des plateformes de podcasts récentes créées autour de cette idée d’inte- ractivité, par exemple Eeko ou Tumult, permet- tant des réactions en direct et à un instant précis de l’épisode, comme on peut le faire sur Soundcloud, quand les plateformes tradi- tionnelles de podcasts ne permettent que les commentaires sur le podcast en général, sans pouvoir les lier à un épisode en particulier, en- core moins une seconde précise de celui-ci. La plateforme d’hébergement Anchor, rachetée par Spotify, permettait cette fonctionnalité, et Spotify est en train de le développer. Un autre exemple d’intégration de la communauté est de citer dans un épisode soit certains commen- taires comme le fait Rosa Bursztein dans son podcast « Les mecs que je veux ken » soit les noms des donateurs contribuant via le crowd- funding au financement du podcast comme le fait le podcasteur Julien Cernobori. Une communauté engagée est en effet très liée aux modèles de podcast payant. Cela passe aujourd’hui beaucoup par le financement par- ticipatif, avec par exemple des épisodes ex- clusivement réservés à ceux qui contribuent sur Patreon, mais les plateformes de podcasts pensent toutes à développer des fonctionnali- tés pour des modèles payants, comme l’a fait Apple Podcasts récemment. Le podcast d’Europe 1 à succès « Hondelatte raconte » a ainsi lancé sa chaîne payante sur Apple Podcast. Pour le moment les nombres d’abonnés semblent assez bas, le public n’est peut-être pas encore prêt à ce genre d’initiative. Il reste encore à généra- liser l’écoute du podcast, en particulier auprès de deux groupes, les adolescents et les plus de 50 ans. Réserver des podcasts à ses abonnés payants, comme le font Spotify et Deezer avec leurs Originals, est un autre pas vers la plate- formisation. Spotify, Deezer et Amazon Music sont très engagés dans cette voie, et des envi- ronnements fermés et spécifiques à certaines cibles comme la jeunesse se développent éga- lement. Élargir l’audience en touchant une cible plus grand public, avec des formats de grande qualité sur des thématiques de divertissement, est aussi la stratégie du groupe NRJ sur le sujet des podcasts.
- 35. engager ses collaborateurs Deux aspects importants de la communication interne ont retenu notre attention dans ce cycle consacré à l’engagement des collaborateurs. Liberté d’expression des salariés, e-réputation, employee advocacy… Nos intervenants ont partagé analyses et retours d’expériences ! COLLABORATEURS
- 36. 34 cycle #1 Quand la comm’ interne devient un levier stratégique CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • Notoriété, recrutement, gestion de l'e réputation… L’engagement des collaborateurs replace la comm’ interne au cœur des discussions stratégiques de l’entreprise. • La gamification est un levier efficace pour renforcer l’investissement des employés. • L'accompagnement individuel du collaborateur est plébiscité face aux formations collectives.
- 37. engager ses collaborateurs Informer, promouvoir, fédérer… aujourd’hui, plus que jamais, la comm’ interne s'inscrit pleine- ment dans la stratégie d'entreprise. Quelles méthodes pour garantir une communication in- terne efficace et cohérente ? Quels sont les ca- naux de diffusion privilégiés ? Comment impli- quer et accompagner ses collaborateurs dans cette démarche ? Les objectifs de la communication interne va- rient en fonction de l’entreprise. Pour le groupe Accor, l’objectif va être tout d’abord de valoriser les salariés de l’entreprise. « La parole de l’em- ployé a plus de valeur que celle d’une marque », résume Alexander Chupick, social media ma- nager et employee advocacy leader du groupe Accor. À l’inverse d’un fonctionnement top-down, le défi est de faire remonter la voix des collabo- rateurs. Pour cela, l’accès à l’intranet a été dé- ployé auprès d’une grande partie des salariés. Doriane Houssais, social media et business lead de Microsoft France estime également que la communication interne a tout intérêt à inci- ter les salariés à s’exprimer sur les réseaux so- ciaux: « nos employés sont des experts, des gens brillants. Ils sont les plus légitimes pour parler de ce qu’ils font. » Pour VINCI Energies, la communication in- terne a essentiellement pour but de fédérer les 83 800 employés du groupe, présents dans 55 pays afin de renforcer leur sentiment d’appar- tenance à l’entreprise. « Lors du premier confi- nement, qui a été difficile à appréhender, les outils mis en place par la communication ont permis de garder le lien avec les collabora- teurs », précise Roseline Mouillefarine, head of contents pour VINCI Energies. DÉDRAMATISER LA PRISE DE PAROLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX Un challenge qui nécessite également de s’adapter aux contextes culturels locaux. « La manière de communiquer au Brésil et en Allemagne, par exemple, est très différente. Culturellement, les Brésiliens ont une capacité à partager qui est très élevée. A contrario, la prise de parole en Allemagne ne fonctionne que si elle est organisée en amont », témoigne Cathy Vigier, senior communication manager pour VINCI Energies. Les sensibilités politiques et re- ligieuses doivent aussi être prises en compte : « Les approches européennes et américaines en ce qui concerne la problématique de l’appro- priation culturelle, par exemple, ne sont pas les mêmes. Il faut donc adapter la communication européenne quand elle va vers les États-Unis », abonde Alexander Chupick (Accor Group). Valoriser les employés et les fédérer. À cela s’ajoute l’opportunité pour l’entreprise, à travers la communication interne, de répondre à des ob- jectifs de notoriété. Benoit Prevost, Spécialiste social media et employee advocacy pour l’édi- teur de logiciel Sidetrade, illustre : « la plupart des collaborateurs de Sidetrade ont un profil senior et comptent donc un réseau important, notamment sur LinkedIn. L’enjeu de la commu- nication interne est donc de les convaincre de prendre la parole sur leurs réseaux sociaux pour parler de l’entreprise. » Cet enjeu est effectivement au cœur de nom- breuses stratégies de communication. « Il faut réussir à dédramatiser la prise de parole sur les médias sociaux », explique Doriane Houssais (Microsoft France). Cela nécessite d’accompa- gner les collaborateurs dans ce projet : « les employés sont parfois timides et se posent des questions comme “ma démarche ne va-t-elle pas être trop narcissique ?” Notre rôle est de leur donner confiance, de leur faire comprendre que leurs messages ont une valeur pédagogique - mais parfois c’est aussi simple que de leur dire que les messages LinkedIn sont effaçables [si jamais] ! », analyse Alexander Chupick (Accor Group). Pour répondre au manque de disponibilité de salariés souvent déjà très sollicités, Doriane Houssais (Microsoft France) propose un ac- compagnement individuel et personnalisé : « Je ne maîtrise pas les sujets de fond mais je peux les aider sur la forme. Je les interroge sur le thème qui les intéresse et j’en déduis le plan de l’article qu’ils pourraient ensuite écrire. » Si la formation aux bonnes pratiques peut être réalisée ponctuellement en équipe, tous les in- tervenants préfèrent la formation individuelle pour accompagner les employés : « pour faire monter en compétence des gens qui devraient « L’enjeu de la communication interne est de les convaincre de prendre la parole sur leurs réseaux sociaux pour parler de leur entreprise. » Benoit Prevost, Sidetrade
- 38. 36 cycle partager sur les réseaux, nous les formons indi- viduellement car les newsletters et les guides ne suffisent pas », précise Alexander Chupick. « Notre rôle n’est pas de dire comment il faut faire mais de former et d'accompagner pour qu'ensuite l'animation éditoriale se fasse au plus proche du terrain avec les outils mis à dis- position », estime Roseline Mouillefarine (Vinci Energies). LA GAMIFICATION, UN LEVIER D’ENGAGEMENT EFFICACE Il existe de nombreuses plateformes permettant aux collaborateurs de partager simplement les informations. « Sociabble sert à donner la pa- role aux employés, à créer de l’engagement et à partager sur les réseaux sociaux », explique Roseline Mouillefarine (Vinci Energies). Chez Vinci Energies, la refonte de l’intranet a pris en compte cette dimension. Tous s’accordent également sur la gamifica- tion comme levier d’engagement pertinent. « La gamification est au cœur de notre stratégie de communication. Elle nous a permis de créer de l’engagement sur les réseaux sociaux : nous avons multiplié par cinq notre visibilité sur LinkedIn, explique Benoît Prévost (Sidetrade), lors du premier confinement, nous avions pro- posé à nos employés de partager une photo de leur nouveau bureau. 40 % des employés l’ont fait. » Cathy Vigier (Vinci Energies) abonde : « sur des sujets plus austères tel que la cy- ber-sécurité, nous avons pu obtenir un taux d’engagement intéressant grâce à la mise en place d’un quizz. » Face à l’avènement de ces nouveaux canaux de communication et aux enjeux de transparence des consommateurs, les intervenants relèvent l'existence d’une forte porosité entre communi- cation interne et externe. L'entreprise, à travers notamment sa communication interne, se doit plus que jamais d'ajuster l'écart entre les pro- messes et la réalité. • Cette session animée par Daniel Lemin, Responsable Réseaux Sociaux & influence chez Vinci a eu lieu le 24 mars 2021 en visioconférence. • Avec Alexander Chupick, Social Media Manager & Employee Advocacy Leader chez Accor Group, Doriane Houssais, Social Media & Business Lead chez Microsoft France, Roseline Mouillefarine, Head of contents chez VINCI Energies et Benoit Prevost, social media & employee advocacy chez Sidetrade. • Compte rendu rédigé par Martin Fort. « La parole de l’employé a plus de valeur que celle d’une marque. » Alexander Chupick, Groupe Accor
- 39. engager ses collaborateurs #2 Liberté d’ expression et e-réputation : un point juridique CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • Les chartes et clauses concernant la prise de parole des collaborateurs doivent être un outil incitatif et psychologique plus que contraignant et fondé juridiquement. • Identifier, former et accompagner les salariés qui s’expriment en leur nom ou au nom de l’entreprise sur les réseaux sociaux permet d’éviter les bad buzz et les mauvaises pratiques. • La prise de parole du collaborateur peut être juridiquement sanctionnée si elle est abusive. Chaque situation est jugée aujourd’hui au cas par cas, car le droit reste encore flou.
- 40. 38 cycle Dans un contexte où les entreprises com- mencent à encourager leurs collaborateurs à la prise de parole sur les réseaux sociaux, que ce soit dans un objectif de visibilité de la marque, de branding ou d’employee advocacy, un cadre juridique existe-t-il afin de réglementer ces prises de parole ? Quel est l’équilibre juridique entre liberté d'ex- pression et préservation des intérêts de l’entre- prise en termes d’e-réputation ? Quelle respon- sabilité peut être engagée ? Aude L’homme-Guinard, Avocate à la Cour chez Alma Avocats, nous rappelle le flou juridique très important autour de cette problématique: « face à lenteur de la justice et à la rapidité des usages des réseaux sociaux, peu de textes per- mettent d’encadrer la prise de parole des col- laborateurs que ce soit dans le code du travail ou au niveau de la jurisprudence. » Les conflits reviennent à l’appréciation de chaque juge, le tout est « d’essayer de trouver la juste mesure entre liberté d’expression, intérêt du salarié et intérêt de l’employeur », selon Christophe Calvao, Avocat en droit social. QUAND LE SALARIÉ S’EXPRIME AU NOM DE L’ENTREPRISE Peut-on envisager la prise de parole comme une fonction supplémentaire ? Pour Christophe Calvao, « tout dépend du type de salarié : la prise de parole s’envisage plus aisément pour les collaborateurs spécialisés dans la com- munication, ou s’il est à la tête d’un poste de responsable d’une des activités de l’entreprise. » Quant à ajouter une mission supplémentaire précisant que l’employé se doit de communi- quer positivement à propos de l’entreprise et ses produits, cela est possible, mais « cela doit être précisé dans le contrat de travail ou dans la fiche de poste. » Néanmoins, cela ne peut pas être imposé ni puni, ce qui serait une limite à la liberté d’expression : « la clause est davantage psychologique que juridique. » L’entreprise peut-elle préciser cette clause dans un contrat ? « La seule façon d’inciter à la prise de parole non spontanée est de se baser sur le principe du droit des contrats repris par le code du travail qui stipule que le contrat doit être exécuté de bonne foi » (art L 1221-1), pré- cise Aude L’homme-Guinard. Mais le code du travail permet également d’encadrer voire de restreindre la communication : « nul ne peut ap- porter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but re- cherché » (Article L1121-1). Quant à la mise en place de chartes incitatives, il s’agit de « trouver un équilibre entre l’intérêt de l’entreprise et le fait de ne pas poser de li- mites trop importantes à la liberté d’expres- sion », avance Christophe Calvao. Un véritable travail de rédaction est nécessaire, afin d’ex- primer les bonnes pratiques sans interdire : « il vaut mieux être prudent sur la rédaction de ce type de charte et rester dans une démarche in- citative et explicative. » LA FORMATION DES COLLABORATEURS Au-delà de la rédaction de chartes, les forma- tions semblent essentielles : « il est possible d’organiser des temps d'échanges et de for- mations sur le bon usage des réseaux sociaux. Cela peut constituer un argument pour appuyer une éventuelle sanction juridique », recom- mande Aude L’homme-Guinard. Par exemple, le programme ambassadeur n’est pas fondé juridiquement, mais permet de conseiller aux usagers les bonnes pratiques à adopter et les mauvaises pratiques à éviter sur les réseaux sociaux. « Le but n’est pas d’interdire, mais de faire comprendre aux utilisateurs comment mieux communiquer sur le web, et éviter les bad buzz. Il faut encourager les ambassadeurs à remonter les problèmes auprès de la direc- tion dans un premier temps. Cela leur permet de mieux communiquer en amont et de valori- ser davantage l’entreprise. Le rôle de l’ambas- sadeur peut permettre d’éviter de potentielles critiques. » « La notion de responsabilité s’ancre dans une forme d’urgence contrainte qui semble être beaucoup plus importante aujourd’hui que naguère, notamment concernant les questions environnementales. » Jean-Maxence Granier, Think-Out
- 41. engager ses collaborateurs Que dit la loi ? « La jurisprudence sera sûrement amenée à préciser sa position sur ce point au regard de certaines affaires récentes », explique Christophe Calvao. Il est difficile de tracer une frontière entre la prise de parole d’un sa- larié dans un cadre privé et dans le cadre de l’entreprise : « même lorsque le nom de l’entre- prise n’est pas employé dans la bio d’un compte personnel, il est facile d’identifier une personne comme salariée d’une société grâce aux don- nées personnelles disponibles sur Internet. » QUAND LE SALARIÉ S’EXPRIME EN SON NOM Néanmoins, rappelle Aude L’homme-Guinard, « l’employeur n’a pas le droit de sanctionner ou de licencier un employeur pour un fait qu’il au- rait commis dans un cadre privé, sauf si cela trouble le fonctionnement de l’entreprise. » Mais il reste compliqué de sanctionner lorsque la prise de parole sur l’entreprise touche à sa ré- putation et non à son activité. La limite au droit d’expression posée par la ju- risprudence est définie par l’abus, ce que dé- taille Aude l’Homme-Guinard : « la prise de pa- role du salarié peut être sanctionnée si elle est abusive. Si c’est une plainte qui se fonde sur un fait objectif, ce n’est pas un abus. Il faut que les doléances soient bien fondées. » Mais qu’est-ce que l’abus ? Chaque situation est jugée au cas par cas, car le droit reste très flou sur cette problématique. Concernant la mention « mes tweets n’engagent que moi », Christophe Calvao précis : « les tweets n’engagent en principe que la personne qui les rédige. On peut toutefois considérer d’un point de vue pratique et médiatique que plus le sala- rié est haut placé, plus les tweets sont suscep- tibles d’engager son employeur. Juridiquement toutefois, la seule façon pour un tweet d’enga- ger plus que l’auteur, ce serait que la confusion puisse être aisée entre une communication institutionnelle et une simple communication personnelle. » Le droit n’apporte pas encore un cadre juridique suffisamment précis aux entreprises qui sou- haitent mieux réglementer la prise de parole de leurs salariés sur les réseaux sociaux. La forma- tion et l’accompagnement des collaborateurs, qui s’expriment en leur nom ou au nom de l’en- treprise sur les plateformes sociales, restent des leviers efficaces permettant, bien souvent, de valoriser son identité de marque. • Cette session, animée par Johana Sabroux (Social Media Club France), a eu lieu le jeudi 14 avril 2021 en visioconférence. • Avec Christophe Calvao, avocat à la Cour, avocat en droit social et Aude L’homme-Guinard, avocate à la Cour chez Alma Avocats. • Compte-rendu rédigé par Maëva Dussault. « Il vaut mieux être prudent sur la rédaction de charte d’usage et rester dans une démarche incitative et explicative. » Christophe Calvao, avocat à la cour
- 43. engager ses collaborateurs Dans un secteur toujours en plein expansion, les plateformes sociales répondent aux évolutions de la société toujours plus friandes de contenus amusants, attractifs et bien évidemment visuels. Au cours de ce cycle, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à TikTok, devenu un eldorado pour le BtoC, et aux transformations de LinkedIn. ÉVOLUTIONS ET USAGES
- 44. 42 cycle #1 TikTok, un levier pour le BtoC, un challenge pour le BtoC CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • La créativité et la diversification des actions sont des leviers essentiels pour le BtoC sur TikTok. • Bien communiquer sur TikTok passe par une veille constante sur les tendances, le respect du ton employé et des codes associés. • L’UGC permet de mesurer l’efficacité d’une campagne sur TikTok, car il traduit la capacité de la marque à engager les utilisateurs.
- 45. plateformes sociales: évolutions et usages Avec plus de 800 millions d’utilisateurs à tra- vers le monde, TikTok est d’ores et déjà un ter- rain de jeu stratégique pour les communicants et marketeurs en BtoC. Mais peut-elle être également un levier pour les acteurs du B2B ? Comment expliquer une telle démocratisation de la plateforme ? Les raisons sont à chercher du côté de la créati- vité, du ton humoristique et de la puissance de l’algorithme à travers ses recommandations ul- tra personnalisées. L’usage de TikTok a par ail- leurs été multiplié par l’effet confinement. Une popularité qui a poussé les marques à s’y po- sitionner. « C’est une plateforme pertinente qui offre du contenu pour tout le monde », estime Astrid Gay, social media manager chez Bel. De fait, grâce à l’onglet « Discover », « il n’est pas né- cessaire d’être un énorme influenceur pour faire des milliers de vues », observe Eloïse Penanhoat, digital et social manager chez Kellogg’s. Bel, tout comme Kellogg's, ont mis en œuvre des campagnes de visibilité sur la plateforme d’en- tertainment durant l’année 2020. DÉVELOPPER UNE « LOVE BRAND CORPORATE » Deux raisons principales peuvent pousser les marques à faire campagne sur TikTok: redorer son image, à travers une campagne de notorié- té et toucher une cible plus jeune par rapport au plan média. Pour Marion Russeil, Marketing Media Manager Southern Europe de TikTok, la plateforme permet de développer une « brand love corporate ». Selon sa cible, se placer sur TikTok peut être utile, une « façon de compléter le plan de communication 360 pour saisir des occasions contextuelles ou évènementielles et moderniser sa marque », estime pour sa part Astrid Gay (Bel). Et ce, grâce au mécanisme du #Challenge, qui a un effet d'entraînement très viral et populaire COMPRENDRE LES CODES Il est nécessaire avant tout de «comprendre les codes de la plateforme et tendances qui naissent chaque jour sur TikTok», conseille Marion Russeil, marketing media manager Southern Europe de TikTok France. Il y a un ton particulier employé, une créativité et une au- thenticité qui ne peut s’appréhender qu’en effec- tuant une veille régulière de l’écosystème afin d’observer les tendances. « Pour les annonceurs, il peut être utile d’avoir un ou des employés spé- cialisés dans cet univers, qui puissent y passer du temps et suivre les tendances qui naissent de manière très régulière », renchérit-elle. De quoi décomplexer les marques qui voudraient tenter l’aventure : « la publication de contenu léger et humoristique sur TikTok est plus simple, car c’est un contenu qui vit moins longtemps », analyse Eloïse Penanhoat (Kellogg’s). Alors, faut-il se lancer sur TikTok en s’appuyant sur une campagne paid ou au contraire se re- poser sur son reach organique ? Les challenges, un des composants de l’ADN de TikTok, peuvent s’utiliser dans les deux cas. Dans la version paid, « la licence nous garantit la propriété du hash- tag que l’on peut ainsi modérer lors des challen- ges », souligne Eloïse Penanhoat (Kellogg’s). Il est également possible de collaborer avec des influenceurs, que l’on peut trouver directe- ment sur la plateforme dédiée « TikTok Creator Marketplace ». « La différence entre les deux stratégies se joue dans l’amplification : il n’y a pas de réelle amplification médiatique dans l’organique à moins que le contenu ne suscite l’intérêt d’un influenceur qui le propulse à sa communauté sans contrepartie. Au contraire, en paid, la visibilité est très grande, plusieurs for- mats mettent le challenge en avant », explique Marion Russeil (TikTok). Pour Astrid Gay (Bel), la question n’est pas de trancher entre challenge et campagne d’influence, mais de s’adapter en fonction des objectifs et des moyens de la marque pour se positionner sur la plateforme. La différence entre le paid et l’organique se situe également au niveau des KPIs: seul le nombre de vues est indiqué en organique alors que dans la version paid, «il y a un accompa- gnement de la part des équipes TikTok et un re- porting de KPIs variés», ajoute-t-elle. Travailler en fil rouge son contenu sur la plate- forme n’est pas le seul levier de performance: « Il n’y a pas de réelle amplification médiatique dans l’organique à moins que le contenu ne suscite l’intérêt d’un influenceur qui le propulse à sa communauté sans contrepartie. » Astrid Gay, Bel
- 46. 44 cycle « ce sont les tendances qui font les codes de TikTok », affirme Marion Russeil (TikTok). La stratégie peut consister également à travail- ler en « one shot » et surtout de diversifier son type d’actions, comme le conseille Floriane de Malestroit, head of communication chez StaffMe, « après avoir essayé de trouver sa ligne éditoriale et tout en entrant dans une logique de test and learn ». BTOB : LA PROCHAINE ÉTAPE ? « En 2020, TikTok a priorisé l’accompagnement des marques en BtoC. L’année 2020 a davantage été une année de croissance de la plateforme en termes de notoriété, d’audience et de rela- tions avec les acteurs du BtoC », précise Marion Russeil, Marketing Media Manager Southern Europe de la plateforme. La plateforme a toutefois accompagné des acteurs du BtoB, notamment sur des enjeux de marque employeur et de branding. Les nou- velles générations prêtant par exemple davan- tage attention aux engagements RSE des en- treprises avant de postuler, le BtoB pourrait se frayer un chemin autour des sujets sociétaux et environnementaux, suggère Eloïse Penanhoat (Kellogg’s). COMMENT MESURER L’EFFICACITÉ Des statistiques sont disponibles sur la plate- forme telles que les KPIs de reach et de vues. Eloise Penanhoat (Kellogg’s) utilise notamment « les données socio démographiques et le taux d’engagement des influenceurs ». Le nombre d’UGC (user generated content) est également un très bon indicateur d’efficacité des cam- pagnes. Au cours d’une campagne de recrute- ment, Floriane de Malestroit (StaffMe) a pour sa part utilisé les statistiques disponibles sur les réseaux sociaux - en particulier les clics, tout en poussant un questionnaire en interne pour identifier la provenance du lead. Chez Bel, Astrid Gay monitore le nombre de vidéos vues et le taux d’engagement, mais, en l’absence de boutique en ligne, ne suit pas les clics. TikTok est donc devenu un réel terrain de jeu pour le BtoC, dont l’audience s’élargit avec un vieillissement progressif des utilisateurs de la plateforme : 32 % d’entre eux ont entre 25 et 34 ans et 35 % ont plus de 35 ans. Des chiffres qui vont à l’encontre de l’image pré-adolescente jusqu’ici associée la plateforme. Et qui laissent entrevoir de nouvelles évolutions dans les pra- tiques « tiktokiennes ». • Cette session, animée par Thomas Van't Wout, co-fondateur de Bolt Influence, a eu lieu le 27 janvier 2021 en visioconférence. • Avec Astrid Gay, Social Media Manager France chez Groupe Bel, Marion Russeil, Marketing Media Manager Southern Europe chez TikTok France, Eloise Penanhoat, Digital & Social Media Manager chez Kellogg’s et Floriane de Malestroit, directrice de la communication chez StaffMe. • Compte-rendu rédigé par Maëva Dussault.. « En 2020, TikTok a priorisé l’accompagnement des marques en BtoC. » Marion Russeil, TikTok
- 47. plateformes sociales: évolutions et usages Les transformations de LinkedIn et l’uniformisation des plateformes CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • Pour satisfaire l'algorithme et optimiser sa visibilité, il est nécessaire de varier les contenus, les médias et de limiter les liens externes. • Les entreprises performent davantage lorsqu’elles privilégient le partage de contenus authentiques et émouvants à des messages commerciaux, souvent trop récurrents. • Dans un contexte où la vie des entreprises est traversée par les questions sociétales, les débats émergent également sur LinkedIn. Acteur incontournable du B2B et du recrute- ment, LinkedIn va désormais bien au-delà de sa vocation première de plateforme de CV en ligne. Son algorithme pousse des contenus de plus en plus personnels. Quelles particulari- tés conserve-t-elle face à l'uniformisation des plateformes ? Comment change-t-elle la donne en matière de personal branding ? Quelles se- ront ses évolutions futures ? Avec 21 millions de membres en France, 740 à travers le monde, la plateforme américaine est devenue un levier professionnel incontour- nable. « LinkedIn est une extension digitale du réseau que l'on tisse chaque jour et permet de voir qui est en contact avec qui », souligne Sylvie Lachkar, Global Social Media Lead pour SAP, groupe mondial de vente de logiciels. La recette de la plateforme est simple et n’a pas varié depuis sa création, en 2002 : se connec- ter professionnellement avec les gens qui nous intéressent. Pourtant, son utilisation a évolué. Ses membres se sont approprié de nouvelles fonctionnali- tés (likes, stories, chat,…) qui rejoignent celles que l’on peut trouver sur les autres réseaux sociaux. « Le changement le plus radical sur LinkedIn, c’est le partage de contenus, qui a ex- plosé depuis quelques années », analyse Cédric Pirot, Responsable Marketing Digital BtoB chez Essilor France. Avec ces partages, il s’agit dé- sormais de présenter une vitrine de son activité professionnelle et personnelle. « Et pour faire rentrer les clients dans le magasin, il faut un maximum de choses dans la vitrine », ajoute Sylvie Lachkar (SAP). VARIER LES CONTENUS POUR INTÉRESSER SON AUDIENCE ET COMPRENDRE L’ALGORITHME Les professionnels présents recommandent de ne pas multiplier les messages commerciaux à longueur de feed - certains théorisant une proportion d’une prise de parole à visée stricte- ment commerciale sur dix. Le contenu posté sur LinkedIn doit être avant tout personnalisé, va- rié et faire ressortir une personnalité. « Pour être pertinent, on ne peut pas partager uniquement des photos avec des descriptifs », témoigne Emilie Le Guernic, communication specialist chez Axa Luxembourg. Sur LinkedIn, pour attirer l'attention, elle a choisi de se mettre en scène, souvent en vidéo, avec un ton décalé. Résultat ? « Je me détache dans le paysage LinkedIn au Luxembourg », juge-t-elle. Malgré sa volonté de varier les contenus et de s’investir dans sa communication, l’utilisateur reste dépendant de l’algorithme de LinkedIn. Secret,celui-ci change constamment et seule la pratique permet de mieux l’appréhender. Quelques éléments à garder en tête : la plate- forme américaine privilégie les contenus à valeur ajoutée, notamment enrichis de vidéos « LinkedIn est une extension digitale du réseau que l'on tisse chaque jour. » Sylvie Lachkar, SAP
- 48. 46 cycle et de photos. Elle aime également les interac- tions : les likes, les commentaires et les men- tions. En revanche, la publication trop régulière n’est pas conseillée, tout comme le partage de liens externes, qui dirigent vers une sortie du site, ou de l’application, et que l’algorithme aura tendance à sanctionner. Il faut aussi réussir, selon nos trois intervenants, à faire passer des émotions. « Il faut humaniser les posts partagés. À la manière de ce que je suis dans la vie, sur LinkedIn, je suis solaire et enjouée. La clé de la réussite, c’est de rester au- thentique », conseille Chloé Murtas, Community Manager pour The Adecco Group et animatrice de cette session. « Les contenus que j’apprécie sont ceux basés sur l’émotion », abonde Cédric Pirot. LINKEDIN VA-T-IL SUPPLANTER FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM ? Y a-t-il des sujets tabous sur LinkedIn ? Les professionnels de la communication désap- prouvent le partage des avis politiques. « Nos collaborateurs ne parlent pas de politique sur LinkedIn car leur opinion pourrait être assimilée à celle d’Adecco », estime Chloé Murtas. Pour au- tant, la vie des entreprises est traversée par les questions sociétales comme l’égalité salariale entre les hommes et les femmes qui n’épargnent pas la plateforme américaine. « Des débats so- ciétaux émergent sur LinkedIn et c’est », recon- naît Jean-Maxence Granier, directeur et fonda- teur d’un cabinet de conseil spécialisé dans les médias et les marques, Think-Out. Débats sociétaux, réseautage, mise en scène de sonimage,l’utilisationdeLinkedInrejointfinale- ment celle des autres réseaux sociaux. LinkedIn pourrait-il tous les absorber ? L’hypothèse de sa victoire sur Facebook, Instagram ou Twitter est intéressante et souscrit à l’idée que la vie pro- fessionnelle prend une place grandissante. La multiplication du télétravail, le peu de temps laissé aux loisirs par la crise sanitaire et l’ab- sence de déconnexion tendent à rendre la limite entre vie professionnelle et personnelle d’au- tant plus poreuse. Cédric Pirot fait néanmoins remarquer que « LinkedIn n’a pas d’intérêt à être la plateforme de toutes les plateformes ». Le réseau social américain n’en continue pas moins d’évoluer : « Une marketplace est en train de se mettre en place pour permettre aux entre- prises de payer les freelances directement sur la plateforme », rappelle Emilie Le Guernic. Pour Sylvie Lachkar, le salut viendra d’une meil- leure utilisation des groupes de discussion : « Ils créent de l’intimité entre les clients et les entre- prises. Mais sur LinkedIn, ce sont pour l’instant des monologues sans beaucoup d’interactions. » De son côté, Cédric Pirot attend LinkedIn sur l'événementiel en ligne. « Il faut des meetings rooms pour que l’on puisse organiser des événe- ments en ligne », conclut-t-il. • Cette session, animée par Karine Sentenac (Insign), s’est tenue le 26 février 2020 à Paris. • Avec Avec Sylvie Lachkar, Global Social Media Lead pour SAP, Emilie Le Guernic, communication specialist chez Axa Luxembourg, et Cédric Pirot, Responsable Marketing Digital BtoB chez Essilor France. • Compte-rendu rédigé par Luc Saint-Elie. « Pour être pertinent, on ne peut pas partager uniquement des photos avec des descriptifs. » Émilie Le Guernic, AXA Luxembourg
- 49. plateformes sociales: évolutions et usages
- 51. politique et réseaux sociaux RÉSEAUX SOCIAUX
- 52. 50 cycle #1 Se préparer à une année de campagne : entre commentaires politiques et fake news Comment se préparer à l’échéance de la prési- dentielle pour les marques et les institutions ? Comment slalomer dans une actualité brûlante, afin d’éviter au maximum les balles perdues ? Quels sont les grands débats qui risquent de toucher, par effet de bord, les entreprises ? Dans ce contexte, comment gérer les commentaires politiques et les fake news qui peuvent surgir sur les réseaux sociaux ? Autant de questions auxquelles nos invités ont apporté de passionnantes réponses : Claire Duriez, directrice Social Media à l’agence di- gitale La Netscouade ; Steve Bonet, directeur Conseil et Communication du spécialiste de la modération, du community management et de la veille Atchik ; Antoine Dubuquoy, consultant à Image 7, agence de communication corporate. DES MISES EN CAUSE DIRECTES DE MARQUES, VOIRE DES FAKE NEWS Si les élections présidentielles constituent une forme de marronnier à l’image de Noël ou de la Saint-Valentin, le terrain est nettement moins balisé, semé d'embûches, souvent glissant. « Ce n'est pas un marronnier comme un autre », as- sure Claire Duriez. « C'est une séquence qui va être plus délicate à aborder pour certaines grandes marques, qui vont peut-être se retrouver sous le feu des projecteurs. » Antoine Dubuquoy abonde : « À partir du moment où les marques sont présentes sur les réseaux sociaux, elles sont exposées et ont appris à gérer une tension permanente, où tout peut déclencher une crise. Pendant la campagne, il y a peut-être encore davantage de tensions car il peut y avoir des mises en cause directes de marques, voire des fake news. » Plus de crises potentielles, mais aussi un rythme d’actualité encore plus effréné. « Pendant une campagne présidentielle, les polémiques se succèdent à rythme très accéléré et dispa- raissent également assez rapidement, constate Steve Bonet. Cependant, il y a toujours le risque d'avoir un cas de figure érigé en symbole et qui, pour cette raison, durerait dans le temps. Personne n'a forcément envie d'être le nouveau Whirlpool, qui s'est retrouvé au cœur des ten- sions de la campagne de 2017. » Lors de l’entre- deux-tours, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’étaient rendus dans l’usine Whirpool à Amiens, menacée de fermeture et devenue depuis le symbole de la désindustrialisation. UNE INSTANTANÉITÉ QUI PEUT S'AVÉRER DÉLÉTÈRE Whirlpool est l’exemple d’une crise qui s’installe dans la durée - ce qui n’est pas le plus fréquent. La controverse récente des « pulls chinois » nous enseigne la dynamique politico-médiatique propre d’une élection présidentielle. Mal rensei- gnée par les équipes de Montebourg, un journal a publié une fausse information annonçant que l’Armée française avait rompu un contrat avec une entreprise française pour acheter des pulls « made in China ». Dans la foulée, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon avaient tweeté leur indi- gnation. « Ce qui est intéressant à observer dans cette histoire, note Antoine Dubuquoy, c'est l'at- titude des politiques qui se sont appropriés le sujet, sans prendre de temps de vérifier l’infor- mation. En temps de campagne, chacun est à la recherche de sa part de lumière, de sa part d'audience, de sa part de voix. C'est le travers principal des réseaux sociaux, une instantanéi- té qui peut s'avérer délétère. »
- 53. politique et réseaux sociaux « Les marques présentes sur les réseaux sociaux sont exposées et ont appris à gérer une tension permanente, où tout peut déclencher une crise. » Antoine Dubuquoy, Image 7 La polémique des « pulls chinois » s’est arrêtée toute nette quand le porte-parole du ministère des Armées a posté un thread Twitter dénon- çant une « fake news ». « L'armée a été exem- plaire en postant un fact-checking très précis, avec des faits imparables, de manière à sortir immédiatement de la conversation », observe Antoine Dubuquoy. « On en revient à la vieille sagesse des Romains : si tu veux la paix, pré- pare la guerre. Pour anticiper ce type de crises, il faut que les entreprises et les institutions aient préparés en amont des éléments de lan- gage, des chiffres, des faits, prêts à être dégai- nés au besoin. » L’ÉCOLOGIE, NOUVEAU SUJET DE TENSION ? Le spectre des entreprises qui peuvent soudai- nement se retrouver dans le viseur médiatique est très large, constate Claire Duriez. « Il y a un certain nombre de sujets qui sont historique- ment très abordés à chaque campagne prési- dentielle : les délocalisations, les fermetures de sites de production mais aussi le pouvoir d'achat, ce qui peut concerner potentiellement de nombreuses entreprises. Lors de cette cam- pagne 2022, on devrait voir émerger de nouveaux sujets, qui travaillent l'opinion depuis plusieurs années. Les thématiques liées au climat et à l'écologie devraient prendre une grande impor- tance dans les débats présidentiels, a fortiori pour les jeunes générations. » Pendant la campagne, les volumétries de com- mentaires peuvent atteindre des sommets : « En 2017, en 6 mois de campagne, on a eu une augmentation du volume de commentaires de l'ordre de 30 % », relate Steve Bonet, qui gère chez Atchik des espaces de commentaires de médias, d’entreprises et d’institutions. « Le vo- lume monte en puissance petit à petit au cours de la campagne, principalement sur les espaces de médias mais aussi d'institutions publiques. Sur les espaces de marques, c'est un peu moins prégnant sauf s'il y a un rapport direct avec les thématiques de l'élection. » Que répondre à un message politique, voire prosélyte, sur des espaces qui ne le sont pas, comme la page Facebook d’une marque ? « Il est recommandé de répondre poliment que ce n'est pas le lieu. Mais si cela se répète, il faudra passer par du masquage sur Facebook, voire la suppression des contenus. Si on a les moyens, le temps et la patience de le faire, la réponse et la pédagogie sont la meilleure des démarches pour désamorcer et dissuader une éventuelle escalade », estime Steve Bonet. LE POINT ASSELINEAU Une campagne présidentielle est propice aux mouvements d’astroturfing. « Les partisans de François Asselineau ont été les précurseurs de cette pratique en France, ils étaient extrê- mement présents, mobilisés, y compris sur des espaces de marques. Ils ont très vite compris, dès 2012, la puissance des réseaux sociaux, et singulièrement de Facebook, pour faire passer leurs idées. Ses partisans étaient particulière- ment doués pour ramener n’importe quel sujet à lui. Il a fallu faire preuve de pédagogie pour leur expliquer qu’ils avaient le droit de soute- nir leur candidat mais certainement pas sous le post d'une grande marque de produits laitiers, avec des messages de ce genre : "Eh oui, le seul qui soutient vraiment la filière des produits laitiers, c'est Asselineau !" », se souvient Steve Bonet. À l’orée de 2022, François Asselineau se fait plus discret mais les troupes numériques les plus mobilisées et prosélytes se trouvent du côté d’Éric Zemmour. Vous avez dit crisogène ? • Cette session, animée par Vincent Glad, s’est déroulée mercredi 1er décembre 2021 en visioconférence. • Avec Claire Duriez, directrice Social Media de l’agence digitale La Netscouade, Steve Bonet, directeur Conseil et Communication du spécialiste de la modération, du community management et de la veille Atchik et Antoine Dubuquoy, consultant à Image 7, agence de communication corporate. • Compte-rendu rédigé par Vincent Glad.
- 54. 52 cycle #2 Les marques doivent- elles s’ engager ? Inégalités, violences policières, choix électo- raux… aux États-Unis, les marques sont de plus en plus nombreuses à s’impliquer dans les débats de société, en prenant des positions tranchées, voire clivantes. En Europe, les marques n’en sont pas encore là, comme le montre une étude me- née par la startup Sortlist auprès de 800 res- ponsables marketing dans 5 pays européens. Si 86 % des personnes interrogées se disent prêtes à éduquer l’audience de leurs marques sur une question sociale, la majorité des équipes mar- keting trouvent qu’il est devenu plus complexe qu’avant de créer des campagnes engagées, en raison des risques de bad buzz.
- 55. politique et réseaux sociaux « On ne part pas du consommateur, mais des sujets qui nous préoccupent. » Marie Cohuet, Ben & Jerry’s « Un post, une campagne, un visuel, tout est sus- ceptible d'être mal interprété. Le bad buzz peut arriver à tout moment. Il faut être extrêmement vigilant, » résume Tancrède d'Aspremont Lynden, Community Designer chez Sortlist. Dans ces conditions, 58 % des responsables marketing européens estiment qu’il faut prendre du recul et aligner les valeurs de la marque avant de se positionner sur un mouvement social et 60 % des marques interrogées n’ont donc jamais sau- té le pas. Pourtant, l’engagement paye. C’est ce que montre une autre étude, menée par l’agence Zeno en 2020. « Lorsque les consommateurs pensent qu’une marque a un objectif fort, ils sont quatre fois plus susceptibles d’acheter au- près de l’entreprise, six fois plus susceptibles de protéger l’entreprise en cas de faux pas ou de critique publique, 4,5 fois plus susceptibles de défendre l’entreprise et de la recommander à leurs amis et à leur famille, 4,1 fois plus suscep- tibles de faire confiance à l’entreprise », détaille l’étude Zeno Strength of Purpose Study. « La crise a également eu un impact sur les attentes des consommateurs, notamment en matière de transparence de la part des marques. Une faute peut coûter très cher aujourd’hui », complète Julie Arnaud, la fondatrice de l’agence La Bise. Sur ces sujets, la question est aussi d’ordre gé- nérationnel : pour les plus jeunes, le positionne- ment des marques et des entreprises par rapport aux enjeux socio-politiques a un fort impact sur leurs décisions d’achats, mais aussi sur leur choix de carrière. À ce sujet, le community desi- gner de Sortlist cite le Global Millennials & Gen Z Survey publié par Deloitte en 2021. 44 % des Millennials et 49% de la Gen Z choisissent leur employeur selon leurs valeurs et leur éthique. « Les marques savent qu’elles doivent se posi- tionner. La question, c’est plutôt comment le faire correctement », estime Tancrède d'Aspre- mont Lynden. Celui-ci propose trois étapes : la définition de l’objectif à atteindre, le choix du sujet sur lequel se positionner (au croisement des valeurs de la marque, des centres d’inté- rêt de l’audience et des sujets qui préoccupent l’opinion publique), puis la nomination d’une personne dédiée à cette problématique en in- terne. À l’heure actuelle, seules 22 % des entre- prises peuvent s’appuyer sur une personne dé- diée à ces sujets en interne. Chez Ben&Jerry’s, marque engagée de longue date sur des sujets sociétaux, une distinction est opérée entre « cause marketing » et activisme de marque. Le premier part des consommateurs et de leurs centres d’intérêt, pour y associer la marque. Le second part de la marque et des va- leurs qu’elle veut défendre, avec l’ambition de provoquer des changements systémiques. « On ne part pas du consommateur, mais des sujets qui nous préoccupent », résume Marie Cohuet, Activism Manager de Ben&Jerry’s en France. En Europe, la marque a fait le choix de s’enga- ger pour les droits des personnes réfugiées et la justice climatique, alors qu’aux Etats-Unis, l’entreprise est davantage engagée sur le sujet de la justice raciale. Sur ses sujets de prédilec- tion, la marque déploie deux approches en pa- rallèle : le lancement de programmes (comme la Ice Academy, qui forme et recrute une ving- taine de personnes réfugiées chaque année) et une action systémique, qui consistent « à faire en sorte que nos campagnes aient un impact structurel sur les législations des pays où nous sommes présents ». Pour ces campagnes, les réseaux sociaux sont des relais privilégiés : ils permettent d’amplifier les actions, de mobiliser les internautes ou de mener des actions de sensibilisation auprès des décideurs. Dans chaque action, la marque s’ap- puie sur des associations de terrain, dont l’iden- tification peut s’avérer complexe : « nous vou- lons trouver des partenaires très radicaux dans leur positionnement, mais qui en même temps ne vont pas avoir de soucis en s'associant avec Ben&Jerry's, » explique Marie Cohuet. La clé d’une bonne campagne « systémique » selon Ben&Jerry’s ? Elle doit être au croisement entre trois dimensions : • l’impact ( « Cette campagne aura un impact significatif et de long terme sur les gens et causes qui importent à la marque, à travers un activisme impliquant les fans et promouvant un changement systémique »), • l’opportunité d’influence ( « des causes qui sont pertinentes, actuelles, avec un potentiel point
- 56. 54 cycle • Cette session, animée par Benoît Zante, s’est déroulée mercredi 8 décembre 2021 en visioconférence. • Avec Julie Arnaud, directrice de l’agence La Bise, Marie Cohuet, Activism manager chez Ben & Jerry’s, et Tancrède d’Aspremont Lynden, Community designer chez Sortlist. • Compte-rendu rédigé par Benoît Zante. « Les marques savent qu’elles doivent se positionner. La question, c’est plutôt comment le faire correctement. » Tancrède d'Aspremont Lynden, Sortlist de bascule, tel qu’un temps politique fort - som- met, agenda parlementaire - dont la marque peut influencer le programme »), • la valeur que la marque peut apporter (« les outils, canaux et bases de fans peuvent appor- ter de la valeur à la stratégie des partenaires »). Par exemple, Ben&Jerry’s mène actuellement une campagne de « harcèlement parlemen- taire »en Grande-Bretagne, en incitant ses fans à contacter les députés par tous les canaux possibles, et en particulier les réseaux sociaux. Le but : inciter les législateurs à changer la loi sur la demande d’asile, alors que les deman- deurs d'asile doivent attendre un an après leur arrivée pour pouvoir initier une demande. « C’est la théorie du changement : plus nous serons nombreux et nombreuses à écrire à nos dépu- tés, plus l’amendement sera soutenu et aura une chance d’être voté. » En France, la culture de la marque est histori- quement moins militante, mais depuis 2018, l’engagement politique est davantage marqué. La marque s’est notamment engagée sur le thème du changement climatique, avec une pé- tition autour de l'inclusion de l'environnement dans la constitution. Les campagnes françaises ont ainsi pris un tournant plus politique, avec la volonté de faire changer des lois. Tout récem- ment, Ben&Jerry’s a lancé la campagne « Zone d’attente, Zone glaçante », pour pousser à la fer- meture des zones d’attente des migrants. Pour autant, toutes les marques n’ont pas la culture de l’engagement de Ben&Jerry’s, impul- sée dès les années 70 par ses fondateurs. Julie Arnaud pointe ainsi la différence de culture entre les entreprises américaines et fran- çaises. « En France, on sent qu’on ne peut pas tout confondre : la politique reste le terrain des politiques. Chacun a un rôle à jouer et dans la tête des Français, l’entreprise n’est pas forcé- ment à sa place quand elle cherche à changer le monde ou faire évoluer la Constitution », ex- plique-t-elle. « Quand on évoque ces sujets-là avec nos clients, la priorité, c’est souvent l’in- terne, avant de commencer à porter le drapeau sur des sujets externes à l’entreprise. Or, est-ce que l’impact est optimisé en interne ? Souvent, ce n’est pas le cas. » Derrière la question de l’engagement des marques, se pose en effet la question de la co- hérence entre le discours et les actes : « c’est bien d’annoncer des actions, de dire ce qu’on veut faire, mais il y a une problématique de preuve et de transparence », souligne la fon- datrice de l’agence La Bise. Conclusion : plus que jamais, sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres, les marques sont invitées à faire preuve de cohérence.
- 57. politique et réseaux sociaux
- 58. 56 CERCLE 5
- 59. cercledircom Le #CercleDircom est un espace de rencontres pensé pour les directrices et directeurs de la communication. Une occasion unique de partager des problématiques liées au secteur de la comm’ digitale et faisant partie intégrante des préoccupations des décideurs. Love brand, marque-média, sobriété numérique… voici les thèmes soulevés en compagnie de nos Dircoms ! DIRCOM
- 60. 58 La love brand est cette marque qui a réussi à développer une relation profondément affective avec ses consommateurs. Le concept, initiale- ment développé par Kevin Roberts (ancien PDG de l’agence de publicité Saatchi & Saatchi) date de 2004 : « Pour survivre, les grandes marques doivent susciter une fidélité allant au-delà de la raison. C’est pour elles le seul moyen de ne pas se fondre dans la masse informe des mil- lions de marques sans avenir. Le secret pour y arriver ? S’entourer de mystère, de sensualité et d’intimité. » Mais à l’ère des réseaux sociaux et de la transparence, quels sont les leviers pour susciter un tel attachement ? ÉVALUER LE TAUX DE LOVE BRAND DE SA MARQUE Mesurer le coefficient d’amour octroyé à sa marque, c’est s’intéresser à l’engagement et au soutien de sa communauté, en interne comme en externe. Il peut être difficile, selon son pro- duit, son secteur d’activité, d’établir une rela- tion passionnelle avec ses consommateurs. C’est le cas notamment d’Arkema, acteur de l’in- dustrie chimique française, dont Gilles Galinier est le directeur de la communication : « lors- qu’il est difficile de se faire aimer au départ, il est nécessaire de s’appuyer sur d’autres forces telles que l’innovation, la modernité, la fiabi- lité et la technologie. » Il en est de même pour Boehringer Ingelheim où tout l’enjeu est de « ré- chauffer » la marque souvent perçue comme « froide et manquant d’émotion », selon Isabelle Emerard, Responsable communication édito- riale et digitale. Tout en entrant dans une in- teraction de proximité avec le public cible, il s’agit de « prouver son engagement en menant des actions concrètes et mesurables », com- plète Doriane Vadot, Responsable de la com- munication externe chez Boehringer Ingelheim. Aimer une marque, c’est parfois aimer d’abord son produit ou son service, comme en témoigne Paul Choppin de Janvry, Responsable Corporate Communication et Business Development de Groupon, une marque qui « n’a jamais prétendu être une love brand, mais cherche à être plu- tôt un love service ». Cet attachement s’évalue aussi bien auprès du client final que des pro- fessionnels que l’entreprise met en relation via son service. Seulement, « il y a une différence entre la notoriété et le degré d’attachement à la marque », distingue-t-il, bien que pour être aimé il faille d’abord se faire connaître. Pour cela, il faut créer de l’attachement et donc de l’émotion. (RE)CRÉER L’ATTACHEMENT : ASSOCIER LA MARQUE À UNE ÉMOTION POSITIVE Les moyens de rattacher la marque à une émo- tion positive peuvent passer par son associa- tion à des moments forts, en sponsorisant no- tamment des événements sportifs ou culturels. Renforcer son capital sympathie, à travers dif- férents contenus ou rendez-vous avec sa com- munauté via les réseaux sociaux est également un levier clé. En somme, il s’agit de devenir un interlocuteur privilégié. Pour Gilles Galinier (Arkema), le contenu pédagogique est un moyen de « tendre vers une communication plus corpo- rate pour informer et rassurer les communautés CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • L’interactivité avec les consommateurs, la cohérence du message et la transparence sont à travailler en synergie pour associer la marque à un univers positif et de proximité. • Des contenus créatifs, pédagogiques et engageants suscitent l’émotion et contribuent à nouer une relation forte avec son audience. • L’écoute active couplée à la solidarité vis-à-vis de la communauté permet de (re)créer un lien d’attachement et de confiance. Comment se faire aimer quand on n’ est pas une love brand ?
- 61. cercledircom sur l’utilité et la légitimité des produits ou des services de l’entreprise. » Pour rattacher la marque à une émotion posi- tive, il faut à la fois : « chasser le vieil adage du “vivons cachés” tout en communiquant par la preuve avec simplicité, cohérence, trans- parence et proximité », selon Gilles Galinier (Arkema). Bien communiquer sur les valeurs et les engagements RSE de sa marque permet de développer cette relation affective : « il est important d’avoir en interne des employés qui adhèrent aux valeurs de l’entreprise pour la vendre correctement », souligne Paul Choppin de Janvry (Groupon). La love brand peut ainsi s’ériger de l’intérieur. Un point vue partagé par Sophy Hunter, Directrice communications groupe et développement du- rable chez Euler Hermes : « les barrières internes doivent d’abord être franchies pour que les diri- geants et salariés voient une valeur ajoutée de l’émotion dans un business dominé par l’exper- tise et sa vocation intellectuelle depuis plus de 120 ans. » Cela peut se faire à travers la trans- mission des valeurs et du rôle sociétal de l’en- treprise, du comité exécutif aux salariés et des salariés aux clients et partenaires, et grâce au développement durable qui est un vecteur por- teur d’émotions. FIDÉLISER ET DÉVELOPPER UNE RELATION DE RÉCURRENCE POUR DEVENIR UNE LOVE BRAND Conséquence, les réflexions menées pour sus- citer l’émotion permettent de créer de l’atta- chement, mais aussi de fidéliser sa commu- nauté. Pour cela, « mettre en place une écoute et une compréhension active est un élément clé », selon Paul Choppin de Janvry (Groupon). C’est un moyen d’établir une relation de ré- currence avec ses partenaires, ce qu’Isabelle Emerard (Boehringer Ingelheim) traduit par la nécessité de créer un lien de solidarité avec ses clients pour les fidéliser. De son côté, Sophy Hunter (Euler Hermes) appuie ses efforts sur le « Complaint Management » et la mise en place de services ciblés pour rétablir un lien de confiance en cette période de crise. Un client dont le problème a été résolu par la marque y sera au final plus attaché qu’un client qui n’a connu aucun problème dans ses interactions avec la marque : « Une plainte résolue est un client convaincu », résume Johana Sabroux, Directrice opérationnelle du Social Media Club et animatrice de cette session. Les réseaux sociaux sont un levier perti- nent pour interagir avec sa communauté. Isabelle Emerard l’illustre par la création chez Boehringer Ingelheim de groupes Facebook dé- diés « plus proches des cibles et des différentes communautés ayant permis à la marque de se mettre en retrait tout en restant au cœur du dispositif. » En définitive, lorsque la marque ne bénéficie pas d’un statut de « love brand », créer du lien avec ses communautés passe à la fois par l’écoute de son audience, la pédagogie et la transparence. Une marque dite « froide » ne peut se permettre une incohérence entre son essence et son récit. Être aimé, c’est bien, être aimé pour ce que l’on est, c’est encore mieux ! • Cette session animée par Johana Sabroux, Directrice opérationnelle, Social Media Club s’est déroulée mardi 9 février 2021 en visioconférence. • Avec Sophie Danis, Directrice de la communication auprès du Groupe TF1, Paul Choppin de Janvry, chargé de communication et business development chez Groupon, Laurence Delaunay, directrice de la communication chez Reworld Media Connect, Isabelle Emerard, Responsable Communication Éditoriale et Digitale Opérations Commerciales France chez Boehringer Ingelheim, Gilles Galinier, Directeur communication chez Arkema, Sophie Hunter, Directrice Communications Groupe et du développement durable chez EulerHermes, Jean-Baptiste Sabiani, chargé de la communication digitale chez Orange et Doriance Vadot, responsable de la communication externe chez Boehringer Ingelheim. • Compte-rendu rédigé par Maeva Dussault. « Lorsqu'il est difficile de se faire aimer au départ, il est nécessaire de s’appuyer sur d’autres forces telles que l’innovation, la modernité, la fiabilité et la technologie. » Gilles Galinier, Arkema
- 62. "ACTIVE WATCH" UN SEUL DISPOSTIF POUR COMPRENDRE LE SECTEUR DE LA COMMUNICATION DIGITALE L A S O U S C R I P T I O N A U D I S P O S I T I F " A C T I V E W A T C H " C O M P R E N D L E S A C C È S S U I V A N T S , P O U R V O U S E T V O S É Q U I P E S : - V E I L L E Q U O T I D I E N N E - L E T T R E H E B D O M A D A I R E - D O S S I E R S D ' A N A L Y S E - S E S S I O N S M E N S U E L L E S D U C L U B « ACTIVE WATCH » UN SEUL DISPOSITIF POUR COMPRENDRE LE SECTEUR DE LA COMMUNICATION LA SOUSCRIPTION AU DISPOSITIF « ACTIVE WATCH » COMPREND LES ACCÈS SUIVANTS POUR VOUS ET VOS ÉQUIPES : • VEILLE QUOTIDIENNE • LETTRE HEBDOMADAIRE • DOSSIERS D'ANALYSE • SESSIONS MENSUELLES DU CLUB contactez-nous : jsabroux@groupe-mind.com "ACTIVE WATCH" UN SEUL DISPOSTIF POUR COMPRENDRE LE SECTEUR DE LA COMMUNICATION DIGITALE L A S O U S C R I P T I O N A U D I S P O S I T I F " A C T I V E W A T C H " C O M P R E N D L E S A C C È S S U I V A N T S , P O U R V O U S E T V O S É Q U I P E S : - V E I L L E Q U O T I D I E N N E - L E T T R E H E B D O M A D A I R E - D O S S I E R S D ' A N A L Y S E - S E S S I O N S M E N S U E L L E S D U C L U B "ACTIVE WATCH" UN SEUL DISPOSTIF POUR COMPRENDRE LE SECTEUR DE LA COMMUNICATION DIGITALE L A S O U S C R I P T I O N A U D I S P O S I T I F " A C T I V E W A T C H " C O M P R E N D L E S A C C È S S U I V A N T S , P O U R V O U S E T V O S É Q U I P E S : - V E I L L E Q U O T I D I E N N E - L E T T R E H E B D O M A D A I R E - D O S S I E R S D ' A N A L Y S E - S E S S I O N S M E N S U E L L E S D U C L U B "ACTIVE WATCH" UN SEUL DISPOSTIF POUR COMPRENDRE LE SECTEUR DE LA COMMUNICATION DIGITALE L A S O U S C R I P T I O N A U D I S P O S I T I F " A C T I V E W A T C H " C O M P R E N D L E S A C C È S S U I V A N T S , P O U R V O U S E T V O S É Q U I P E S : - V E I L L E Q U O T I D I E N N E - L E T T R E H E B D O M A D A I R E - D O S S I E R S D ' A N A L Y S E - S E S S I O N S M E N S U E L L E S D U C L U B "ACTIVE WATCH" UN SEUL DISPOSTIF POUR COMPRENDRE LE SECTEUR DE LA COMMUNICATION DIGITALE L A S O U S C R I P T I O N A U D I S P O S I T I F " A C T I V E W A T C H " C O M P R E N D L E S A C C È S S U I V A N T S , P O U R V O U S E T V O S É Q U I P E S : - V E I L L E Q U O T I D I E N N E - L E T T R E H E B D O M A D A I R E - D O S S I E R S D ' A N A L Y S E - S E S S I O N S M E N S U E L L E S D U C L U B C O N T A C T E Z - N O U S : J S A B R O U X @ G R O U P E - M I N D . C O M
- 63. cercledircom La marque doit-elle devenir un média ? CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • Construire une marque média demande du temps, une grande cohérence dans les contenus créés, fondée sur les valeurs de la marque qui doivent agir comme un fil rouge éditorial. • Être une marque média permet de maîtriser davantage sa communication, d’enrichir sa relation avec ses clients et de capter l’attention de l’audience à l’heure où la publicité traditionnelle ne la retient plus. • La création de contenu d’une marque média peut être interne comme le fruit d’une collaboration avec d’autres médias ou influenceurs, c’est un modèle plus agile que la création publicitaire classique, avec des guidelines solides mais laissant plus de place à la créativité.
- 64. 62 Dans une économie de l’attention de plus en plus tendue, les marques ont fait de la créa- tion de contenus propres un canal de commu- nication privilégié. Au-delà du brand content, faut-il pousser la création de contenus origi- naux jusqu’à créer sa propre audience et deve- nir un média? Quels sont les bénéfices envisa- geables? Comment procéder pour construire sa marque média et comment organiser la créa- tion de contenu? La visibilité et la réputation acquise à travers un statut de marque média se traduisent-elles en termes de business, et com- ment en mesurer les impacts? Pour Robin Caillaud, d’une certaine façon, Le Slip Français a toujours été une marque média, car c’est une marque fondée sur un message et sur les valeurs très fortes que sont le Made in France, l’environnement, la qualité des produits, qui font que la marque a beaucoup de conte- nus à partager et de prises de parole. D’autre part, c’est une marque qui est née en ligne, au- tour d’une communauté, sur les réseaux, où elle a toujours publié du contenu. Cette identité naturelle de marque média n’empêche pas de se poser des questions: en dix ans la marque a beaucoup évolué. Chez EVA Group, qui gère plusieurs marques de cosmétiques dont L’Atelier du Sourcil, la no- tion de marque média est plus nouvelle. Gaelle Bouvier est convaincue que les marques doivent s’imprégner de leurs relations avec le public et se comporter comme un média, avec une lo- gique de rédacteur en chef. Cette communica- tion, qui va bien au-delà de la publicité, donne plus d’atouts. Dans le groupe Casino, la marque média est bien installée pour le corporate et c’est un vé- ritable outil d’influence et de construction de communauté. Le groupe a commencé il y a plu- sieurs années à produire ses propres contenus, à devenir davantage un média, en sortant par exemple son propre podcast, un moyen très effi- cace de développer un média à part entière. En interne, l’application “C’est mon groupe” permet de partager des contenus et de créer une com- munauté, c’est un outil de média interne pour un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui permet aux employés des diffé- rentes filiales de suivre ce qui se passe dans le reste du groupe. Pour l’OCDE, ces questions se posent au quoti- dien, et il n’est pas toujours simple de se situer. L’OCDE ne vend pas un produit mais promeut des idées, qui sont le reflet d’une politique, et s’adresse à de nombreuses cibles. Malgré cela, l’OCDE a réussi à construire une stratégie de communication, qui s’approche désormais d’une stratégie de branding, en deux étapes. D’une part, une équipe est dédiée à la percep- tion de la marque, à la mesure d’impact : elle recueille les réactions du public et permet de sentir les tendances, de repérer les sujets qui intéressent les gens, et de définir une straté- gie de communication proche de l’actualité et des intérêts du public, comme par exemple les sujets Santé qui ont naturellement été très pré- sents en 2020. D’autre part, l’OCDE met mainte- nant en œuvre ses campagnes sur une période définie, avec des messages clés, ce qui permet une bonne coordination de toutes les équipes autour d’une vraie stratégie éditoriale, comme une marque média. REPRENDRE LA MAIN SUR LA COMMUNICATION CORPORATE Les avantages à devenir une marque média sont multiples. Pour le groupe Casino, c’est un outil pour reprendre la main sur sa communication corporate. Les médias traditionnels avaient en effet tendance à se focaliser sur l’actualité fi- nancière du groupe, au détriment d’autres sujets et initiatives positifs. Pour les mettre en valeur, le groupe Casino a décidé il y a déjà trois ou quatre ans de créer son propre média, avec des contenus pour les réseaux sociaux et un pod- cast. Le groupe continue bien sûr à travailler avec les médias traditionnels, la presse et les grands médias TV et radio, la marque média est complémentaire et un bon outil pour rééquili- brer les relations presse. Le Slip Français, en tant que pionnier des DNVB (Digital Native Vertical Brand), s’est toujours adressé de manière directe au consommateur et n’a pas eu dans la même mesure à s’affran- chir de canaux traditionnels, qu’il n’a jamais beaucoup utilisés. En termes de communica- Les marques doivent s’imprégner de leurs relations avec le public et se comporter comme un média.
- 65. cercledircom tion, la marque s’inscrit dans un projet plus large, économique et social, de réindustria- lisation en France. Le Slip Français cherche à prouver que c’est possible de le faire dans de bonnes conditions et que cela n’empêche pas de faire de la croissance. Le patriotisme écono- mique, le Made in France, sont des sujets dont on ne parle pas sur tous les réseaux, ils ne sont pas très adaptés à TikTok où on privilégie les contenus purement mode : il est important de trouver sur quelle plateforme parler de quel su- jet. Le Slip Français procède avec une logique de test. Cette démarche bénéficie à la marque et au commerce : en effet aujourd’hui personne n’a envie de suivre une marque qui fait exclu- sivement des contenus commerciaux, les gens savent que la marque a des produits à vendre, mais leur relation avec la marque va bien au-delà de ça. Dans l’étude Kantar DIMENSION de 2020, on voit d’ailleurs que les consommateurs pensent en majorité pouvoir identifier ce qui est un conte- nu de marque, tout en préférant que celui-ci soit signalé comme une publicité. NOUVELLE RÉPARTITION DU BUDGET MARKETING Pour construire sa marque média, il faut avoir un message à porter, des valeurs, un vrai fil rouge éditorial. Le Slip Français ne s’est pas approprié les sujets de Made in France et d’en- gagement par hasard, ils sont au cœur de l’ADN de la marque. En termes de canaux, cette construction de marque média a eu un impact très net sur la répartition du budget marketing : une partie des budgets de marketing digital, très ROIste, comme par exemple des bannières de retargeting, a été réorienté en création de contenu avec des médias. Historiquement, le programmatique avait une place importante dans le marketing digital du Slip Français, qui a constaté depuis trois ans que les internautes cliquaient de moins en moins sur les bannières, et même ne les voyaient plus, du fait d’ad- blockers ou de l’habitude. Lorsque l’on crée un contenu avec un média, on rédige ou co-rédige un contenu et on l’amplifie avec la communau- té du média pour diriger un maximum de trafic vers ce contenu. L’objectif n’est plus systémati- quement de renvoyer vers le site e-commerce de la marque, c’est une vraie évolution de la pu- blicité digitale et un bon exemple de ce qu’im- plique la marque média. Pour Gaelle Bouvier (EVA Group), les réseaux sociaux sont également à utiliser en fonction du message que l’on a à porter, LinkedIn et Twitter sont des canaux davantage corporate, Facebook, Instagram, et les newsletters per- mettent de s’adresser directement aux clients. À l’OCDE, les newsletters sont également un canal important, elles sont nombreuses et la mise en place d’une stratégie de communica- tion a permis d’en harmoniser les messages. L’OCDE fait aussi beaucoup usage de l’édition de livres et a investi significativement ces der- nières années sur le format web-book qui inclue des animations, des podcasts, des contenus associés… ce format permet d’enrichir l’expé- rience du lecteur pour qu’elle soit la meilleure possible en ligne. En termes de régularité, le rythme était donné par des lancements presse de ces publications, qui étaient des moments de communication assez forts. Aujourd’hui, le timing est un peu plus guidé par l’actualité qui nourrit le contenu des campagnes, il n’est pas toujours nécessaire d’attendre qu’un livre soit publié. Enfin en tant que producteur d’idée, l’OCDE utilise aussi beaucoup le canal broad- cast : les experts de l’OCDE, comme l’écono- miste en chef Laurence Boone, sont souvent invités à prendre la parole et cela a un impact toujours aussi important, les sujets d’actualité donnent beaucoup plus l’occasion de s’expri- mer que pour les marques qui vendent un pro- duit classique. SOUS-TRAITANCE ET GUIDELINES DE CRÉATION Comment créer ce contenu de marque média, en interne, avec un budget dédié, une content factory? Pour Le Slip Français, la réponse est majoritairement en interne : trois personnes s’occupent de la création de contenu visuel, essentiellement de la vidéo, qui est vraiment ce qui fonctionne le mieux dans l’économie de l’attention, et une personne de la rédaction de contenus éditoriaux. Pour conserver une grande cohérence, très peu de choses sont sous-trai- tées. L’exception, ce sont les partenariats mé- dias, car les médias choisis connaissent leur audience, Le Slip Français leur donne des élé- La marque média est complémentaire et un bon outil pour rééquilibrer les relations presse.
- 66. 64 • Cette session, animée par Johana Sabroux, directrice opérationnelle du Social Media Club, s’est tenue en ligne le 18 mai 2021. • Avec Stéphanie Abadie, directrice adjointe de la communication en charge de la presse du Groupe Casino, Gaelle Bouvier, directrice de la communication de IEVA Group, Robin Caillaud, Head of eCommerce du Slip Français, et Virginie Counioux, Digital Transformation Officer de l’OCDE. • Compte-rendu rédigé par Tiphaine Masurel. ments mais leur fait confiance pour créer le contenu le plus adapté à leur audience. Pour l’Atelier du Sourcil, la création de contenu est souvent interne : le groupe Ieva compte une DA et 2 graphistes. L’équipe communication fait appel à eux et crée aussi beaucoup de choses seule, comme les newsletters, qui partent gé- néralement une fois par semaine mais ont été plus fréquentes dernièrement pendant la fer- meture des 114 Ateliers car elles ont permis de maintenir un lien avec les clients. L’équipe étant réduite, pour des contenus ou des événements spécifiques, comme un lancement à venir cet été, il lui faut faire appel à des free lances et des pigistes. Dans ce contexte, les contenus créés par les in- fluenceurs sont essentiels. L’Atelier du Sourcil est une marque attractive pour les influen- ceuses, une politique de gifting a permis de toucher leurs audiences, mais pas encore vrai- ment de créer du contenu. Aujourd’hui beaucoup d’influenceurs font des contenus de très grande qualité, L’Atelier du Sourcil veut collaborer avec eux beaucoup plus dans une logique de créa- tion de contenu, une agence d’influence va les y aider. La marque a besoin de cohérence, que la DA donne des guidelines pour cadrer, tout en laissant une certaine liberté pour que cela ne soit pas trop contraint. Pour Le Slip Français, ces guidelines de créa- tion de contenu sont assez récentes, environ 2 ans, et il faut faire attention à ce qu’elles ne li- mitent pas l’agilité ou la créativité. Les influen- ceurs sont un relais de plus en plus important, ultra-qualitatif, avec des contenus souvent de niveau shooting, ils se sont beaucoup profes- sionnalisés depuis 2 ou 3 ans dans la création de contenus. Leurs contenus sont maintenant complémentaires de ceux de la marque : par exemple sur les produits mixtes les influen- ceurs se les sont appropriés et ont produit des contenus que la marque n’avait pas envisagé. Dans une communauté, il faut accepter la dis- cussion, le débat. Le Slip Français fait ainsi face tous les jours à des commentaires sur le prix de ses produits. Celui-ci est lié à son enga- gement sur le Made in France, et l’entreprise a choisi de l’assumer et de continuer à l’expliquer. Les influenceurs, qui étaient gérés par l’équipe Réseaux Sociaux jusqu’à l’été dernier, dépendent maintenant d’une équipe “Influence” dédiée, à qui 15% du budget de publicité a été alloué. Celle-ci est donc passé instantanément de 0 à 15%, ce qui est un changement très significatif. L’équipe Influence travaille avec tous les types d’influenceurs, micro, nano… et avec tous les types de modèles, CPA, CPC, gifting, ou au for- fait en fonction de la taille de leur communau- té. Le Slip Français préfère d’ailleurs travailler avec des influenceurs qui font peu de partena- riats pour conserver une touche d’authenticité, quitte à ce que leurs communautés soient un peu plus réduites. Enfin, comment mesurer l’impact de ces conte- nus? L’OCDE utilise son outil de mesure des ten- dances, qui permet d’orienter les campagnes mais aussi de mesurer l’impact qu’a eu tel ou tel message. Les mots choisis par les internautes dans leurs recherches Google sont très consul- tés par les équipes, qui les utilisent pour choisir la formation des messages de communication avec beaucoup de précision. Un dashboard de gestion des KPIs de campagne a par ailleurs été mis en place. Conséquence de cette nouvelle identité, le suc- cès d’une marque média se mesure à la fois comme celui d’une marque, avec ses ventes et la satisfaction des clients, et celui d’un média, avec la taille de son audience, son influence et l’engagement créé, qui vient nourrir le succès de la marque.
- 67. cercledircom Sobriété numérique : comment inscrire la communication dans sa stratégie RSE ?
- 68. 66 Le numérique représente actuellement 4 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mon- dial (Green IT, 2020). Pour la France, les émis- sions du secteur sont de 2 % et pourraient passer à 7 % en 2040 si rien n’est fait (Sénat, 2020). Malgré les recommandations de la Convention citoyenne pour le Climat de prendre en compte les enjeux de ce secteur, le numérique n’a pour- tant pas été abordé au printemps lors de la dis- cussion du vote de la loi Climat et résilience. Au-delà de la loi, comment les entreprises et ins- titutions peuvent-elles s’emparer de ces enjeux ? La communication étant au cœur de l’utilisation du numérique par les entreprises, que peuvent- elles changer dans leurs pratiques de commu- nication pour réduire leur impact sur l’environ- nement ? Comment bien mesurer l’effet de leurs actions et comment parler de ces initiatives ? CONCLUSIONS DU RAPPORT DE L’INSTITUT ROUSSEAU SUR LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE Qu’entend-on exactement par sobriété numé- rique ? Pour Adrien Jahier, docteur en sciences de l’information et de la communication, consul- tant et formateur indépendant en redirection et communication écologiques, et co-auteur d’un rapport pour l’Institut Rousseau sur la sobriété numérique, il s’agit d’un «point médian entre un monde sans technologie et un autre qui serait entièrement digitalisé ». Pour les entreprises, cela consiste à choisir les innovations et tech- nologies qui soient en adéquation avec les li- mites physiques de la planète. Au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre du numérique sont causées à 47 %, par les équipements des consommateurs et à 53 %, par les data centers et infrastructures réseau (ADEME, 2021). Tout d’abord, la fabrication des équipements des consommateurs entraîne l’extraction de res- sources naturelles, notamment de métaux, et ac- célère le changement climatique, avec l’utilisa- tion d’énergie émettrice de gaz à effet de serre : déjà en 2003, la production d’un ordinateur por- table demandait, par exemple, 240 kg de com- bustibles fossiles, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonne d’eau (Kuehr & Williams). Ensuite, arrivés en fin de vie, très peu de ces ap- pareils sont recyclés : en 2019, chaque humain a produit 7,3 kg de déchets électroniques (Nations Unies) et cette quantité croît de 3 à 4 % par an. L’Europe en collecte environ un tiers, et les autres continents moins d’un cinquième. Entre la fabrication et la mise à la décharge, l’im- pact de leur utilisation d’Internet, via les data centers et les infrastructures réseau, est donc in- contestable : il est corrélé à une croissance ex- ponentielle de la consommation de données, qui a été multipliée par 38 dans le monde en 10 ans (DecisionData.org, 2020), notamment avec la généralisation des mails (293 milliards de mails échangés dans le monde en 2019 selon Statista), des smartphones, des réseaux sociaux, le rac- cordement des téléviseurs à internet, le dévelop- pement du streaming vidéo ou encore des jeux vidéos en ligne. Cette croissance de la consom- mation de données est accentuée par la hausse de la qualité des vidéos diffusées (4K, HD) et de la 4G, qui consomme environ 10 fois plus d’élec- tricité que la 3G pour une même quantité de don- nées transmises. Les réseaux sociaux, en particulier, ont un impact de plus en plus marqué en favorisant la consom- mation de vidéos présentées souvent en lecture automatique dans les fils d’actualité, dans les « stories », voire dans les messages des utilisa- teurs (ex : TikTok). Le comparatif de l’entreprise Greenspector, cité par Adrien Jahier, a interpellé les participants en présentant l’impact carbone des fils d’actualité des différents réseaux sociaux : IMPACT CARBONE DES FILS D'ACTUALITÉ DES APPLICATIONS RÉSEAUX SOCIAUX Greenspector • Mai 2020 Plus cette valeur est basse, meilleure est l'application ! Tik Tok Instagram Reddit Twitch Pinterest Twitter Facebook Snapchat LinkedIn YouTube 0 Mesures réalisées sur un smartphone Samsung S7 (Android 8) gEqCO2 1 2 3 4 5
- 69. cercledircom Selon The Shift Project (2019), cité par Adrien Jahier, la vidéo en ligne représente 60 % des flux de données dans le monde, soit 20 % du total des émissions de gaz à effet de serre causées par le numérique et 1 % du total des émissions mondiales (équivalant à la quantité émise par un pays comme l’Espagne). Devant ces constats alarmants, que peuvent faire les entreprises ? La note de l’Institut Rousseau propose plusieurs pistes : • Réglementer l’ensemble de la chaîne d’appro- visionnement du secteur numérique ; • Étendre la garantie des appareils numériques ; • Généraliser l’éco-conception ; • Favoriser les réparations et le reconditionne- ment d’appareils ; • Généraliser un passeport numérique européen pour les appareils informatiques entrant sur le continent permettant de suivre leurs différentes étapes de vie ; • Contraindre l’ensemble des sites web de ser- vice public et d’entreprises (à partir d’un certain chiffre d’affaires) à mettre en place des bonnes pratiques auditables afin de réduire leur impact environnemental ; • Constituer une base de données publique pour aider à la prise en compte du facteur environne- mental dans les choix associés au numérique ; • Mieux organiser l’activité des collecteurs de déchets d’équipements électriques et électro- niques ; • Sensibiliser le public sur les enjeux du déve- loppement technologique. Pour les entreprises, les leviers s’articulent au- tour de l’achat des appareils informatiques, leur réparation et leur recyclage, ainsi que de leur utilisation. Certaines mènent déjà des actions en ce sens. Chez Boehringer-Ingelheim, témoigne Roxane Dervaux, un groupe de collaborateurs contribue volontairement à des actions de sensibilisation auprès de leurs collègues, notamment autour de la dépollution numérique via l’élimination des mails et du recyclage d’anciens téléphones envoyés à une association. Pour la communication en particulier, que veut dire la sobriété numérique ? Comme d’autres productions plus industrielles, les sites web peuvent être « éco-conçus », en se posant dès le départ la question de leur impact environne- mental, comme l’a précisé Adrien Jahier : des sites webs plus légers, plus simples visuelle- ment tout en restant attirants, qui vont à l’es- sentiel. C’est ce qu’on appelle les sites « low tech », avec un design beaucoup plus sobre et des images moins lourdes. Dans ses publications sur les réseaux sociaux, l’entreprise peut également « éco-concevoir » sa politique de communication en limitant son usage de la vidéo en ligne et en proposant, lorsque celui-ci est nécessaire, le visionnage en basse résolution. De même, il faut essayer de limiter l’usage de la vidéo dans les visio-conférences. Les entre- prises peuvent également s’abstenir d’utiliser des panneaux publicitaires numériques. COMMENT MESURER L’IMPACT DE CES ACTIONS ? Toutes les actions mentionnées ci-dessus vont dans le bon sens, mais comment savoir les- quelles ont un impact significatif ? Comment établir des priorités entre la réduction de son empreinte liée au numérique et une autre poli- tique, par exemple le remplacement du papier par un support numérique ? Adrien Jahier rappelle que Greenit.fr et l’Institut du Numérique Responsable proposent différents outils d’évaluation et un registre de 65 bonnes pratiques. Un Bilan Carbone® est souvent la 1re étape fondamentale pour toute entreprise qui veut s’engager dans une démarche de réduction de son impact climatique, et que ce bilan est à 80 % remboursé par l’ADEME. Le Bilan Carbone® dans une entreprise passe alors par l’évaluation de postes d’émission associés, entre autres, au secteur numérique comme le matériel informatique immobilisé. Dans ce cadre, il devient également de plus en plus facile d’évaluer l’impact de sa politique de communication digitale : un email ou un tweet font déjà l’objet de mesure dans la Base Carbone® de l’ADEME. L’entreprise met ensuite Une entreprise a tout intérêt à être accompagnée pour évaluer l’impact environnemental de ses différents supports de communication.
- 70. 68 • Cette session, animée par Tiphaine Masurel, s’est déroulée mardi 29 juin 2021, en visioconférence. • Avec Adrien Jahier, PhD, consultant et formateur indépendant, chargé d’enseignement à Polytech Mons, professeur invité à l’IHECS et Roxane Dervaux, Chargée de communication en Développement Durable chez Boehringer Ingelheim. • Compte-rendu rédigé par Tiphaine Masurel. en place un plan d’action afin de réduire ses émissions pour les années à venir. En matière de comparaison d’impact environ- nemental pour un même support de communi- cation en version papier et en version digitale, il n’y a pas de réponse toute faite. Une récente étude pour le groupe La Poste (2020) a don- né, néanmoins, quelques pistes de réflexion et d’action : en dressant plusieurs scénarios pour une Analyse de Cycle de Vie (ACV), qui mesure l’impact potentiel de produits et services sur la santé humaine et l’environnement durant les différentes étapes de leur cycle de vie, il a été montré qu’une publicité de 16 pages A5 est plus favorable à la planète que sa version digitale, c’est-à-dire un site Internet accessible en ligne via un lien envoyé par emailing. Ceci dit, le di- gital est à privilégier, par exemple, pour le cata- logue d’une marque de mobilier et les résultats sont plus mitigés pour la traditionnelle facture d’électricité. Plus généralement, une entreprise a tout intérêt à être accompagnée pour évaluer l’impact environnemental de ses différents sup- ports de communication afin de choisir entre une version papier ou digitale. COMMENT COMMUNIQUER SUR CES ACTIONS ? En fonction de son secteur d’activité, il n’est pas toujours facile d’avoir un discours sur la sobrié- té numérique, quand son activité principale est considérée comme intrinsèquement polluante, comme par exemple, le secteur du transport. D’autres institutions, comme le CNRS, soulignent l’« injonction contradictoire » qui s’applique à la communication numérique : d’un côté, l’incita- tion à faire des vidéos pour capter l’attention du public est très élevée, et encouragée par les agences et conseils ; de l’autre, faire preuve de sobriété est devenu indispensable. Dans tous les cas, il est possible de commu- niquer en interne sur des actions concrètes, comme, par exemple, les initiatives de réduction de nombre de mails lancées par les collabora- teurs de Boehringer-Ingelheim, et d’intégrer ses actions de sobriété numérique dans sa commu- nication sur les politiques RSE de l’entreprise. En 2019, chaque humain a produit 7,3 kg de déchets électroniques et cette quantité croît de 3 à 4 % par an.
- 71. cercledircom
- 73. engager ses collaborateurs Terrain de débats autour des données des plateformes sociales, les commissions social data du Social Media Club nous ont réunis cette année autour des algorithmes et des social ads. De quoi enrichir et optimiser ses stratégies globales de communication ... SOCIAL DATA
- 74. 72 Du contenu marketing pour les humains ou pour les algorithmes ? CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • Les contenus poussés doivent être en accord avec l’identité de marque mais aussi les usages et les codes de chaque plateforme • Pour garantir leur efficacité, le message et le contenu doivent pousser l’algorithme à les distribuer vers la « bonne » cible. • Les KPI - watchtime, attribution, engagement…- doivent être adaptés en fonction du support et de l’objectif.
- 75. commission social data À la base des moteurs de recommandations, du filtrage d’information et de l’optimisation des campagnes, les algorithmes sont aujourd’hui au cœur des stratégies marketing digitales des en- treprises. Doit-on configurer sa communication en répondant à ces algorithmes et leurs évo- lutions, ou à sa communauté cible ? Comment fonctionnent-ils ? Peut-on parler de dualité entre humain et algorithme ? ÉVOLUTION DU FONCTIONNEMENT ALGORITHMIQUE DES PLATEFORMES À ses débuts, le social media reposait sur une logique d’interaction entre les individus où cha- cun apportait de la valeur ajoutée. La première approche des marques sur les plateformes était à la fois vécue comme une opportunité et une contrainte, en obéissant à une logique volumé- trique de course à l’audience. Puis, « lorsque les plateformes sont devenues des médias à part en- tière, il a été nécessaire de produire un contenu qualitatif et percutant », explique Sandrine Andro, Directrice du planning stratégique & du départe- ment médias sociaux du Groupe Makheia. Une marque présente sur les plateformes doit respecter un « objectif d’engagement humain proactif », poursuit-elle. Si le fonctionnement de l'algorithme est subi, il est peut-être plus judi- cieux de communiquer ailleurs. « Je suis favorable à la publication d’un contenu percutant sur les plateformes, mais également au fait que celui-ci puisse évoluer sur des espaces propriétaires. Les outils que sont les réseaux sociaux aident à rendre visibles ces espaces et à générer du trafic. » Cependant, il devient beaucoup plus difficile d’obtenir de l’engagement en social media. « Les marques touchaient 10 à 15 % de leur base de fans, contre 1 % en organique aujourd’hui », sou- ligne Benoit Darre, Expert Social Media chez Axa Group Opérations. Cela s’explique par la volonté des plateformes de remettre les utilisa- teurs et les médias au centre de leur stratégie. MONTER UN PLAN MARKETING SOCIAL MEDIA EFFICACE AVEC L’ALGORITHME Salomé Berlemont-Gilles, Fondatrice de l’agence Jacques Jean, souligne l’imprévisibilité des algo- rithmes. Il est bien sûr nécessaire de veiller sur des sujets tels que la distribution des contenus et l’évolution du fonctionnement des algorithmes, bien qu’il faille «dépasser la dichotomie humain/ algorithme, car ce n’est pas soit l’un soit l’autre.» Face à l’incertitude de leur évolution, « l'impor- tant, c’est le processus mis en place pour mettre le consommateur au centre des préoccupations. Comment parler à son client, qui est-il ? » Pour Benoit Darre (Axa Group Operations), « si le contenu est clé, la stratégie de son déploie- ment et de son exposition l’est encore plus. Nous n’avons pas la main sur l’algorithme, mais nous avons la main sur le budget média. » ALGORITHMES, CONTENUS ET SEO Franck Isabel, Content Strategist & Content pro- ducer chez ManoMano, rappelle que, en ce qui concerne le push (paid media), les algorithmes à la performance sont basés sur le deep lear- ning. Dans ce cadre, le ciblage et la segmenta- tion ne sont pas toujours les stratégies les plus efficaces pour atteindre les meilleures perfor- mances sur le KPI souhaité (vues, trafic…). Dès lors, la méthode traditionnelle qui consiste à forcer le message sur une cible donnée, donne de médiocre performance. Inversement si l’on ne cible pas, on est jamais certain que le contenu atteigne la cible souhaitée. Dans ce contexte, pour maximiser l’efficacité du deep learning et toucher la bonne cible, il faut donc absolument que le message et le contenu lui-même poussent l’algo vers la bonne cible et l’engage. Plus que jamais la pertinence du contenu et son adé- quation avec la cible devient la clé de la per- formance. « Aujourd’hui, quel que soit le KPI fixé, c’est le sujet que l’on aborde, la manière de le présenter, ainsi que l’insertion de CTA explicitent, qui doit créer une résonance chez les personnes intéressées. Par ailleurs, il faudra, pour un mes- sage/cible donné, maximiser le ROI en adaptant un même contenu de base aux plus de canaux possibles », précise Franck Isabel (ManoMano). « En ce qui concerne le “pull” (notamment organic Google), on ne travaille pas pour Google, c’est Google qui travaille pour nous. à la fin, Google ne nous transmet que des datas sur les inter- rogations de nos utilisateurs. Google n’invente pas les questions qu’on lui pose. On ne travaille pas pour ses algorithmes, on travaille pour ses utilisateurs », poursuit le content strategist & content producer de ManoMano. Ces Insights nous guident editorialement pour construire du contenu pertinent, qui réponde réellement à un besoin utilisateur. Un contenu de qualité, sur le long terme sera nécessairement mis en valeur dans les résultats de recherche, pour autant que ce contenu reste soutenu par une nomencla-
- 76. 74 ture parfaite et une infrastructure technique qui rend la lecture et la découverte adaptés aux contraintes des robots de Google. QU’EST-CE QU’UNE CAMPAGNE RÉUSSIE ? D’un point de vue organique, selon Sandrine Andro (Groupe Makheia), « si les marques écoutent, ob- servent et analysent le comportement des pu- blics, notamment à travers la sémantique, alors elles seront plus proches, capteront les ten- dances et les besoins de leur cible. » Les marques ont tout intérêt à s’approprier la stratégie des plateformes : « Le contenu et les algorithmes sont importants, mais le pilier d’une campagne réussie est avant tout l’humain et sa compréhension. » Franck Isabel (ManoMano) nuance cette ré- flexion : « je trouve que l’expression d’une inten- tion fonctionne sur Google, mais cela est moins le cas sur YouTube, sur Facebook et encore moins sur TikTok du fait des algorithmes de re- commandation qui tendent à pousser automa- tiquement le contenu aux utilisateurs, sans que ceux-ci expriment une intention. » Selon Benoit Darre (Axa Group Operations), il reste tout de même difficile de faire unique- ment de l’organique en social media, sauf éven- tuellement sur Twitter et LinkedIn. Sandrine Andro (Groupe Makheia) précise que cela va surtout dépendre du secteur d’activité de l’entreprise. « Il existe aussi de nombreuses plateformes niches, pouvant correspondre à l’ADN de certaines marques. Elles auront donc tout intérêt à s’y lancer ! » Un contenu de marque créatif, adapté à son identité de marque et personnalisé selon les codes de chaque plateforme est la clé pour performer en organique. Il ne faut pas oublier que « chaque réseau a sa propre audience, ses propres spécificités. On aura beau dépenser des millions, l’engagement sera nul si l’on com- munique de la même façon partout, même en paid. Une ligne éditoriale en accord avec son identité de marque et un contenu qui respecte les usages et les codes d’une plateforme est la clé d’une communication efficace », confirme Benoit Darre (Axa Group Operations). KPIS ET OUTILS DE MESURE DE LA PERFORMANCE. Pour les sites à vocation commerciale, l’indi- cateur le plus souvent utilisé pour calculer le ROI est encore l’attribution last-clic, alors que le KPI media est souvent celui du «temps passé absolu» sur un contenu. Mais comme le soulève Franck Isabel (ManoMano), « il faut se deman- der s’il s’agit des meilleurs indicateurs, que ce soit pour un site e-commerce ou pour un contenu pédagogique. » Son KPI favori est le watchtime relatif (80 % de visionnage de la vidéo, ou pour- centage de scroll sur une page par exemple). « Le problème, c’est que le watchtime relatif n’est pas un KPI business. Trouver le lien entre l’acte d’achat et le temps passé relatif est compliqué. » Bruce Hoang, Director digital communication channels & data chez Orange France, précise: « Néanmoins, produire des contenus plus straté- giques et personnalisés sur les réseaux sociaux montre que le watchtime a une forte corrélation sur les ventes. » Un outil pour le mesurer : Moat. En définitive, l’homme et l’algorithme sont in- dissociables. L’analyse fine des besoins de ses consommateurs associée à la production d’un contenu personnalisé et impactant favorise le succès d’une campagne. Pour Sandrine Andro (Groupe Makheia), les marques doivent faire preuve d’audace, en s’appuyant notamment sur leurs communautés. Elle donne l’exemple de Lush qui a quitté les réseaux sociaux en 2019. Un an après, ils ont davantage d’engagement via leur hashtag. « Nous avons tout intérêt à nous dédouaner des algorithmes. Aujourd’hui, les marques manquent peut-être de courage sur ces mécaniques-là. Soyons créatifs ! » • Cette session, animée par Clément Brygier (Digital Insighters) et Charlotte Clemens (Talkwalker), s’est déroulée le 10 février 2021, en visioconférence. • Avec Sandrine Andro, Directrice du planning stratégique & du départe- ment médias sociaux du Groupe Makheia, Salomé Berlemont-Gilles, Fondatrice de l’agence Jacques Jean, Benoit Darre, Expert Social Media chez Axa Group Opérations, et Franck Isabel, Content Strategist & Content pro- ducer chez ManoMano. • Compte-rendu rédigé par Maeva Dussault. SOURCES : • https://www.socialmediatoday.com/news/ insights-from-22-million-business-posts- on-social-media-in-2020-infographi/594648/ • https://moat.com/
- 77. commission social data Social ads : quelles sont les données disponibles et comment les exploiter ? CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • Les objectifs d’audience, de trafic et d’acquisition ainsi que le parcours sont à définir, en fonction des données disponibles, pour chaque persona et chaque service. • S’appuyer sur les données caractéristiques des algorithmes pour optimiser son contenu permet d’obtenir de bonnes performances. • Les « data marketing platforms » (DMP) vont permettre de cumuler les API sur un même outil pour mieux mesurer et comparer l'efficacité des campagnes.
- 78. 76 Les budgets de social advertising ont augmenté de manière exponentielle jusqu’à atteindre des taux de croissance annuels de 17 % entre 2016 et 2021. En 2020, les social ads de Facebook ont notamment représenté 84 milliards de dollars de revenus. Quelles sont les données mises à disposition selon les plateformes ? Et comment les exploiter dans une stratégie de social media marketing ? LES OBJECTIFS DU PAID SOCIAL MARKETING Ce sont des objectifs d’awareness, de trafic et d’acquisition qui définissent le paid social. Suzy Guinot, head of paid media, digital marketing & influence chez Warner Music France témoigne : «en paid social, nous travaillons autant sur des objectifs de couverture (reach) et de notoriété, de trafic, que de conversion et d’acquisition de nouveaux consommateurs selon la typologie du projet. Néanmoins, l’engagement est un objectif qui est plutôt piloté en « owned media » étant donné que nos fans sont sur les réseaux sociaux, nous avons une base de conversation organique.» Mais les objectifs n’ont pas tous la même im- portance. Selon Stéphanie Laporte, dirigeante Agence Social Media chez OTTA, « pour définir une campagne social ads, il faut impérative- ment définir l’objectif afin de bien paramétrer sa campagne, puis identifier les étapes inter- médiaires pour accompagner la réalisation de cet objectif (conversion, mémorisation, fidéli- sation…). L’objectif final et le parcours sont à définir pour chaque persona et chaque service.» Comment les algorithmes réagissent-ils aux social ads ? Pour Colin Godefroy, digital paid media manager, Ferrero France, «les algo- rithmes sur les plateformes ciblent et diffusent les publicités aux profils pertinents, grâce à une qualification de l’audience. Laisser les al- gorithmes optimiser la diffusion et choisir le meilleur contenu permet d’atteindre de bonnes performances. » Dès lors, est-ce pertinent d’opter pour une stra- tégie de testing ? Suzy Guinot (Warner Music) uti- lise encore l’A/B testing : « nous recommandons de toujours avoir plusieurs créations, une da- vantage marketing et d’autres plus organiques et émotionnelles. » Néanmoins, pour Stéphanie Laporte (OTTA), le métier de traffic manager a évolué : « Auparavant, nous faisions beaucoup d’essais en parallèle. A présent, nous nous aper- cevons qu’il y a un délai d’apprentissage de l’algorithme selon un respect de la liquidité de l’audience. » Il s’agirait ainsi de nourrir l’algo- rithme avec la bonne data et ne plus apporter de micro-ajustements manuels qui introduisent un biais humain et dégradent la performance. RETARGETING ET CIBLAGE DE LA DATA Le bon usage d’une DMP (plateforme de ges- tion des données) permet de gagner en résul- tats, facilite une communication et un suivi en inter-plateformes. Suzy Guinot (Warner Music) conseille de l’utiliser en complément des don- nées mises à disposition par les plateformes sociales. Quelles sont les données de ciblage disponibles sur les plateformes ? Colin Godefroy analyse « deux niveaux principaux de ciblage : le socio demo classic de Facebook et Instagram et le ciblage plus affinitaire, davantage qualifié. Les affinités sont disponibles dans Facebook Ads ou au niveau des outils (type Kantar) de statis- tiques tiers. Il est également important de défi- nir des personas pour reconstruire des cibles. » Chez Warner Music France, les données dispo- nibles proposées sont exploitées sur tous les réseaux : Facebook, Instagram, Google, TikTok et Snapchat. « Les guidelines de Facebook et Instagram recommandent d’aller chercher l’audience partout sur tous les placements. En termes de conversion, c’est clairement le feed Facebook le plus performant tandis qu’Ins- tagram va plutôt porter la couverture. Sur Google, le ciblage se fait par mots-clés et em- placements, et sur Snapchat par données socio démo et intérêt. » En termes de format, Colin Godefroy (Ferrero) conseille le format vidéo d’environ 15 secondes. En effet pour Stéphanie Laporte (OTTA) « la vi- déo reste le contenu qui performe le mieux et qui attire le plus l’attention. C’est un format qui permet de recueillir des signaux d’intérêt fort et recibler ensuite les vues réelles avec des mes- sages plus commerciaux. » « À présent, nous nous apercevons qu’il y a un délai d’apprentissage de l’algorithme selon un respect de la liquidité de l’audience. » Stéphanie Laporte, OTTA
- 79. commission social data • Cette session, animée par Clément Brygier (Digital Insighters) et Charlotte Clemens (Talkwalker) s’est déroulée jeudi 1er avril 2021 en visioconférence. • Avec Suzy Guinot, head of paid Media, digital marketing & influence chez Warner Music France, Colin Godefroy, digital Paid Media Manager chez Ferrero France et Stéphanie Laporte, Dirigeante de l’agence social media OTTA. • Compte-rendu rédigé par Maëva Dussault. EXPLOITATION DES DONNÉES : ROI ET MESURE DE LA RÉUSSITE Que mesurer ? Afin de travailler sur un objectif précis, il faut en amont savoir ce que l’on veut mesurer dès le début de la campagne. Chez Warner Music France, la réussite d’une cam- pagne est mesurée en fonction des retombées en termes d’achat et de streams. Mais « la réus- site se mesure également en travaillant la vi- site et le clic sur les pages intermédiaires et sur les CPV », explique Suzy Guinot. De son côté, Colin Godefroy (Ferrero) exploite les données via la « reconstitution des KPIs synthétiques. Par exemple, sur une vidéo, il s’agit de cumuler le coût à la vue (CPV) sur une complétion 100 % pondérée par la visibilité ainsi que la diffusion sur cible. » Comment mesurer ? Certains outils comme les «marketing dashboards qui permettent d’agré- ger les données des API sur une même plate- forme pour pouvoir comparer les supports et avoir une mesure globale », sont des outils à développer selon Suzy Guinot (Warner). Chez Ferrero, pas de dashboard, mais « une utilisa- tion des plateformes de reporting des réseaux sociaux pour suivre les performances des cam- pagnes à la source, et identifier les indicateurs les plus pertinents, ce qui dépend de l'objectif final. » En définitive, ce sont les données qui définissent la stratégie paid : « ce qui est important est de fournir les bonnes données d’apprentissage et les données temps réel », souvent liées à la sai- sonnalité, conclut Colin Godefroy (Ferrero). « Ce qui est important est de fournir les bonnes données d’apprentissage et les données temps réel. » Colin Godefroy, Ferrero
- 80. 78 L'utilisation de la social data se généralise et se diversifie, les données, elles, se multiplient et s’enrichissent. La cohésion et l’organisation entre les différentes équipes deviennent dès lors de précieux leviers de réussite. Comment accompagner et organiser ces équipes ? Nos deux intervenants, Mehdi Hedjem (head of social media et influence à la Française des Jeux) et Justine Greciet (head of data chez Groupe Etam) sont d’accord pour donner la définition suivante au terme “social data” : ce sont toutes les données générées par les médias en ligne, de l’avis du client qui s’ex- prime spontanément sur les réseaux sociaux, aux mots-clés utilisés dans les moteurs de re- cherche qui mènent au site du groupe en pas- sant par les données médias issues des cam- pagnes digitales. Plus globalement, à la FDJ, la social data est utilisée dans quatre secteurs, comme le dé- crit Mehdi Hedjem : «Identifier et anticiper les menaces et opportunités qui pèsent sur l’en- treprise, faire des études qualitatives, nour- rir notre vision clients notamment vis-à-vis de nos parcours joueurs et nous permettre de faire une veille de tout ce qu’il se dit sur l’en- treprise. » QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE LE WEB ANALYST ET LE DATA ANALYST ? Les retours des clients sont scrutés de près. Ils peuvent notamment aider à l’amélioration des produits : « Chez nous, il y a eu une vraie prise de conscience, de l’intérêt d’aller écouter ce que disent nos joueurs et prospects, à tous les niveaux de l’entreprise », juge Mehdi Hedjem. « La social data permet de comprendre les be- soins des clients », abonde Justine Greciet. Son confrère de la FDJ estime qu’à terme, ils visent un délai d’une semaine et demi entre les pre- miers retours des clients et la résolution du su- jet remonté. Pour mieux comprendre les désirs de leurs clients, nos témoins comptent dans leurs équipes social data des employés au profil cen- tré autour de l’analyse de la data mais avec des spécificités : « il y a le web analyst qui utilise des outils comme Google analytics pour com- prendre les mots-clés utilisés par nos clients, le data analyst, qui s’occupe des données sur les réseaux sociaux et data scientist qui utilise l’in- telligence artificielle », expose Justine Greciet. Chez FDJ et chez Etam, tous les collaborateurs qui travaillent autour de la data n’utilisent pas le même dashboard, même si c’est, à terme, un souhait de Mehdi Hedjem : « il n’y a pas un dashboard, mais deux : l’un est orienté média et l’autre reprend les indicateurs plus classiques des réseaux sociaux avec par exemple la cap- tation de mots notamment. Il faut que chacun puisse aller y chercher ce dont il a besoin. » LA SOCIAL DATA TOUCHE TOUT LE MONDE, DE L’HÔTESSE DE VENTE AUX DIRECTEURS RÉGIONAUX Mais au-delà de leur service, malgré l’impor- tance de la stratégie data et de ses usages, tous les collaborateurs de l’entreprise ne sont « Il y a eu une vraie prise de conscience de l’intérêt d’aller écouter ce que disent nos joueurs et prospects, à tous les niveaux de l’entreprise. » Mehdi Hedjem, FDJ Social data : quelle organisation des équipes ?
- 81. commission social data • Cette session, animée par Clément Brygier (Digital Insighters) et Charlotte Clemens (Talkwalker) s’est déroulée mercredi 17 novembre 2021 en visioconférence. • Avec Justine Greciet, Head of data chez Etam et Mehdi Hedjem, responsable social media et influence à la FDJ. • Compte-rendu rédigé par Martin Fort. « Plus on est nombreux à être convaincus de l’importance de la data, plus nos activations seront pertinentes et efficaces. » Mehdi Hedjem, FDJ pas familiers avec le terme de social data et avec ses outils. La définition du terme et l’ex- plication de ce qu’il peut apporter au groupe est donc déjà un enjeu et une partie importante du travail de nos deux intervenants : « c’est une grosse partie du boulot, soit environ 30% de mon temps, confirme Justine Greciet. Une des premières missions est de former les équipes en présentant le dashboard et son utilisation. » A Etam, les directeurs régionaux sont formés à des outils de social data. Mais ces outils touchent tous les collaborateurs du groupe : « les hôtesses de vente ont accès au net pro- moteur score et donc aux avis des clients », explique Justine Greciet. Aussi, dans son entre- prise, Etam, tous les collaborateurs du groupe sont invités à répondre aux clients qui laissent des avis positifs sur les réseaux sociaux. Ils par- ticipent donc tous à la création de social data. À la Française des Jeux, l’acculturation aux ou- tils de la social data passe aussi par des ou- tils pédagogiques : « des formations sont pro- posées régulièrement et nous mettons en place des quizz sur notre intranet avec des goodies à gagner pour gamifier leur expérience», illustre Mehdi Hedjem qui formule que « plus on est nombreux à être convaincus de l’importance de la data, plus nos activations seront pertinentes et efficaces. Aujourd’hui notre social data re- monte également au sein de notre DMP afin de nourrir une vision 360° de notre spectre data. » Pour être sûr que les futures recrues soient fa- milières de ces outils et capables de donner un sens aux chiffres récoltés, nos deux interve- nants participent donc au processus de recrute- ment des futurs employés. « Quand je recrute, je m’assure que la personne a un côté business. La technique s’apprend très vite. Mais elle ne sert à rien si la data n’est pas rendue accessible. La valeur ajoutée du data analyst, par exemple, c’est d’être capable d’expliquer les chiffres », témoigne Justine Greciet. « Le plus important, ce n’est pas de savoir sortir les chiffres mais de les analyser et de les faire vivre dans son écosystème », confirme Mehdi Hedjem. Justine Greciet nous livre ses techniques pour sonder le candidat en entretien : « Je lui pose des ques- tions comme “Selon toi quel a été l’impact du Covid sur le business ? Quelle est la place du web dans nos ventes ?” Certains ne savent pas répondre alors que justement j’attends essen- tiellement du bon sens. » En conclusion, maintenant que la social data fait partie intégrante de la stratégie data, le challenge le plus important reste d’acculturer tous les collaborateurs avec pour priorité de satisfaire les clients.
- 82. 80 SMC 7
- 83. focus Avec des discussions de plus en plus riches et une communauté toujours en pleine croissance, le programme du Social Media Club Lyon de cette année a été axé entre autres sur l’influence, la notion de générations ainsi que le gaming. LYON
- 84. 82 Influence et e-réputation : qui sont les acteurs ? CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • Toutes les parties prenantes de l’entreprise en interne comme en externe, amateurs comme experts peuvent participer à construire son e-réputation, des influenceurs aux internautes : le tout est d’adopter une influence affinitaire de confiance en adéquation avec son projet. • L’e-réputation se forge positivement grâce à une influence authentique, experte et qui fait autorité • Faire une veille en ligne, y compris des signaux faibles, et effectuer une analyse des datas produites des interactions constituent un levier solide pour maîtriser sa e-réputation Aujourd’hui, toute entreprise se doit de travail- ler son identité et son image numérique : 90 % de la population a désormais le réflexe de recher- cher des informations concernant une personne ou une entreprise sur Google (source: Ifop). Dès lors, quels sont les acteurs susceptibles d’influencer son e-réputation, cette opinion commune que l’on se fait de notre entreprise, de ses produits ou de ses services ? Comment mettre au service l’influence pour nourrir son e-réputation ? DÉFINIR L’E-RÉPUTATION L’e-réputation est la représentation sur le web que les internautes se font d’un individu, d’une entreprise ou d’une marque à un moment t. Cette notion n’a de sens que parce que « des traces numériques visibles la concernant sont pro- duites par l’entreprise ou des tiers. C’est l’iden- tité numérique comme capital social qui est en jeu dans l'e-réputation, » selon Christophe Alcantara, chercheur en Sciences de l’infor- mation et de la communication à l’Universi- té Toulouse 1 Capitole et chercheur associé à l’Université d’Ottawa. Ainsi, l’e-réputation est le fruit de ce que l’en- treprise dit d’elle-même et de ce que les inter- nautes en disent de façon visible. Mais c’est également le fruit de cette « ombre numérique » comme produit de la volumétrie des données produites. L’e-réputation est donc une question de visibilité et s’est ainsi « immiscée auprès de l’ensemble des acteurs de la société », observe Robin Coulet, animateur de cette session et fondateur de l’agence Conversationnel. LES ACTEURS DE L’E-RÉPUTATION EN INTERNE Maîtriser son e-réputation passe en effet d’abord par une gestion de son image en interne. Pour Thomas Baur, directeur médias & e-réputa- tion du Groupe Keolis, il s’agit de travailler en synergie avec le marketing (qui se charge de la connaissance et de la satisfaction du client), de la direction de la communication (qui crée du contenu) et de tous les collaborateurs au sens large (qui sont vecteurs de messages). En effet, « maîtriser son influence, c’est réussir à vé- hiculer le message. » Pour ce faire, Keolis s'ap- puie sur les compétences d'une agence (veille et accompagnement éditorial) pour orchestrer la production de messages. C’est un véritable écosystème qui se met au service de la défense de l’identité et des va- leurs de l’entreprise pour Laetitia Guizol, res- ponsable influence & social media chez L’Oréal Luxe France. Au sein de ce système, il ne faut surtout pas négliger « le consommateur comme une voix crédible, prescriptive, sincère et enten- due, ainsi que le rôle de l’employee advocacy qui défend les couleurs de la marque par son expertise. » LES STRATÉGIES Agréger des communautés sur les réseaux so- ciaux est un bon moyen d’influence. Que l’en- treprise participe à les créer et les animer ou qu’elles soient totalement autonomes, c’est
- 85. smc lyon un terrain d’interactivité et d’écoute très utile où se forge sa e-réputation. Parallèlement, la présence des employés sur les réseaux sociaux est un véritable levier grâce à leur expertise. Ce qu’approuve Laetitia Guizol (L'Oréal Luxe France), qui estime que « la spontanéité et l’amour pour la marque de certaines commu- nautés de clients » est un point fort pour valori- ser son e-réputation. Enfin, les collaborateurs peuvent participer à cette e-réputation selon une démarche authen- tique et volontaire. Ils ne doivent pas seulement être formés à l’utilisation des réseaux sociaux, mais également au sujet de la e-réputation et du personal branding. LES OUTILS Il s’agit avant tout d’être à l’écoute des in- ternautes et de savoir analyser quantitative- ment et qualitativement leurs interactions : « nous surveillons tous les retours de consom- mateurs de manière barométrique », indique Thomas Baur (Keolis). Les outils mesurant l’e-réputation peuvent être des outils de so- cial listening, de veille (comme le suivi ap- profondi de Twitter), de data et de tracking. Néanmoins, les outils ne font pas tout, il faut savoir analyser la data produite : faire appel à des agences qui agrègent une série d’outils listening performants si les employés n’y sont pas formés. Certaines données sont plus discrètes et plus difficilement identifiables. Maîtriser son e-ré- putation, c’est également être à l’écoute des « signaux faibles » comme les images et les photographies qui sont aujourd’hui « un lan- gage médiatique digital à part entière », selon Christophe Alcantara (Université Toulouse 1 Capitole). « Faire une veille des signaux faibles est nécessaire pour construire une armure so- lide en cas d’attaque », souligne Laetitia Guizol (L'Oréal Luxe France). AMBASSADEURS ET INFLUENCEURS AU SERVICE DE L’E-RÉPUTATION Comment détecter les bons influenceurs et ambassadeurs, au-delà des experts ? Le micro- cosme des « influenceurs réputés et des journa- listes » n’est pas le seul levier et n’est pas néces- sairement le plus pertinent selon Thomas Baur (Keolis), qui valorise une approche éditoriale de l’influence : « tout dépend de l’essence même du projet de l’entreprise ou de la marque. » Visibilité ou confiance ? Amateur ou expert ? « Dans certains cas, la notoriété et la popu- larité, donc l’approche quantitative par le vo- lume est importante, mais dans d’autres cas, c’est l’approche qualitative via la sphère de confiance qui est plus légitime. L’amateur, par sa notoriété et par l’expertise qu’il va gagner par sa pratique peut faire autorité. Combien d’amateurs aujourd’hui contestent la vision des experts ? », explique Christophe Alcantara (Université Toulouse 1 Capitole). Enfin, des outils permettent d’aiguiller le choix des ambassadeurs selon une logique de reach. De plus en plus, «les entreprises recherchent des talents sincères et affinitaires qui sont d’autant plus crédibles», observe Laetitia Guizol (L'Oréal Luxe France). En définitive, les acteurs de l’influence et de l’e-réputation sont composés de l’ensemble des parties prenantes liées à l’entreprise, en interne comme en externe, experts comme amateurs : direction de la communication et du marke- ting, collaborateurs, médias, influenceurs et ambassadeurs, communautés d’internautes et consommateurs. Le tout est de privilégier une démarche sincère, authentique et affinitaire. • Cette session, animée par Robin Coulet (Conversationnel), s’est déroulée mardi 9 mars 2021 en visioconférence. • Avec Christophe Alcantara, chercheur en Sciences de l’infor- mation et de la communication à l’Université Toulouse 1 Capitole, Thomas Baur, directeur médias & e-réputation du Groupe Keolis, Laetitia Guizol, responsable influence & social media chez L’Oréal Luxe France, et Natalia Robles, Responsable Communication Digitale & Influence de GRDF. • Compte-rendu rédigé par Maëva Dussault. « Les entreprises recherchent des talents sincères et affinitaires qui sont d’autant plus crédibles. » Laetitia Guizol, L'Oréal Luxe France
- 86. 84 Générations X, Y , Z, babyboomers et xenials … quel rapport aux réseaux sociaux ? CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • L’usage des réseaux sociaux est aujourd’hui transgénérationnel. Les seniors plébiscitent Facebook, les jeunes, Instagram. • Youtube est la plateforme la plus universelle, séduisant toutes les catégories d’âge même si elles n’y consomment pas les mêmes contenus. • L’authenticité des messages, l’émotion ou l’association d’une marque à des événements universels tels que le football font partie des leviers permettant aux entreprises de s’adresser à toutes les générations. 90 % des millennials, 77 % de la génération X, et 48 % des babyboomers sont actifs sur les ré- seaux sociaux. Dans quelle mesure les usages sur les réseaux sociaux sont-ils déterminés par l’âge ? Chaque génération a-t-elle un comporte- ment-type en ligne et un réseau qui lui corres- pond ? Comment s'adresser à elles ? Accordons-nous tout d’abord sur les termes. Les millennials sont les jeunes nés autour des an- nées 2000. Les seniors, eux, ont plus de 50 ans. Entre ces deux catégories, les générations X (1965-1980) et Y (1980-2000). Contrairement aux idées reçues, les seniors ont une forte ap- pétence pour les nouvelles technologies et les réseaux sociaux : « l’image du senior qui ne sait pas prendre une photo avec son smartphone est très réductrice sauf peut-être pour les plus de 80 ans », explique Jean-Paul Tréguer, co-fonda- teur de TVLowCost et Senioragency. Rym Saker, directrice de la communication d’Uber France, abonde : l’âge des utilisateurs de l’application Uber a largement évolué pour les chauffeurs comme pour les passagers. « L’âge moyen de nos chauffeurs tournait autour de la petite tren- taine il y a quelques années, il est aujourd’hui de 39 ans. Celui des utilisateurs est passé de 36 à 45 ans », précise-t-elle. À l’inverse, l’idée que tous les jeunes maîtrisent parfaitement les outils informatiques doit éga- lement être déconstruite, selon Thomas Van’t Wout, cofondateur de Bolt Influence : « Le mo- bile a tellement supplanté l’ordinateur que cer- tains jeunes ne savent plus utiliser cet outil. C’est également une idée préconçue que les jeunes maîtrisent parfaitement l’informatique. » Toujours est-il qu’en fonction de leur âge, les in- ternautes n’utilisent pas le web de la même fa- çon. Les digital natives plébiscitent Instagram pour y partager leurs moments du quotidien. Les plus jeunes, souvent encore préadolescents, se sont plus récemment regroupés sur TikTok. Les seniors, eux, préfèrent Facebook. « On es- time qu’ils représentent 40 % de l’audience de Facebook et qu’ils y vont plus de 20 fois par mois », affirme Jean-Paul Tréguer, qui précise qu’ils souhaitent « être connectés à la moder- nité et faire vivre leur réseau amical et fami- lial ». En revanche, selon nos experts, Youtube correspond à la plateforme la plus universelle, séduisant toutes les catégories d’âge même si elles n’y consomment pas les mêmes contenus. « L’image du senior qui ne sait pas prendre une photo avec son smartphone est très réductrice sauf peut-être pour les plus de 80 ans . » Jean Paul Tréguer, Senioragency
- 87. smc lyon Snapchat est surtout populaire auprès d’un pu- blic de niche, très urbain. À partir de ces préférences générationnelles, les marques peuvent cibler très précisément les catégories d'âge qu’elles souhaitent toucher: « Il vaut mieux décomposer la cible. Ce qui va plaire à une personne de 18 ans ne va pas plaire à celle de 60 ans car elles n’ont pas les mêmes références. Dans le cas contraire, le message risque de se transformer en filet d’eau tiède », estime Jean-Paul Tréguer. Existe-t-il pour autant des messages ou des évé- nements universels utilisables sans distinction d’âge pour les marques ? « En France, le football est un vecteur puissant qui permet de dépasser les cibles », illustre Rym Saker. « Ce qui est uni- versel, ce sont les émotions », considère Thomas Van’t Wout. Parmi ce foisonnement de plateformes, pour les marques, Instagram sort du lot. Elle est en tête des réseaux sociaux utilisés par les jeunes. « 21 millions de Français y sont inscrits, soit 39 % des internautes français », rappelle Thomas Van’t Wout. Et, en conséquence, c’est également un canal privilégié par les marques pour y faire de la publicité. « Les marques doivent faire des arbitrages sur les ressources à allouer à la pu- blicité sur les réseaux sociaux et l’enjeu est donc de se trouver sur les bons canaux. C’est parfois un casse-tête. Cela ne sert pas Uber d’être présent sur Snapchat et TikTok car le pu- blic est trop jeune pour être consommateur de nos services. En revanche, sur Instagram, c’est différent : le ton est plus consensuel et les sujets moins controversés que sur Twitter par exemple. Le profil des utilisateurs est plus cohérent avec nos clients », développe Rym Saker. Sur Instagram, de nombreuses marques colla- borent avec des influenceurs. Le profil de ces professionnels se diversifie de plus en plus : « il y a l’émergence d’influenceurs aux tempes gri- sonnantes, c’est une tendance lourde », estime notamment Jean-Paul Tréguer. Thomas Van’t Wout indique que ces profils cumulent « jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de followers » sur leur compte. Les marques se sont très vite adap- tées : « les acteurs du bien-être par exemple in- vestissent beaucoup sur ce genre de profil », poursuit-t-il. Malgré tout, les jeunes restent la catégorie d'âge la plus observée en termes d’usage des réseaux sociaux. Elle donne le ton et est davan- tage encline à acheter via ce canal. Les jeunes sont en revanche de plus en plus méfiants vis-à-vis du phénomène de « drop shipping ». On peut se demander si les réseaux sociaux, à terme, ne deviendront pas un cata- logue commercial géant : « il serait dommage que les réseaux sociaux ne deviennent qu’un es- pace pour les publicités et les promotions des marques », considère Thomas Van’t Wout. Jean- Pierre Tréguer, pense que le phénomène va s’im- poser rapidement : « il va falloir s’habituer à ce que les réseaux sociaux deviennent des plate- formes de vente. À ce propos, le savoir-faire est dans les mains des Chinois. Les plateformes comme Alibaba devraient rapidement s’impo- ser, notamment sur le live shopping. » En définitive, l’usage des réseaux sociaux n’est aujourd’hui plus une question d’âge. Toutes les générations y sont présentes. Mais n’ayant pas les mêmes besoins ni les mêmes aspirations, leur présence varie selon les plateformes et les fonctionnalités offertes par celles-ci. Les marques l’ont bien compris et s'adaptent à ces usages tout en restant à l'écoute des jeunes générations, considérées comme « moteurs » en termes de pratique du Social Media. « Les marques doivent faire des arbitrages sur les ressources à allouer à la publicité sur les réseaux sociaux et l’enjeu est donc de se trouver sur les bons canaux. » Rym Saker, Uber France • Cette session animée par Robin Coulet (Conversationnel) a eu lieu le 5 mai 2021 en visioconférence. • Avec Jean-Paul Tréguer, Co-fondateur de TVLowCost et Senioragency, Thomas Van'T Wout, cofondateur de Bolt Influence et Rym Saker, directrice de la communication chez Uber France. • Compte-rendu rédigé par Martin Fort.
- 88. 86 CE QUE L’ON RETIENT DES ÉCHANGES : • Contrairement aux réseaux sociaux qui captent l’attention, mais limitent les interactions sociales, les plateformes sociales liées aux jeux vidéo (Discord, Twitch) permettent des échanges développés et concrets. • L’authenticité, le respect des codes des joueurs et du type de langage employé sur les plateformes vont permettre à la marque de proposer, au-delà du placement de produit, une expérience gaming originale. • La logique de « gamification » tend à prendre le dessus dans les échanges sur Internet, ce qui favorise l’aspect naturel, fluide, authentique et engageant des échanges, notamment entre la marque et son audience. Le gaming est-il le réseau social de demain ?
- 89. smc lyon Longtemps considéré comme un simple di- vertissement, le jeu vidéo est devenu un vec- teur de lien social et compte aujourd'hui près 2,7 milliards de joueurs à travers le monde. Ces plateformes de jeu peuvent-elles remplacer les réseaux sociaux ? Discord, Twitch, Animal Crossing, Fortnite, League of Legends... com- ment fonctionnent- ils ? Comment les marques s'intègrent-elles dans cet écosystème virtuel? Cette session tente de décrypter cet environne- ment du gaming, qui devient de plus en plus social. POURQUOI ASSOCIER LES PLATEFORMES DE JEUX AUX RÉSEAUX SOCIAUX? La dynamique sociale du gaming est de plus en plus présente au sein des réflexions marke- ting des marques. Pour Fabien Gaetan, Head of Gaming & Social Entertainment chez We are Social, « la communauté gaming génère beau- coup d’interactions, de conversations. La pra- tique et l’expression communautaire sont en train aujourd’hui de dominer le paysage social. » Le jeu vidéo est un espace d’échange qui s’étend. Le fait que l’OMS considère le jeu vidéo comme un « outil social » a participé à démys- tifier le gaming et sa communauté de joueurs, comme le souligne Fabien Camier, global crea- tive strategist chez Gameloft : « il y a un aspect systématiquement “consumer-centric” du jeu vidéo. Discord comme Twitch sont des univers éminemment qualitatifs et utiles, ayant une ca- pacité à engager. » Contrairement aux réseaux sociaux qui captent l’attention, mais limitent les interactions sociales, ces plateformes so- ciales liées aux jeux vidéo permettent des échanges développés et utiles. « Pour moi, le gaming est un média à part entière, je fais le travail que faisaient les commerciaux des pre- mières agences de communication digitale », ajoute-t-il. Robin Coulet, fondateur et CEO de Conversationnel et animateur de cette session, parle de socialisation pour certaines plate- formes, et de jouabilité pour d’autres : elles sont complémentaires. COMMENT ÊTRE PRÉSENT EN TANT QUE MARQUE SUR LES PLATEFORMES GAMING ? Il est plus facile pour les marques en lien avec l’univers du jeu vidéo d’être présentées et accep- tées par la communauté des utilisateurs. C’est le cas d’Asus. Pour Jonathan Angel, directeur Marketing et Communication chez Asus France, les utilisateurs achètent naturellement le ma- tériel informatique que la marque développe : « la particularité de la cible des gamers est que leur engagement est plus important, ils donnent plus facilement des retours construits sur les produits utilisés. » Selon lui, Discord et Twitch sont les deux plateformes qui permettent d’ap- procher les communautés de joueurs et de faire « les plus belles activations ». Dans l’univers du jeu vidéo, il est difficile d’ap- procher sa cible, y compris en tant que marque spécialisée, car les communautés sont mé- fiantes et ont un regard très critique sur les marques, surtout si elles viennent perturber l’expérience de jeu. Il faut donc ajouter de la valeur à cette expérience en étant créatif et surtout en connaissant les codes, le ton des joueurs sur les plateformes d’échanges utili- sées. Pour Jonathan Angel (Asus), la clé se situe dans l’authenticité : « il ne s’agit pas de sim- plement réussir à vendre quelque chose, mais d’avoir une stratégie, du contenu, et de s’investir presque émotionnellement dans sa promotion. Il faut comprendre les jeux et finalement, être joueur soi-même. » Pour les marques qui ont déjà de l’influence, comment s’intégrer dans la jouabilité ? De la même façon, c’est en s’inscrivant dans les co- des du jeu vidéo. Arnaud Robin, head of gaming chez Swipe Back, prend l’exemple du succès de Wendy’s sur Fortnite qui se positionne en tant que marque au sein du jeu via le logo, mais surtout en tant que joueurs. Contrairement à Burger King qui avait fait un flop sur Twitch en envoyant des messages aux streamers concer- nant leurs menus. La marque ne doit pas être intrusive : « L’important est de ne pas gâcher l’expérience de l’utilisateur et de se demander quelle valeur la marque va apporter à cette expérience », es- time Fabien Gaetan (We are social). QUELLE IMMERSION POUR LES MARQUES DANS LE JEU VIDÉO ? De son côté, Fabien Camier (Gameloft) se concentre d’abord sur la connaissance de la marque et sur les datas recueillies concernant les réactions de la cible visée, avant de créer dans un jeu vidéo. Puis vient l’intégration native, où la marque s’in- tègre « intelligemment » dans le jeu, comme a pu
- 90. 88 le faire LEGO dans Minion Rush. Enfin, l’étape ul- time concerne le développement d’un jeu à part entière avec une marque, où le jeu doit raconter une histoire (comme Kinder avec le jeu vidéo Applaydu). « Dans ce cas, on se connecte à l’au- dience, qui a besoin de plus que de l’expérience physique », précise Fabien Camier (Gameloft). Arnaud Robin (Swipe Back) rajoute une étape, celle de la conception du jeu : « Quand on crée une expérience dans un jeu, il faut la concevoir en faisant en sorte qu’elle soit porteuse de va- leurs, mais également qu’elle soit intéressante à consommer pour ceux qui ne sont pas forcé- ment utilisateurs de jeux. » KPIS SUR LES PLATEFORMES DE GAMING Les streamers et les gamers ont accès à toutes les datas intéressantes (KPIs de visibilité, d’en- gagement, d’interaction, le nombre de followers et de clics sur les liens dans les messages, de commentaires, etc.) Pour les marques, le KPI in- téressant est celui autour des « conversations qui se créent par la communauté autour d’une campagne, soit un KPI de branding », précise Fabien Gaetan (We are Social). Les chiffres gé- néralistes sont facilement trouvables, mais sur les plus petits jeux, cela est plus compliqué. « Dans le cadre d’une collaboration avec un stu- dio de jeu vidéo, la data est mise à disposition en interne, mais si le but est de hacker, ce n’est pas forcément le cas », explique Arnaud Robin (Swipe Back). Pour lui, l’enjeu de demain est d’obtenir des data issues des jeux eux-mêmes, et pas uniquement des plateformes sociales. Cela favoriserait le développement d’une nou- velle économie. L’approche média, tout comme l’approche ex- périentielle, est possible, mais il est plus dif- ficile pour cette dernière de mesurer les retom- bées. Selon Arnaud Robin (Swipe Back), «d’un côté, l’approche expérientielle permet de com- prendre les joueurs et de définir une stratégie impactante, et de l’autre l’approche plus tra- ditionnelle permet d’afficher quelque chose.» Jonathan le résume ainsi : « on peut presque parler de quantitatif VS qualitatif, et en tant que marque, nous aimons avoir les deux, tou- cher et engager. » LES MARQUES ET LE GAMING DE DEMAIN « Les comportements et l’engagement des in- ternautes sur les environnements virtuels sont le prochain pilier d’Internet. Cela va créer le métaverse, c’est-à-dire que les mondes virtuels vont remplacer les pages web », se projette Arnaud Robin (Swipe Back). Pour Fabien Gaetan, la logique de « gamification » tend à prendre le dessus dans les échanges sur Internet, ce qui favorise l’aspect naturel, fluide, authentique et engageant des échanges, notamment entre la marque et sa cible. Pour conclure, le gaming n’en est plus au stade de pop-culture : il se pose comme nouvelle forme de langage, d’interaction et de co-créa- tion à exploiter. « L’enjeu pour les marques est de parvenir à suivre l’accélération des pratiques et de se renouveler en créant constamment de nouveaux formats », conclut Jonathan Angel (Asus). • Cette session animée par Robin Coulet, fondateur et CEO de Conversationnel a eu lieu jeudi 24 juin 2021 en visioconférence. • Avec Jonathan Angel, directeur marketing et communication d’Asus France, Fabien Camier, Global creative strategist de Gameloft, Fabien Gaëtan, Head of gaming & Social Entertainment de We are Social France, et Arnaud Robin, head of gaming de Swipe Back. • Compte-rendu rédigé par Maëva Dussault. « La communauté gaming génère beaucoup d’interactions, de conversations. La pratique et l’expression communautaire sont en train aujourd’hui de dominer le paysage social. » Fabien Gaetan, WeAreSocial
- 91. smc lyon
- 92. 90 Nos intervenant.e.s • Stéphanie Abadie, Directrice adjointe de la Communication en charge de la presse, Groupe Casino • Ana Aires-lerin, experte influencer marketing, iGraal • Christophe Alcantara, Université Toulouse 1 Capitole • Sandrine Andro, Head of strategy and digital operations, Groupe Makheia • Jonathan Angel, Directeur marketing et communication, Asus France • Julie Arnaud, Directrice, La Bise • Thomas Baur, media & online reputation Director, Groupe Keolis • Salomé Berlemont-Gilles, Founder, Jacques Jean • Marie-Doha Besancenot, Head of communications, Allianz France • Steve Bonet, Directeur Conseil et Communication du spécialiste de la modération, du community management et de la veille, Atchik • Gaelle Bouvier, Directrice de la communication, IEVA Group • Clémence BoxBerger, Senior Marketing Acceleration Specialist, Fabernovel • Virgile Brodziak, Directeur Général, Wunderman Thompson Paris • Robin Caillaud, Head of eCommerce, Le Slip Français • Christophe Calvao, avocat en droit social, • Fabien Camier, Global creative Strategist, Gameloft • Paul Choppin de Janvry, Responsable Corporate Communication et Business Development, Groupon • Alexander Chupick, Social Media Manager & Employee Advocacy Leader , Accor Group • Sophie Clauzure, Responsable communication, Orange Frances • Malaika Coco, Head of communication & influencer marketing, Groupe Bel • Nina Cohen, Directrice adjointe, Paris Podcast Festival • Marie Cohuet, Activism manager, ben & Jerry’s • Virginie Counioux, Digital Transformation Officer, OCDE • Tancrède d’Aspremont Lynden, Community designer, Sortlist • Sophie Danis, Directrice de la communication, Groupe TF1 • Benoit Darre, Social Media Officer, Axa Group Opération • Floriane De Malestroit, Directrice de la communication, StaffMe • Laurence Delaunay, Directrice de la communication, Reworld Media Connect • Roxane Dervaux, Chargée de communication en Développement Durable, Boehringer Ingelheim • Antoine Dubuquoy, Consultant, Image 7 • Claire Duriez, Directrice Social Media, La Netscouade • Diaa Elyaacoubi, CEO, Monnier Frères • Jean-Philippe Danglade, Professeur de marketing, Kedge business School • Isabelle Emerard, Responsable Communication Éditoriale et Digitale Opérations Commerciales France, Boehringer Ingelheim • Fabien Ferreira, Growth & sales hacker, Station F • Maud Funaro, Directrice de la transformation, Printemps • Fabien Gaëtan, Head of gaming & Social Entertainment, We are Social France • Gilles Galinier, Directeur communication, Arkema • Astrid Gay, Social Media Manager France, Groupe Bel
- 93. les cahiers du smc • Aline Geffroy, global social media Director, Saint-Gobain • Colin Godefroy, digital Paid Media Manager, Ferrero France • Justine Greciet, Head of Social Media, TF1 Pub • Suzy Guinot, Head of paid Media, digital marketing & influence, Warner Music France • Laetitia Guizol, influence & social media Manager, L’Oréal Luxe France • Jennifer Han, Directrice marketing, Ausha Podcast • Mehdi Hedjem, Responsable social media et influence, FDJ • Floréal Hernandez, Rédacteur en chef adjoint, 20 minutes • Bruce Hoang, Director digital communication channels & data, Orange France • Doriane Houssais, Social Media & Business Lead, Microsoft France • Sophie Hunter, Directrice Communications Groupe et du développement durable, EulerHermes • Franck Isabel, Content Strategist & Content Producer, ManoMano • Adrien Jahier, PhD consultant et formateur indépendant, chargé d’enseignement, Polytech Mons • Aude L’homme-Guinard, avocate à la Cour, Alma Avocats • Sylvie Lachkar, Global Social Media Lead, SAP • Camille Lambert, Directrice de projet stratégique en finance de marché, SCIAM • Stéphanie Laporte, Dirigeante, agence social media OTTA • Emilie Le Guernic, Communication Specialist, Axa Luxembourg • Thomas Leroy, Director Video/Podcast Development, Condé Nast France • Tiphaine Masurel, Digital Strategy Director, NRJ Group • Roseline Mouillefarine, Head of contents, VINCI Energies • Jeremy Parola, Directeur des activités numériques , Reworld Media • Olivier Pelvoizin, Directeur du digital, de l’expérience utilisateur et de l’open innovation, Pôle emploi • Eloise Penanhoat, Digital & Social Media Manager, Kellogg’s • Cédric Pirot, Responsable Marketing Digital BtoB, Essilor France • Benoit Prevost, social media & employee advocacy, Sidetrade • Arnaud Robin, Head of gaming, Swipe Back • Natalia Robles, Responsable Communication, Digital, Influence, GRDF • Marion Russeil, Marketing Media Manager Southern Europe, TikTok France • Jean-Baptiste Sabiani, Chargé de la communication digitale, Orange • Rym Saker, Directrice de la communication, Uber France • Nicolas Salado, Direction générale transformation digitale, media & entertainment, Doctissimo • Maxime Taillebois, ex-responsable de la communication numérique, Ministère des sports • Hélène Thomas, Directrice de la Transformation et de l'Expérience Client omnicanale, Monoprix • Jean-Paul Tréguer, Co-fondateur, TVLowCost et Senioragency • Doriance Vadot, responsable de la communication externe, Boehringer Ingelheim • Thomas Van'T Wout, Cofondateur, Bolt Influence • Xavier Yvon, Rédacteur en chef et présenta- teur du podcast « La Loupe », Groupe L'Express • Alexandre Zermati, créateur du podcast, AZZZAP
- 94. 92 Nos membres
- 95. Alors que la transformation numérique des écosystèmes n’est pas achevée, le social media offre une grille de lecture sur l’ensemble des sujets digitaux. Opéré par mind Media, notre service d’information professionnelle consacré à la transformation numérique des médias et de la communication, le Social Media Club France rassemble les professionnels du social media et organise l’échange d’expertises entre pairs, tous secteurs confondus, sur les thèmes structurants de la communication digitale. Cet espace de rencontre et de partage permet des échanges entre pairs et experts – à la fois « thinkers et doers » – à travers des sessions confidentielles et conviviales, dédiées à la pratique et aux enjeux du social media. Ces sessions IRL et digitales sont réservées à nos membres adhérents, animées conjointement par notre équipe éditoriale et des intervenants invités. Pour appuyer la prise de décisions stratégiques au-delà de nos événements, une couverture journalistique quotidienne et approfondie des transformations de l’écosystème complète également nos dispositifs. REJOIGNEZ-NOUS ! www.socialmediaclub.fr/adhesion/ Johana Sabroux, directrice associée du Groupe mind directrice opérationnelle du Social Media Club France PUBLICATION RÉALISÉE PAR L’ÉQUIPE DU SOCIAL MEDIA CLUB SOUS LA DIRECTION DE Émilie Lagarde, responsable opérationnelle clubs Avec Fatim Diallo, chargée de communication et Axelle Peyronnet, chargée de production événementielle DIRECTION ARTISTIQUE ET RÉALISATION Mathilde Dubois ONT CONTRIBUÉ À CE NUMÉRO Maëva Dussault Martin Fort Vincent Glad Tiphaine Masurel Benoit Zante ILLUSTRATIONS © Johan Baggio © Jarosław Danilenko © Nelson Gonçalves © Léonie Koelsch © Loguy © William Jezequel

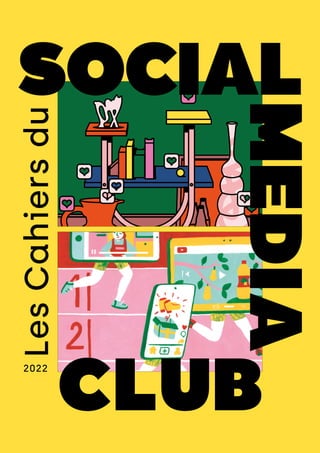



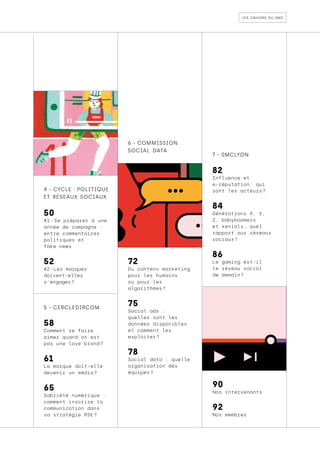
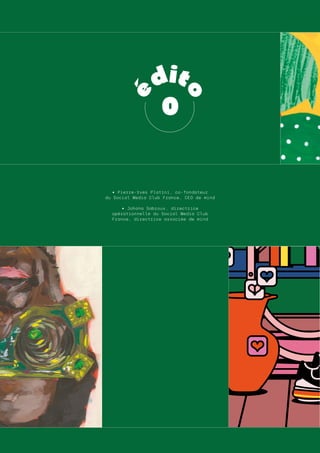

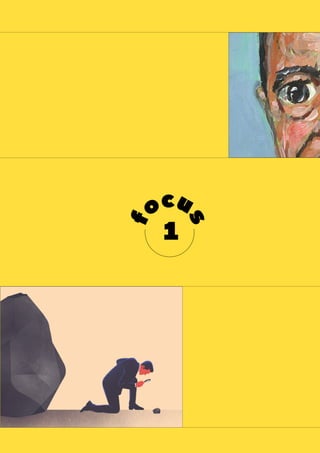



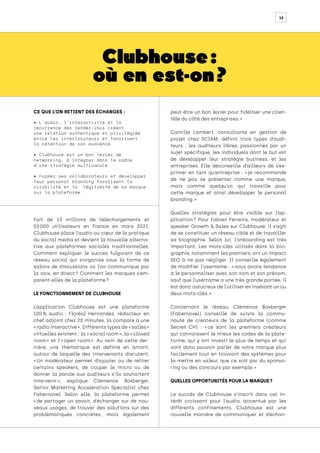






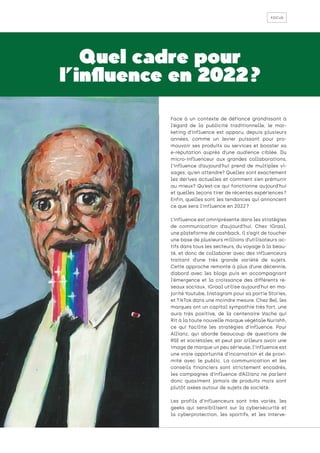


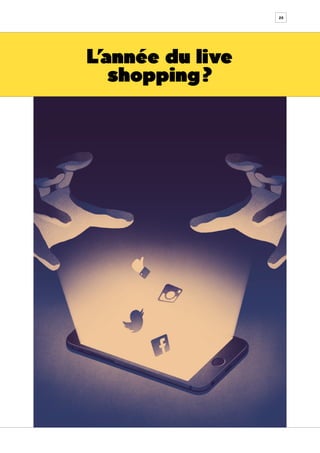



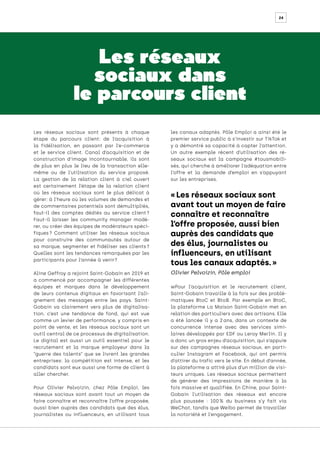
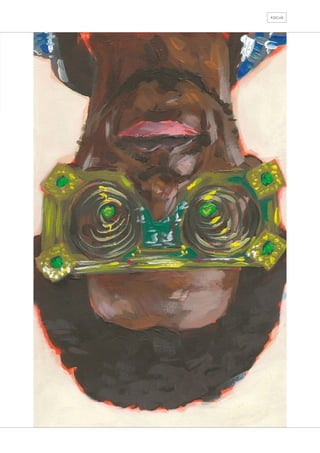


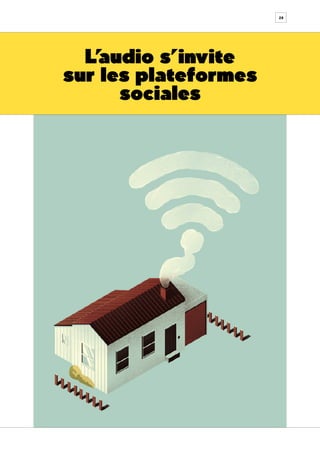






![engager ses collaborateurs
Informer, promouvoir, fédérer… aujourd’hui, plus
que jamais, la comm’ interne s'inscrit pleine-
ment dans la stratégie d'entreprise. Quelles
méthodes pour garantir une communication in-
terne efficace et cohérente ? Quels sont les ca-
naux de diffusion privilégiés
? Comment impli-
quer et accompagner ses collaborateurs dans
cette démarche ?
Les objectifs de la communication interne va-
rient en fonction de l’entreprise. Pour le groupe
Accor, l’objectif va être tout d’abord de valoriser
les salariés de l’entreprise. «
La parole de l’em-
ployé a plus de valeur que celle d’une marque »,
résume Alexander Chupick, social media ma-
nager et employee advocacy leader du groupe
Accor. À l’inverse d’un fonctionnement top-down,
le défi est de faire remonter la voix des collabo-
rateurs. Pour cela, l’accès à l’intranet a été dé-
ployé auprès d’une grande partie des salariés.
Doriane Houssais, social media et business
lead de Microsoft France estime également que
la communication interne a tout intérêt à inci-
ter les salariés à s’exprimer sur les réseaux so-
ciaux: « nos employés sont des experts, des gens
brillants. Ils sont les plus légitimes pour parler
de ce qu’ils font. »
Pour VINCI Energies, la communication in-
terne a essentiellement pour but de fédérer les
83
800 employés du groupe, présents dans 55
pays afin de renforcer leur sentiment d’appar-
tenance à l’entreprise. «
Lors du premier confi-
nement, qui a été difficile à appréhender, les
outils mis en place par la communication ont
permis de garder le lien avec les collabora-
teurs
», précise Roseline Mouillefarine, head of
contents pour VINCI Energies.
DÉDRAMATISER LA PRISE DE PAROLE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Un challenge qui nécessite également de
s’adapter aux contextes culturels locaux.
«
La manière de communiquer au Brésil et en
Allemagne, par exemple, est très différente.
Culturellement, les Brésiliens ont une capacité
à partager qui est très élevée. A contrario, la
prise de parole en Allemagne ne fonctionne que
si elle est organisée en amont », témoigne Cathy
Vigier, senior communication manager pour
VINCI Energies. Les sensibilités politiques et re-
ligieuses doivent aussi être prises en compte :
« Les approches européennes et américaines en
ce qui concerne la problématique de l’appro-
priation culturelle, par exemple, ne sont pas les
mêmes. Il faut donc adapter la communication
européenne quand elle va vers les États-Unis
»,
abonde Alexander Chupick (Accor Group).
Valoriser les employés et les fédérer. À cela
s’ajoute l’opportunité pour l’entreprise, à travers
la communication interne, de répondre à des ob-
jectifs de notoriété. Benoit Prevost, Spécialiste
social media et employee advocacy pour l’édi-
teur de logiciel Sidetrade, illustre : «
la plupart
des collaborateurs de Sidetrade ont un profil
senior et comptent donc un réseau important,
notamment sur LinkedIn. L’enjeu de la commu-
nication interne est donc de les convaincre de
prendre la parole sur leurs réseaux sociaux pour
parler de l’entreprise. »
Cet enjeu est effectivement au cœur de nom-
breuses stratégies de communication. «
Il faut
réussir à dédramatiser la prise de parole sur les
médias sociaux
», explique Doriane Houssais
(Microsoft France). Cela nécessite d’accompa-
gner les collaborateurs dans ce projet : «
les
employés sont parfois timides et se posent des
questions comme “ma démarche ne va-t-elle
pas être trop narcissique ?” Notre rôle est de leur
donner confiance, de leur faire comprendre que
leurs messages ont une valeur pédagogique -
mais parfois c’est aussi simple que de leur dire
que les messages LinkedIn sont effaçables
[si jamais]
!
», analyse Alexander Chupick
(Accor Group).
Pour répondre au manque de disponibilité de
salariés souvent déjà très sollicités, Doriane
Houssais (Microsoft France) propose un ac-
compagnement individuel et personnalisé :
«
Je ne maîtrise pas les sujets de fond mais je
peux les aider sur la forme. Je les interroge sur
le thème qui les intéresse et j’en déduis le plan
de l’article qu’ils pourraient ensuite écrire.
» Si
la formation aux bonnes pratiques peut être
réalisée ponctuellement en équipe, tous les in-
tervenants préfèrent la formation individuelle
pour accompagner les employés : «
pour faire
monter en compétence des gens qui devraient
« L’enjeu de la communication
interne est de les convaincre
de prendre la parole sur leurs
réseaux sociaux pour parler
de leur entreprise. »
Benoit Prevost, Sidetrade](https://image.slidesharecdn.com/cahierssocialmediaclub2021-220331153612/85/Cahiers-Social-Media-Club-2021-pdf-37-320.jpg)